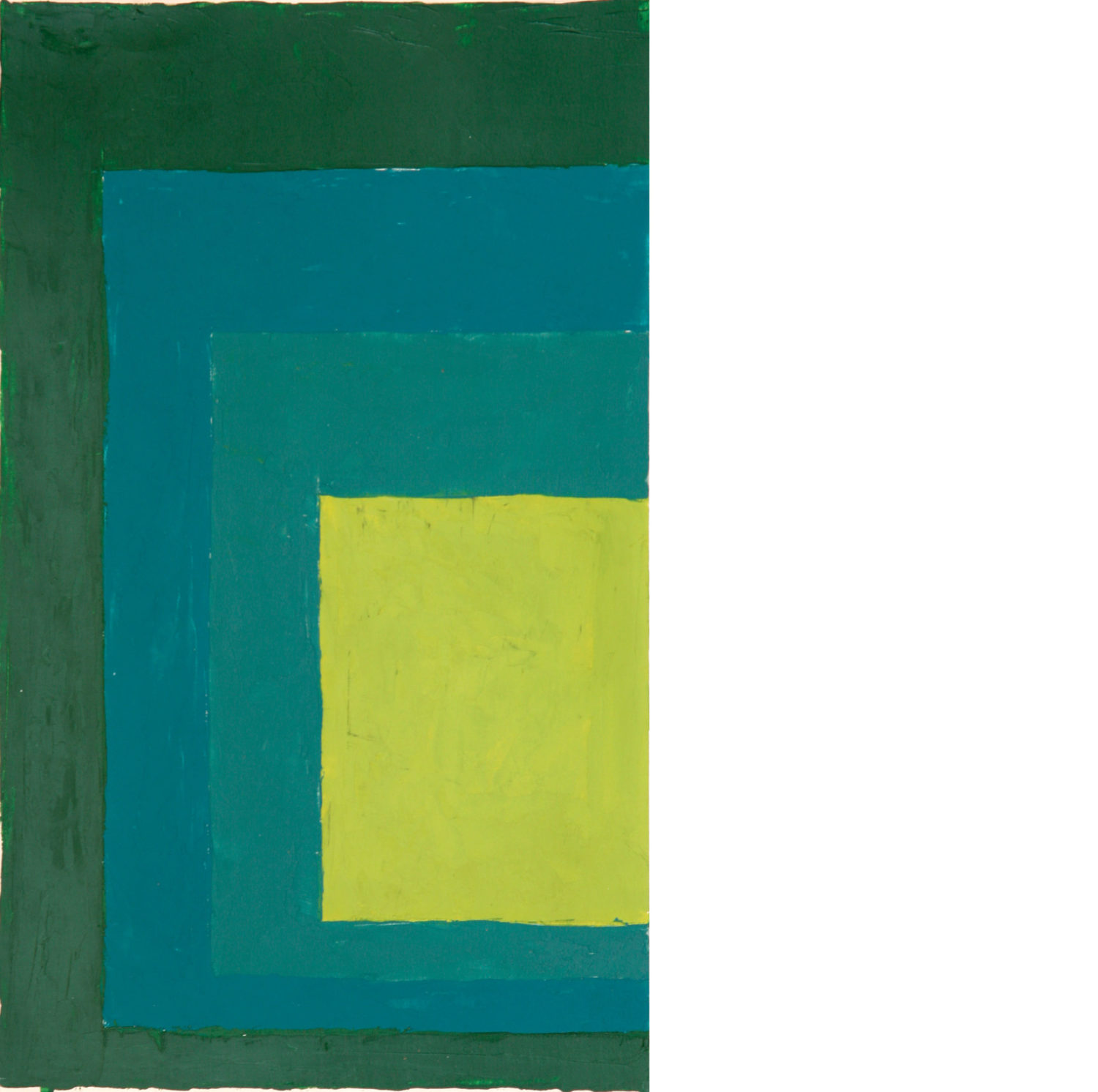Le Raqball
un nouveau sportcomplet-mentaire
Par Thomas Gayet

Il faut plus qu’un mot-valise pour créer un nouveau sport. Ladies and gentlemen, voici le Raqball, de raquette et de ball qui, pour les moins anglophiles d’entre nous, signifie balle. Raqball, donc, sport collectif de raquette, qui ne se contente pas de recombiner des règles préexistantes mais s’affiche bien comme un sport à part entière ayant vocation à se développer et à séduire son propre public. Bien plus qu’un mot-valise, donc. Bonne nouvelle.
C’est à Chris Oven, un artiste passionné de sport, que l’on doit sa création, avec comme idée originelle de créer un sport collectif de raquettes qui dépasse le simple cadre du double ou des matchs en équipe. Remettre le divertissement au cœur de la pratique sportive, et favoriser le développement du lien social par l’effort physique : Chris Oven imagine alors un sport où deux équipes évoluent avec une raquette dans la main et une balle. Elles interagissent en se faisant des passes ou en dribblant afin d’atteindre une cible par un tir. Le Raqball est présenté pour la première fois en 2013 à Valbonne, mais son développement ne fait que commencer puisqu’il faut attendre 2021 pour que son lancement soit officialisé.
Un sport complet,fun et facile à appréhender
Le Raqball est un sport qui s’appréhende sans mal et où le plaisir est presque immédiat. Pour peu que l’on ait pratiqué un autre sport de raquette et que l’on se soit remis des fêtes de fin d’année sans triple pontage coronarien, on s’amuse dès la prise en main, ce qui est une force pour tous ceux qui essaient désespérément d’associer leurs enfants à leur passion pour le tennis et se heurtent à un désintérêt généré avant tout par la frustration qu’ils ont de ne pas réussir à faire passer la balle de l’autre côté du filet alors que le filet, lui, il faut le passer à la fin de l’heure pour peu qu’on soit sur terre battue. Là, les deux équipes de six joueurs (trois titulaires et trois remplaçants) s’affrontent sur un terrain standardisé de 10 mètres sur 20 au cours de matchs brefs et intenses, découpés en 4 périodes de 5 minutes. Pas le temps de s’ennuyer : c’est rapide, physique et fun.
C’est là un des plus du Raqball : le sport est intergénérationnel, mixte, sans contact (coucou la pandémie), adapté à tous les publics et aux personnes en situation de handicap. On peut donc y jouer en famille ou entre compétiteurs chevronnés, l’envisager comme complément sportif au tennis ou à d’autres disciplines sportives ou décider de devenir champion du monde de Raqball pour compenser sa frustration de n’avoir pas terminé sur le podium du concours kangourou en CM2. C’est aussi un sport complet qui associe de la dextérité, de la technique et sollicite la motricité. Pour résumer : un sport complet et adaptable à toutes les pratiques.
Un développement au côtédes sports traditionnels
Si le Raqball a vocation à devenir un sport à part entière, il mise aussi sur les clubs de tennis, de padel et d’autres sports pour accélérer son développement. Parce qu’il mobilise l’adresse, la précision, l’intensité et nécessite la mise en œuvre de stratégies concertées, le Raqball peut tout à fait s’envisager comme un sport d’accompagnement à la performance qui favorise également le travail des appuis, le cardio, la précision dans l’effort et la vision périphérique. Comme l’explique Samia Medjahdi, directrice du club de tennis La Raquette, à Villeneuve-d’Ascq, « le Raqball est une activité ludique qui permet de travailler des points-clés techniques, tactiques et physiques. » Le club propose cette activité en animations pour la découverte du tennis et dans le cadre d’entraînements physiques chez les tennismen aguerris. Il n’est pas le seul.
De fait, nombreux sont désormais les clubs de tennis à se procurer des équipements de Raqball pour accompagner la performance physique de leurs joueurs et conquérir de nouveaux publics. Alors que le débat sur le déclin supposé du tennis n’en finit plus de nous ennuyer, les clubs se doivent de diversifier leurs activités pour séduire les jeunes et attirer les joueurs de demain. Face à ce défi, le Raqball a tout de la perle rare. Car ses équipements ont un avantage concurrentiel sur la piscine ou le padel : ils sont abordables économiquement et très faciles à déployer. Pas besoin de sortir le tractopelle. Ouf.

« En tant que sportif de haut niveau j’ai rapidement trouvé des sensations exceptionnelles dans la pratique du Raqball. On arrive très rapidement à jouer avec ses partenaires, à trouver ses marques, à trouver des combinaisons et à s’amuser. Le Raqball est vraiment un sport complet entre la technique, la précision, le cardio tout en gardant l’esprit du jeu. Il peut être facilement intégré dans les entraînements de sports de raquettes. »
Adrien Mattenet Pongiste, numéro 1 francais de 2010 à 2015.
Des équipements flexibles, exclusifs, abordables et responsables
Le foncier, c’est cher. Pour un club, installer un terrain de padel revient à débourser une cinquantaine de milliers d’euros sans parler de toute la poussière qui se dépose sur les lignes blanches du court numéro 1. Si l’objet de cet article n’est évidemment pas de jouer au jeu des 7 différences entre tous les sports de raquette, le Raqball a cet avantage de proposer des équipements compacts et mobiles, installables facilement sur un terrain préexistant ou dans une zone du club non exploitée. Le sport se joue sur un terrain de 20 mètres sur 10, sur toutes surfaces, en intérieur comme en extérieur. Et le volume des infrastructures est d’une praticité déconcertante : deux valises de rangement comprenant deux modules supports avec panneaux et cibles, douze raquettes légères et de taille unique, douze balles, douze chasubles, des bandes de délimitation à installer où on le souhaite et un petit fascicule rappelant les règles du jeu, le tout pour 5 000 euros : dix fois moins cher qu’un terrain de padel, emballé, c’est pesé. Plouf plouf, ce sera toi qui lira les règles du jeu. Trois minutes plus tard, on joue.
C’est que le Raqball a dès le départ été pensé pour séduire, s’adapter et se développer. Et ça marche, comme le raconte Olivier Roux, manager de l’Académie Caporoux Tennis Coaching : « Je trouve extraordinaire de pouvoir pratiquer l’activité sur n’importe quelle surface, d’adapter le terrain. C’est un sport collectif de raquette que j’utilise autant dans mon enseignement tous publics que dans les entraînements de joueurs de compétition. Il est à noter que le matériel est d’une qualité exceptionnelle. »
Parlons-en, du matériel : en plus des fédérations française et internationale, créées récemment, ses concepteurs ont mis en place des structures dédiées à tous les aspects du sport. Rzball Company se présente ainsi comme l’équipementier du Raqball et coche toutes les cases de la bonne boîte, comme on dit des entreprises qui sont sympas niveau ticket resto et impact environnemental. Tous les matériaux sont éco-responsables et assemblés en France dans un ESAT, un établissement qui accompagne les personnes en situation de handicap et leur apporte un soutien médico-social et éducatif. Les équipes sont disponibles, passionnées et à l’écoute des besoins des clubs. Et le faible coût des équipements a aussi vocation à encourager la pratique sportive partout en France et dans tous les milieux.
Un sport d’avenir
En quelques mois d’existence, le Raqball revendique déjà plusieurs milliers de pratiquants et se tourne déjà vers l’international : le terrain mobile est le même partout dans le monde et aucun frein ne se pose à son développement sur tous les continents. Adoubé par les physios et les coachs sportifs, validé par les profs de tennis et les présidents de clubs, il bénéficie surtout de l’engouement de tous ceux qui le pratiquent. Avec ses matchs courts et son installation extrêmement simple, il semble parfaitement adapté à notre époque sédentaire où tout va plus vite, où le sport doit désormais se penser comme une activité tampon entre d’autres activités multiples, où l’on peut à tout moment se prendre une épidémie mondiale dans la figure donc autant avoir bien transpiré préalablement avec des amis sur un terrain. Je m’égare, pardon.
Mais l’atout sans doute le plus prégnant de ce sport, c’est sa télégénie. Le Raqball est un beau sport, fluide, propice au freestyle et aux coups champagne, sans contact et très graphique. De quoi redonner l’espoir de devenir Federer à tous ceux qui trouvent qu’un tamis 630 est un peu trop petit pour centrer la balle en revers à une main. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a de la place : interrogés sur leur niveau, Christophe Lehmann et Frédéric Branger (respectivement président et responsable du développement du Raqball) ne se considèrent pas comme les numéros 1 et 2 mondiaux de la discipline malgré leur pratique assidue et passionnée. Si devenir numéro 1 mondial de tennis semble désormais compromis, le trône du Raqball vous attend. Et il paraît que son assise est très moelleuse.
Article publié dans COURTS n° 12, printemps 2022.