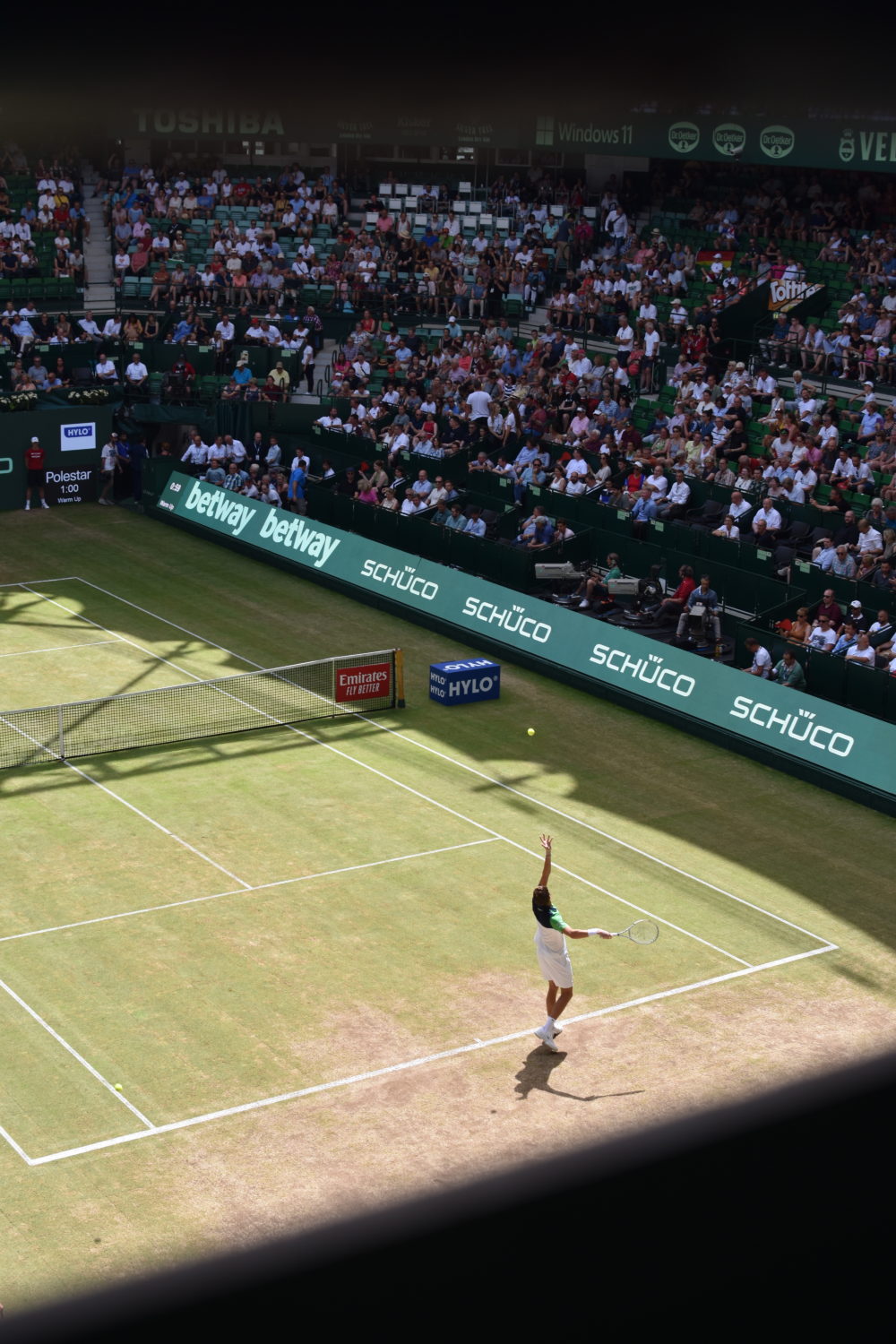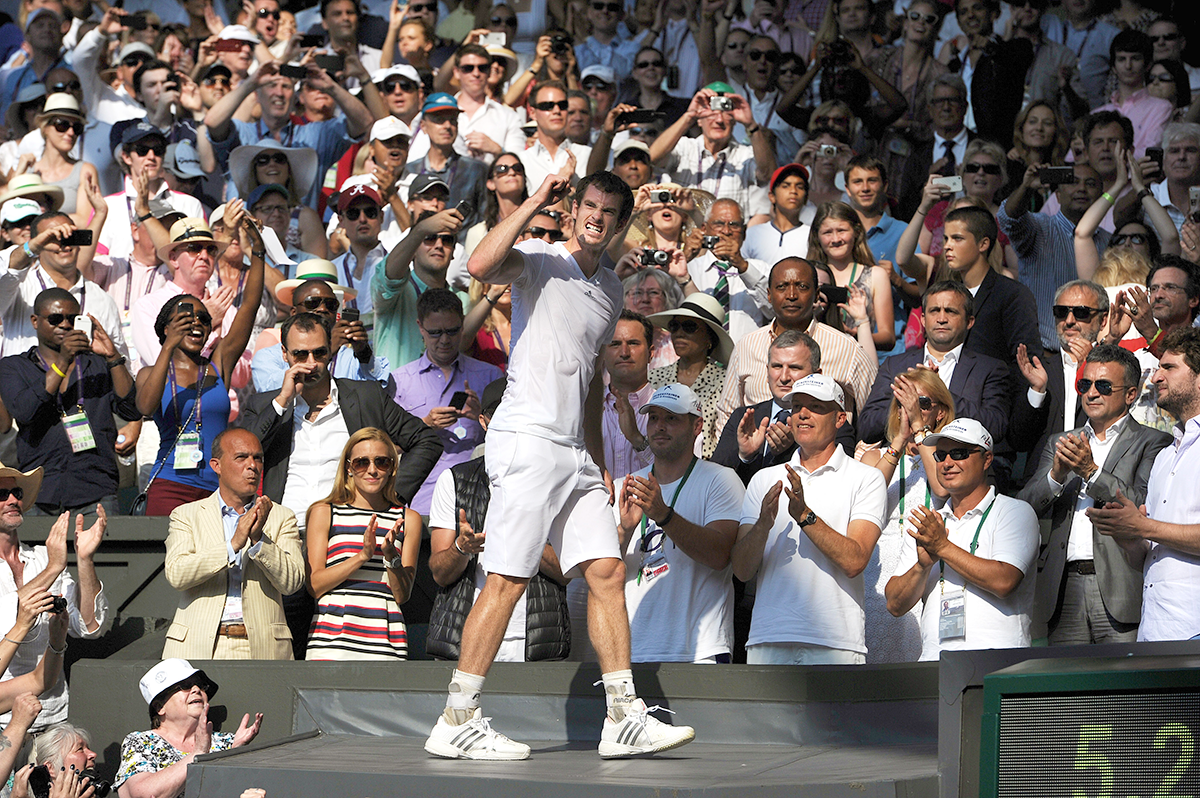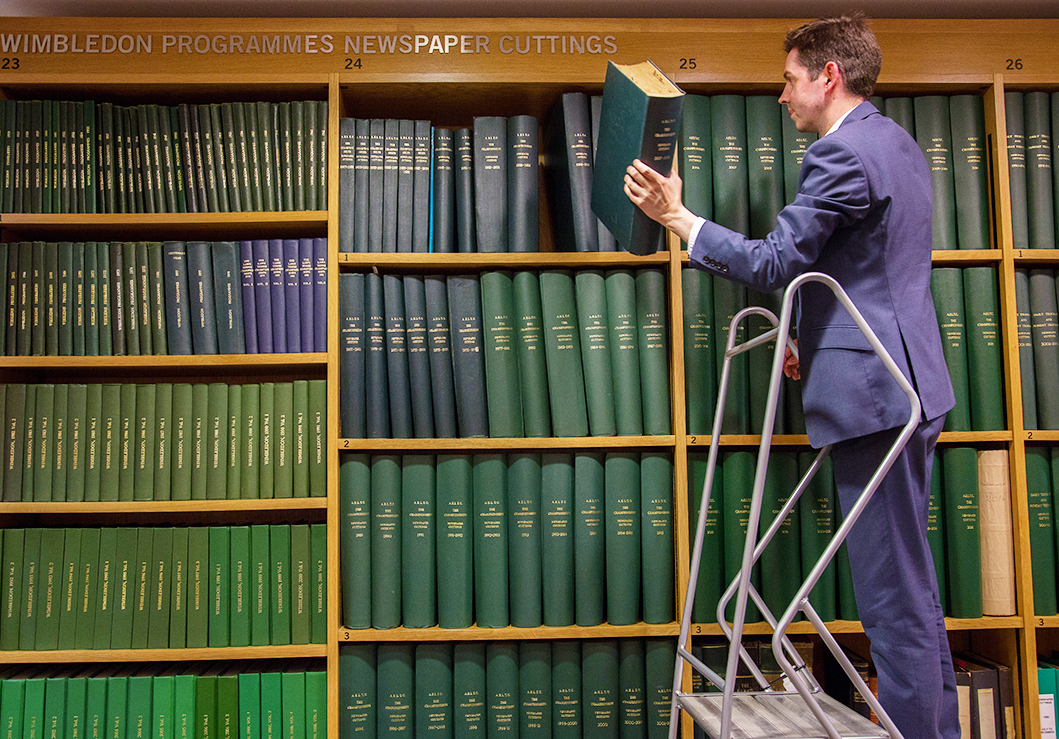À seulement 19 ans, cet étudiant en « math sup math spé » est à l’origine du compte Instagram consacré à Rafael Nadal (@rafaelnadal__) le plus suivi dans le monde. En charge de plus de 200 000 abonnés, le Niçois, fan de tennis et du champion espagnol, nous raconte comment il gère son activité et ses liens avec la famille et l’entourage du Majorquin.
Courts : Comment est née ta passion pour le tennis ?
Raphaël Dabadie : J’ai touché ma première raquette à 6 ans et demi. J’ai beaucoup joué à l’adolescence, j’ai été classé 15 à l’âge de 15 ans. À Nice, l’environnement est idéal pour développer cette passion. Il fait beau et il y a beaucoup de courts sur terre battue. Maintenant que je suis étudiant, je n’ai plus le temps de jouer autant qu’avant, mais j’essaie quand même de continuer à taper dans la balle assez régulièrement.
C : Raconte-nous ta découverte de Rafael Nadal…
R.D. : La première fois que je l’ai vu, c’était à la télévision, lors de l’édition 2010 de Roland-
Garros. Mais le premier match dont je me souviens précisément, c’est la finale de l’Open d’Australie en 2012. Ensuite, l’année suivante, j’ai gagné des places pour assister aux qualifications du Masters 1000 de Monte-Carlo. C’est à cette occasion que j’ai vu jouer Rafa pour la première fois en vrai, à l’entraînement. Ça m’a vraiment marqué, je m’en rappelle encore. Quelques jours plus tard, j’ai assisté à la finale, sa première défaite à ce stade de la compétition à Monaco, contre Novak Djokovic.
C : Qu’est-ce qui t’a plu chez Rafael Nadal : son style de jeu, sa détermination ?
R.D. : J’ai eu un coup de coeur immédiat. C’est difficile à expliquer mais il dégage quelque chose d’assez unique. Forcément, étant français et le voir gagner Roland-Garros, ça marque. Je crois que son coup droit m’a impressionné, tout comme sa combativité. Évidemment, j’ai des points communs avec lui et ça a dû jouer dans mon envie de soutenir Rafa. Je m’appelle Raphaël. Je suis gaucher et je joue de la main droite, lui est droitier et joue de la main gauche.
C : Comment as-tu vécu son 21e sacre en Grand Chelem à l’Open d’Australie, un succès à la fois historique et inattendu après son opération au pied ?
R.D. : Comme d’habitude, j’ai regardé la rencontre tout seul devant mon écran, car je ne suis pas très sociable pendant les matchs. À 3/2 0/40 pour Medvedev dans le troisième set, je n’y croyais plus du tout. Quand il a gagné, j’étais sur un nuage. J’ai encore du mal à réaliser. Surtout après ce qu’il a connu. À Abu Dhabi durant la présaison, il n’était pas au top. Ensuite, il attrape la Covid-19. Et finalement, il gagne l’ATP 250 de Melbourne, puis l’Open d’Australie, c’est incroyable ! J’ai la Une de l’Équipe juste à côté de moi, intitulée « Le Martien ». Je pense que c’est le plus beau match que j’ai regardé, celui avec le plus d’émotions, de toute la carrière de Rafa.
C : Tu vis tous les matchs de Nadal à la manière d’un fervent supporter de foot ?
R.D. : Pas tous, mais certains oui. Je suis assez tendu et stressé pendant les matchs. C’est pourquoi je préfère les regarder seul. C’est mieux pour moi et plus sympa pour les autres. Il y a des matchs, des points que je n’ai pas encore digérés. Et si on m’en parle, je peux réagir un peu froidement. Ça ressemble effectivement à une vraie passion.
C : Comment as-tu eu l’idée, en 2013, de créer une « fanpage » Instagram en l’honneur de Rafael Nadal ?
R.D. : J’avais seulement onze ans. Mon unique but, c’était de partager ma passion pour Rafael Nadal et de rencontrer d’autres fans. Comme 2013 était une bonne année, je communiquais ses résultats et son palmarès, ce qui constituait la base de nos discussions. Il n’y avait pas beaucoup de « fanpages » à l’époque, donc ça a mis du temps à décoller. Mais de toute façon, je ne pensais pas du tout que le compte prendrait autant d’ampleur. J’ai mis trois ans pour accueillir 2000 abonnés. Et jusqu’en 2019, il n’y avait que 16 000 abonnés. Une évolution lente, très lente. Comme je ne parlais pas anglais, ça m’a empêché de développer l’activité du compte. Depuis que j’écris en anglais, tout a changé. Aujourd’hui, on est à plus de 180 000. La page est internationale. Beaucoup d’abonnés sont américains. Ensuite, ce sont des Espagnols, des Indiens, des Français et des Argentins.
C : Quel a été l’élément déclencheur qui a permis à ta page d’exploser ?
R.D. : Durant le printemps 2019, j’ai organisé un projet pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rafael Nadal. J’ai réuni plusieurs vidéos de fans du monde entier et j’ai publié une grande vidéo avec un message sympathique pour ses 33 ans. Je l’ai postée sur les réseaux sociaux sans réelle attente. Je suis allé en cours, et quand je suis sorti, vers midi, j’ai vu que j’avais reçu plein de messages. Il y a avait quelque chose de bizarre. En fait, c’était Rafa qui avait laissé un message sur la page pour remercier tout le monde. Ça a attiré d’autres fans sur le compte et c’est ce qui a permis à la page de prendre de l’ampleur. J’ai pris conscience de la puissance des réseaux sociaux. De chez moi, j’avais réussi à faire réagir Rafa, en l’occurrence son conseiller, Benito Perez-Barbadillo, qui gère son compte. Ce fut un vrai déclic.
C : La même année, tu parviens à développer un partenariat avec Babolat, le sponsor historique de Nadal…
R.D. : Babolat venait de sortir un nouveau modèle, la « Pure Aero ». J’avais vraiment envie de la tester alors j’ai envoyé un message à la marque. À ma grande surprise, Babolat m’a répondu directement sur Instagram. Ils m’ont d’abord envoyé la « Pure Strike » et m’ont également proposé d’autres produits. J’en fais la revue sur les réseaux sociaux et depuis on fonctionne comme ça. C’est du gagnant-gagnant. Je leur ai proposé aussi de faire gagner des produits sur ma page via différents jeux et concours.
C : Entre-temps, tu as pu rencontrer Rafael Nadal pour la toute première fois. Comment as-tu eu l’opportunité d’échanger avec lui ?
R.D. : C’était en avril 2017. J’étais à Monte-Carlo pour assister aux qualifications. Un proche qui travaillait dans un restaurant sur une plage de Monaco m’a contacté pour me dire que Rafa était là pour manger deux pizzas avant le début du tournoi. Alors je suis allé sur place. Il y avait toute son équipe qui était là. J’ai attendu qu’il finisse son repas pour aller l’aborder. J’ai été courageux car je lui ai demandé si on pouvait échanger quelques balles, alors que Benito n’aime pas qu’on ne passe pas par lui pour poser cette question. Rafa a répondu que ça se ferait le jour où je viendrais le voir à son académie. Bon, j’attends toujours, mais je comprends que cela soit compliqué. Je ne lui ai pas parlé de mon compte Instagram. C’était un peu long à expliquer et je savais que Rafa n’était pas très intéressé par les réseaux sociaux. Alors je suis allé à l’essentiel et surtout, je ne souhaitais pas trop le déranger.
C : Depuis, tu es allé dans son académie à Majorque et tu as pu le voir de nouveau…
R.D. : Pour mes 18 ans, mes parents m’ont offert comme cadeau un stage à la « Rafa Nadal Academy Super Camp ». Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais la semaine a été incroyable. Je connaissais déjà quelques personnes de l’académie, dont le directeur de la communication, Antonio Arenas. Un jour, alors que je venais de terminer de déjeuner, je reçois un message de sa part : « Viens à la réception. » Je le retrouve et il me dit de monter avec lui. On arrive en haut et j’aperçois Rafa et sa soeur, Maribel. J’ai pu les rencontrer en privé et échanger avec eux pendant cinq minutes. J’ai pu leur parler de mon compte et ils m’ont remercié. J’ai fait une photo avec Rafa et le fait de la poster sur ma page a permis de gagner en popularité et en crédibilité. C’est le moment fondateur de ma relation avec l’entourage de Rafa.
« En 2019, j’ai organisé un projet pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rafael Nadal. J’ai réuni plusieurs vidéos de fans du monde entier et j’ai publié une grande vidéo avec un message sympathique pour ses 33 ans. Je l’ai postée sur les réseaux sociaux sans réelle attente. Je suis allé en cours, et quand je suis sorti, vers midi, j’ai vu que j’avais reçu pleinde messages. C’était Rafa qui avait laissé un message sur la page pour remercier tout le monde. »