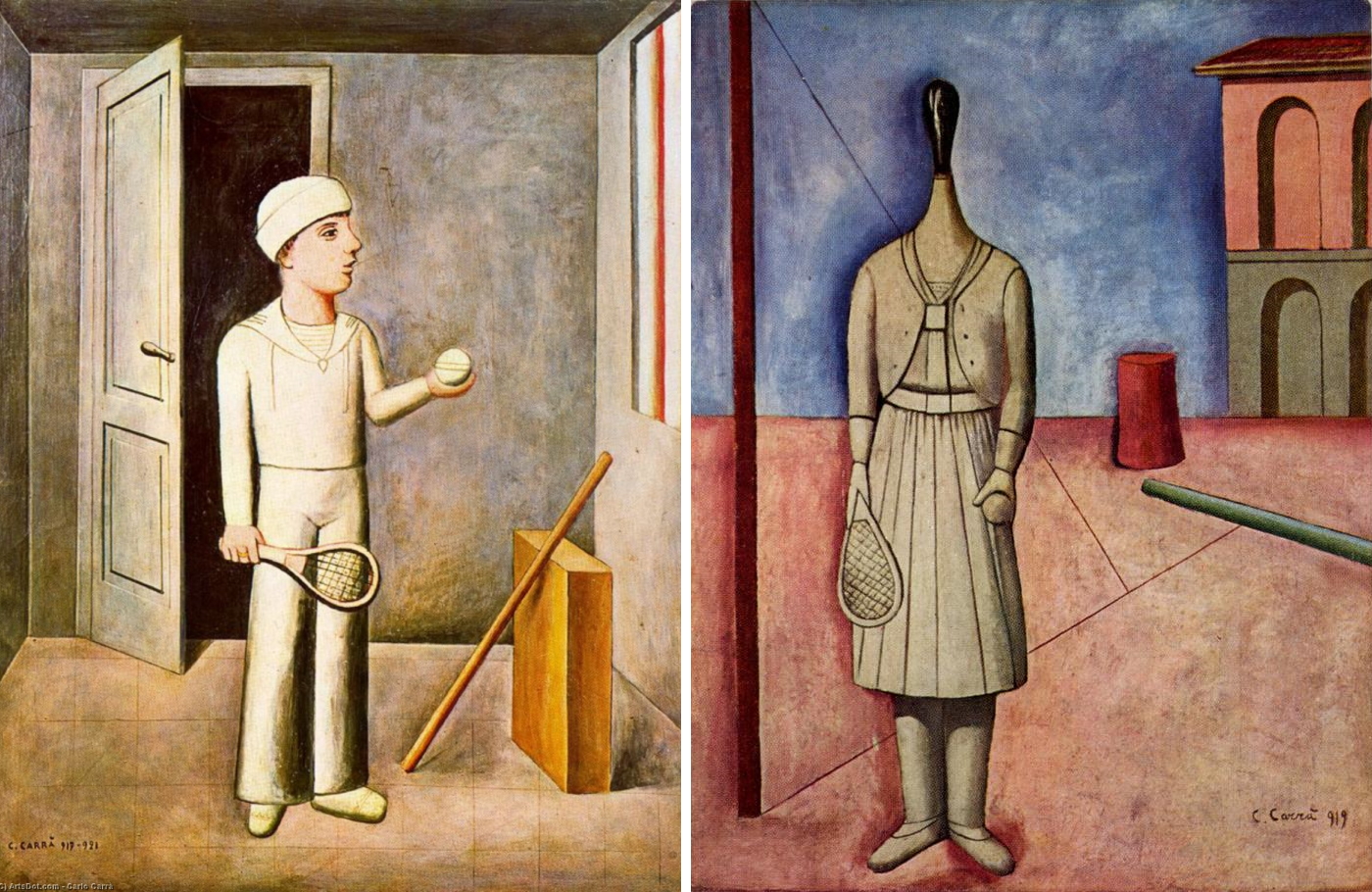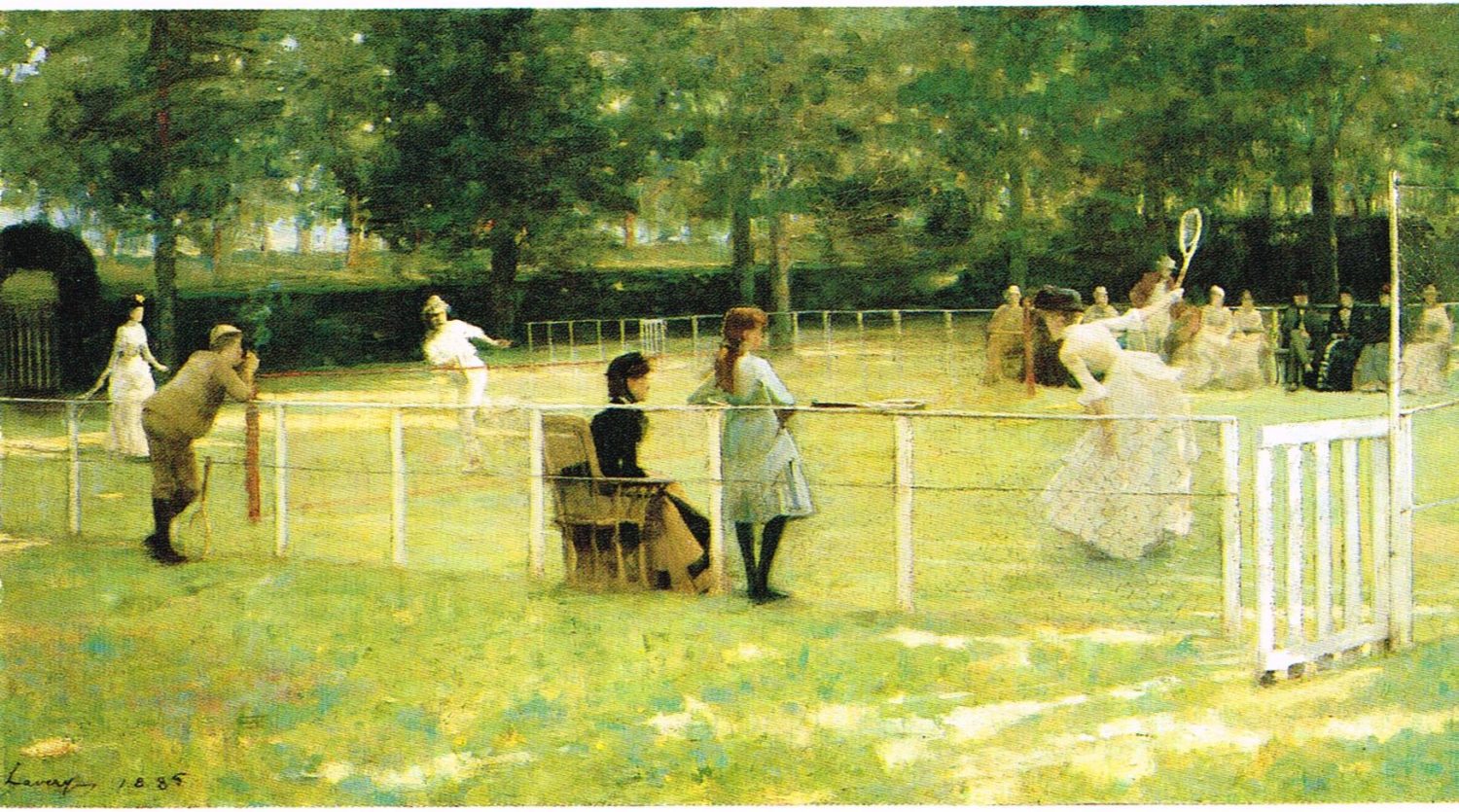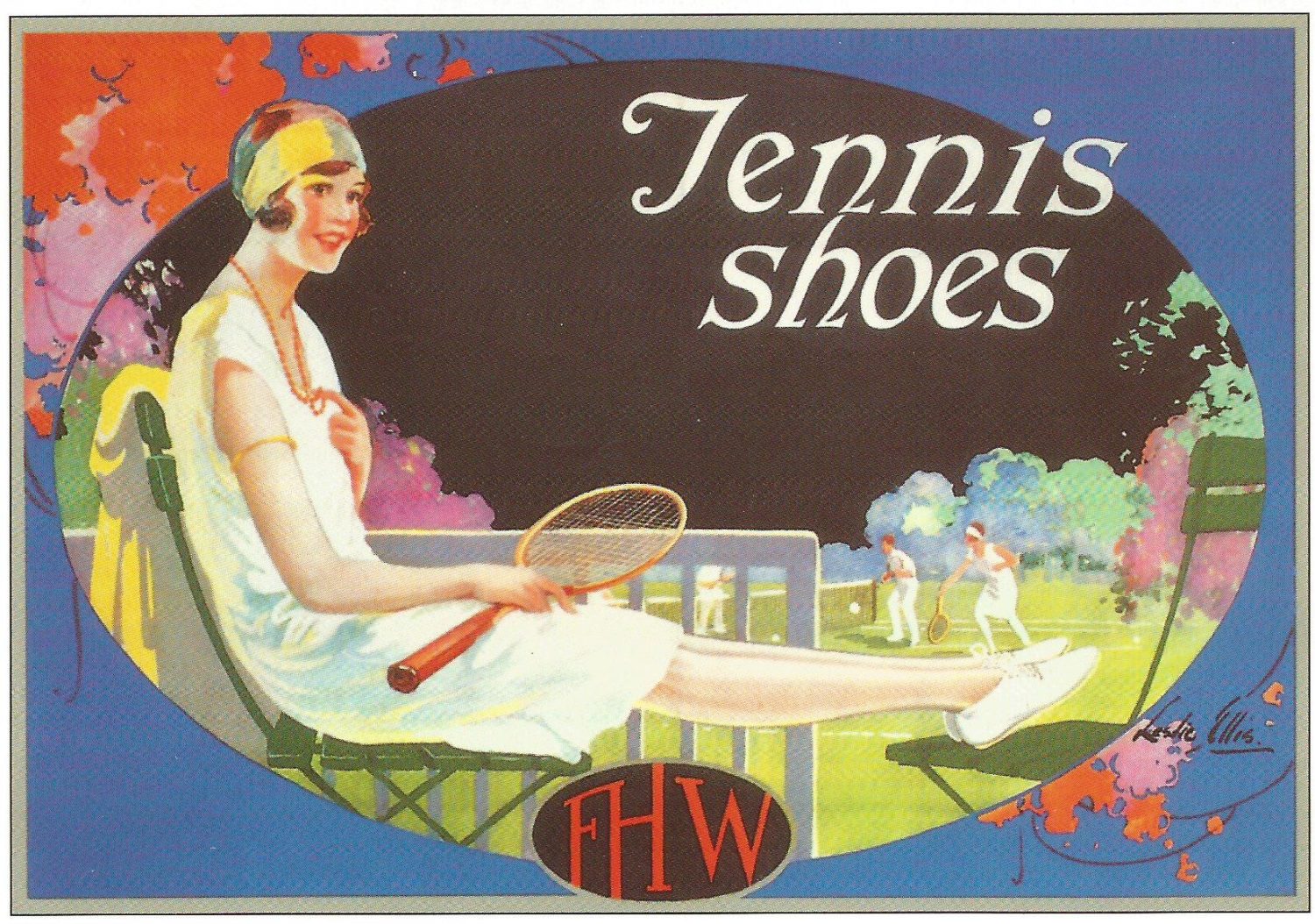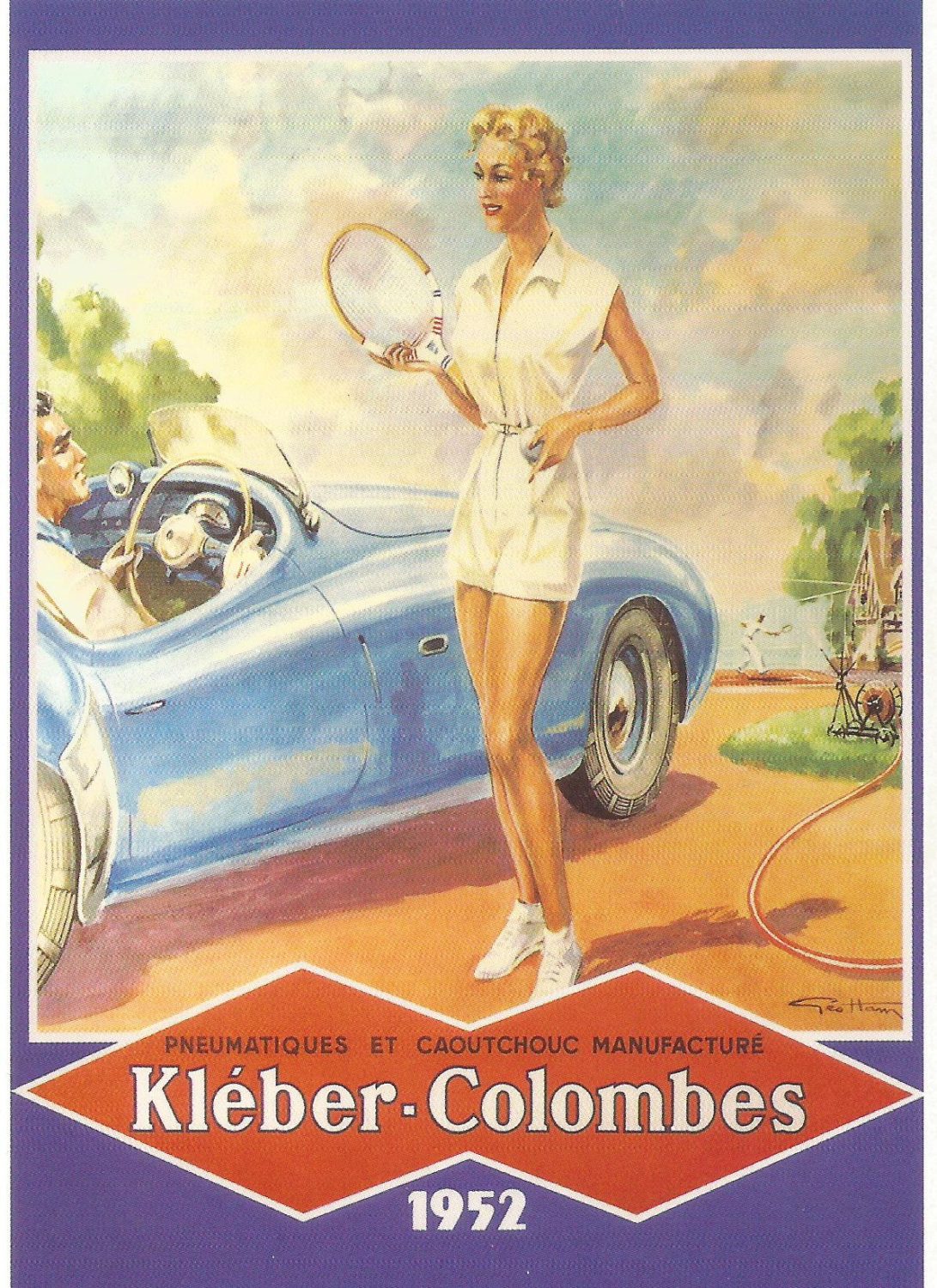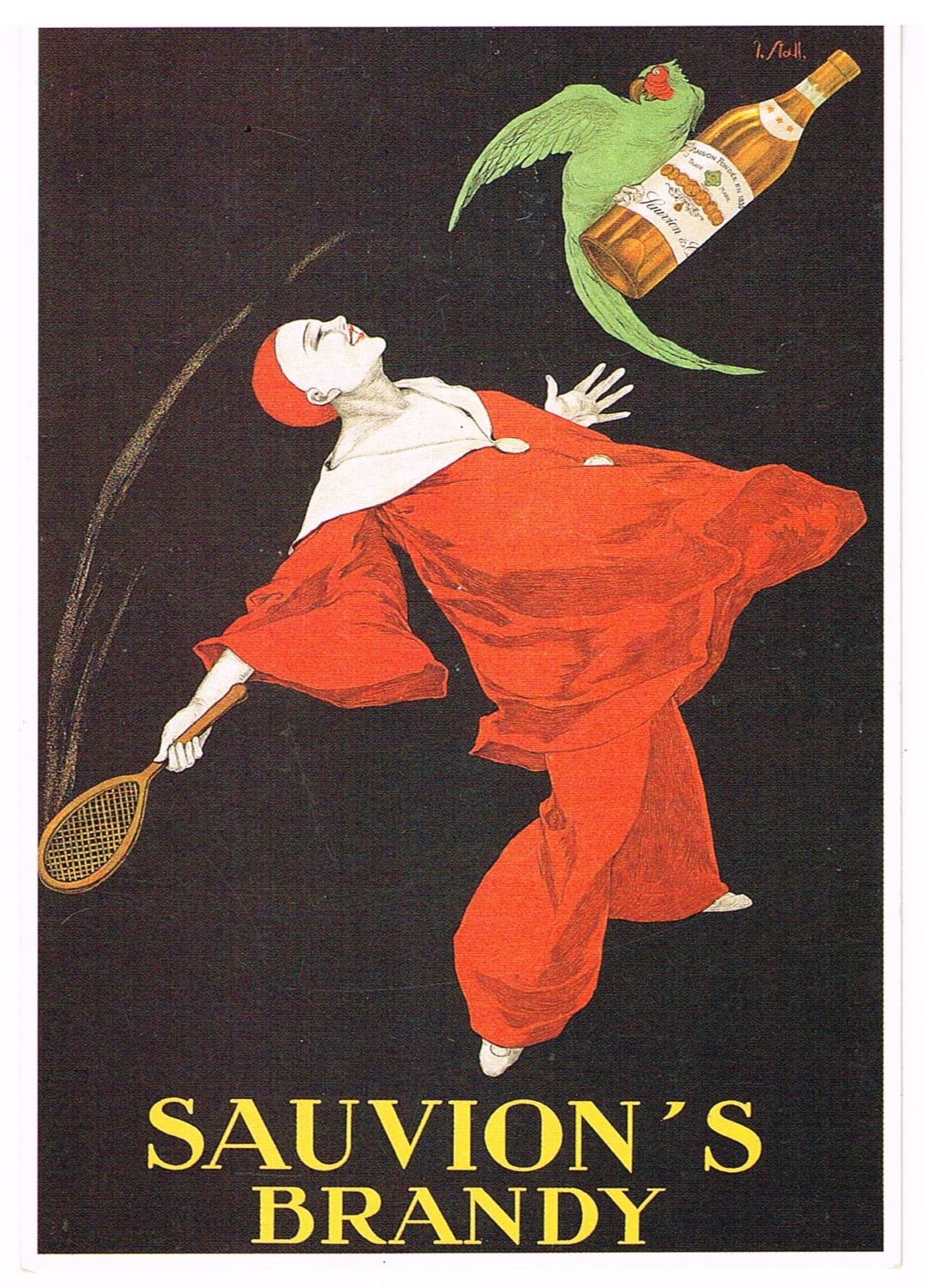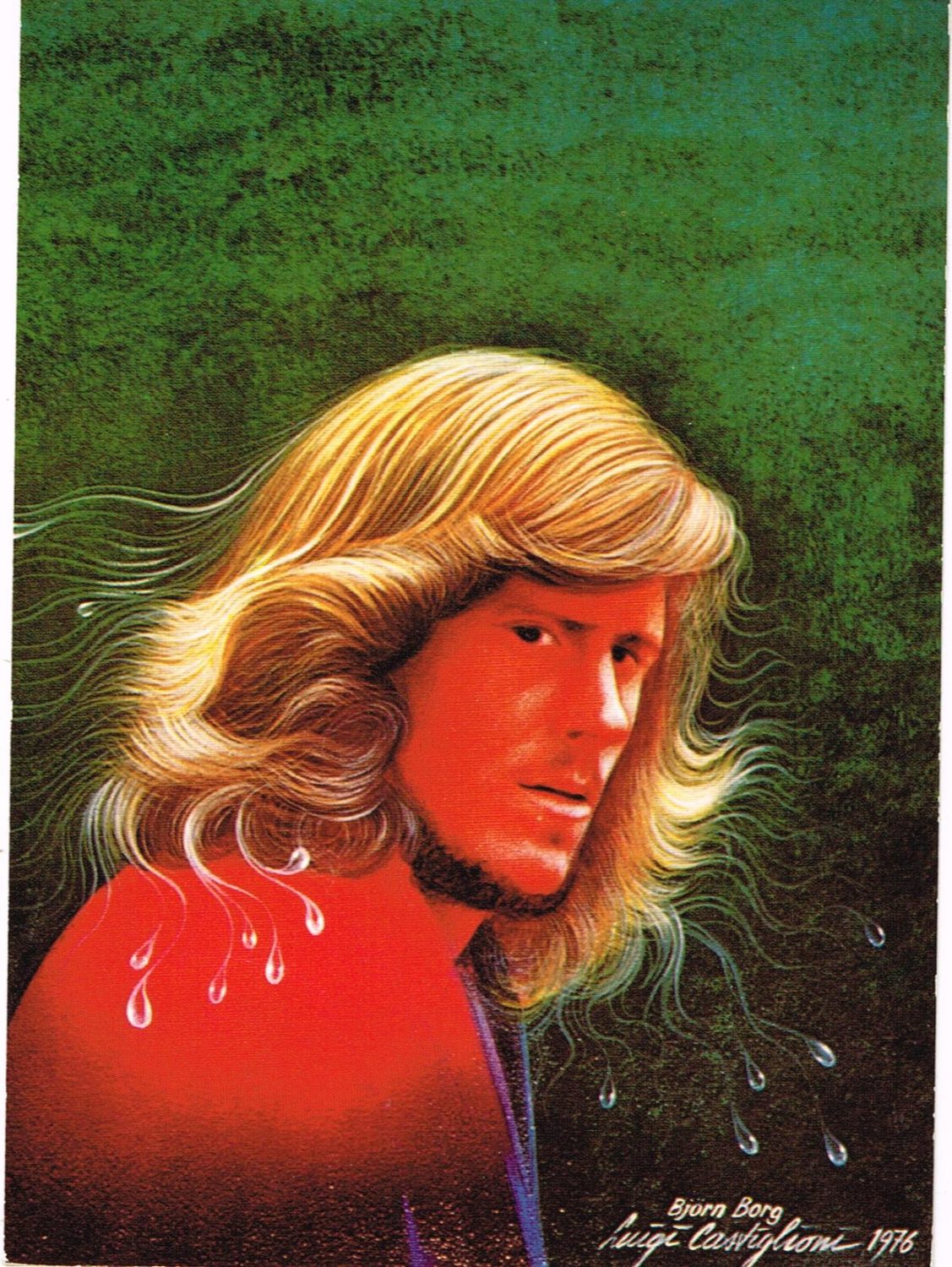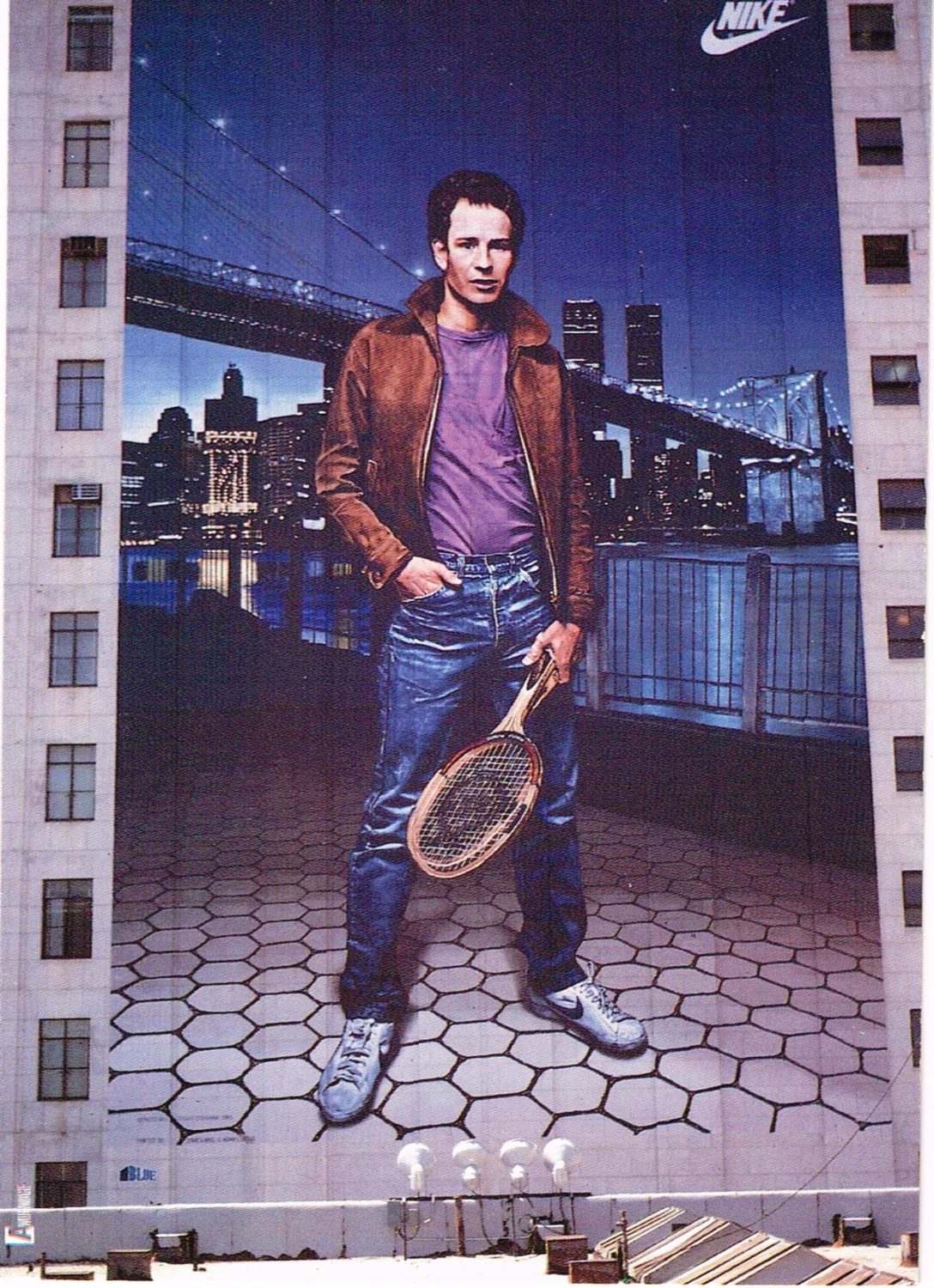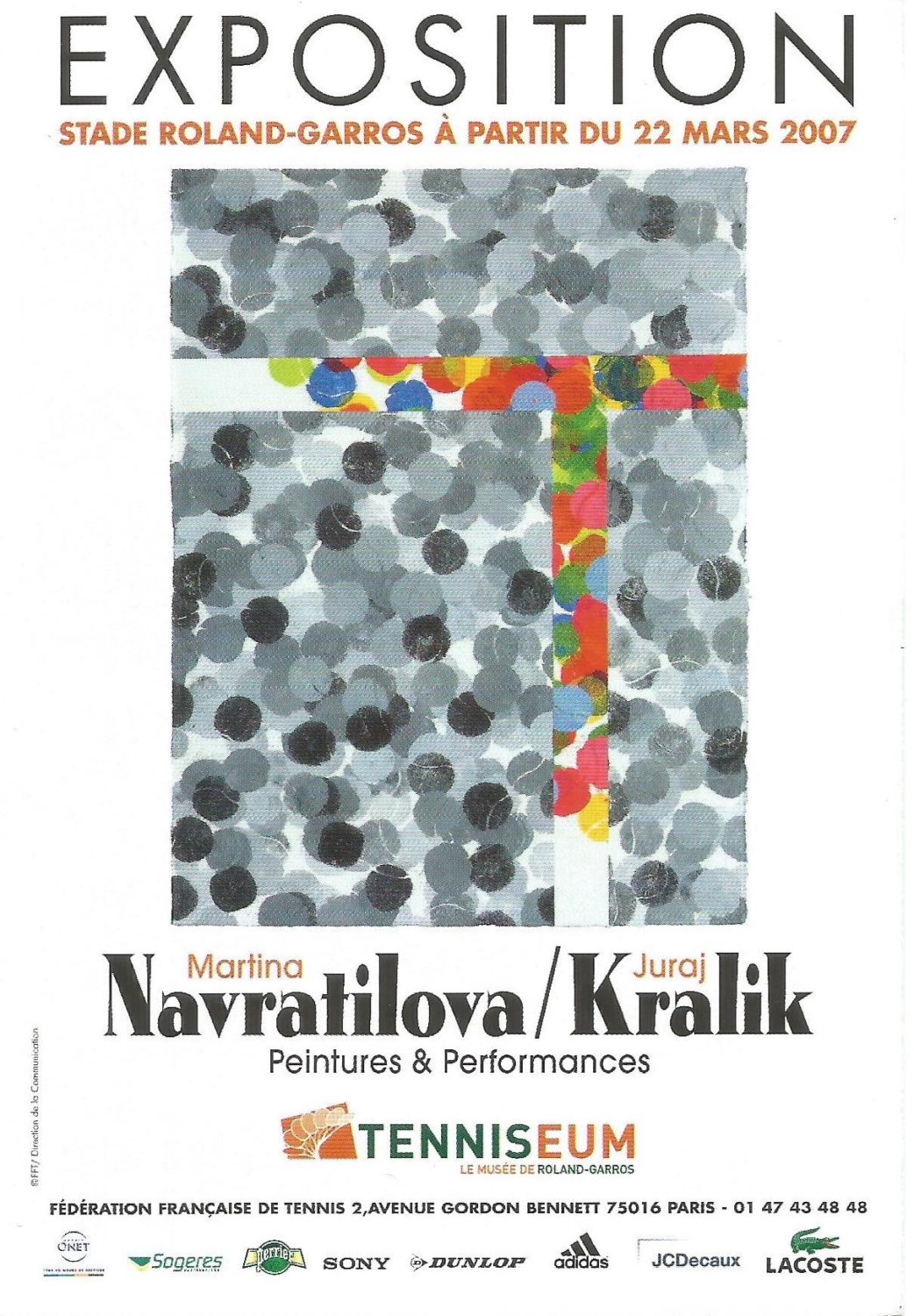Richard Gasquet, talent caché
Par Mathieu Canac

Le 18 mai, quatre jours avant Roland-Garros 2022, Richard Gasquet a sorti son autobiographie : À revers et contre tout. Racontant son histoire à Franck Ramella, qui l’a mise sur papier, le Français a notamment révélé à quel point il a toujours eu du mal à être le centre de l’attention. Ce qu’il a été après seulement quelques années d’existence, dès ses 7 ans.
« Richard Gasquet est un personnage de roman. »
Avec son sens de la formule, Franck Ramella, plume guidée par les récits de « Richie » pour rédiger son autobiographie, a résumé à merveille la vie de l’intéressé. Et elle a d’abord suivi les lignes d’un roman d’anticipation. Dès ses premiers pas dans le tennis, on a écrit la suite de son histoire : le prodige était né pour remporter un titre du Grand Chelem et devenir le successeur de Yannick Noah. « Richard G., 9 ans, le champion que la France attend ? », titrait Tennis Magazine en Une dès 1995, avec une photo d’un gamin haut comme trois pommes en pleine exécution d’un revers à la technique touchée par la grâce. Un don semblant tombé tout droit du ciel, comme offert par les divinités du tennis et censé faire de l’enfant de Sérignan leur envoyé sur Terre.
Seul hic, au fond, le génie n’aurait peut-être jamais souhaité sortir de sa lampe. Il aurait voulu rester chez lui. Dans son monde. « De trois à treize ans, j’ai passé toutes mes journées dans un périmètre de deux kilomètres carrés, a-t-il expliqué au cours du chapitre retraçant son enfance. Je n’ai rien fait d’autre, je ne voulais rien faire d’autre : PlayStation, stade (où il jouait au foot et au rugby avec les copains, ndlr), tennis, école. Très vite, après mes dix ans, j’ai dû partir disputer les championnats nationaux ou des compétitions internationales de jeunes. La plupart du temps, je ne m’y sentais pas bien. Je voulais rentrer le plus vite possible. Pourtant, il n’y avait aucune raison pour moi d’être mal à l’aise durant ces voyages : je ne perdais jamais chez les jeunes. »
« En 1999, je remporte les Petits As à Tarbes, la plus grande compétition internationale de jeunes, en battant un certain Rafael Nadal en quart de finale, a-t-il poursuivi. Après cette victoire, je me souviens m’être immédiatement dit : “Super, le tournoi est fini !” La suite, je n’en avais plus rien à faire. La seule chose qui m’importait, c’était de rentrer en voiture le soir même pour être sûr d’être au stade ou sur le court à Sérignan le lendemain. » De quoi donner, aussi, à son histoire, des similitudes avec un conte de fée. Celui du Petit Poucet. À l’instar du héros immortalisé par Charles Perrault, l’Héraultais a toujours voulu revenir à la maison. Mais plutôt que de laisser des cailloux blancs derrière lui, il a semé des revers immaculés partout où il passait. Un geste-signature qui a fait l’objet d’un chapitre. Obligatoire.
Le premier du livre, intitulé « Revers gagnant », et suivi de : « Paris Match, le poids des maux » – dans lequel est confié qu’en 2004, en plein désarroi, il a voulu tout arrêter et a demandé à son père de lui trouver un stage à Paris Match – « Sérignan », « Maryse et Francis (ses parents, ndlr) », « 2002, année de feu », « Mon Nadal à moi », « Oui, j’ai cru au titre du Grand Chelem », « Génération mousquetaires », « L’affaire », « Seb (Grosjean) et Sergi (Bruguera), juste un peu tard », « BIG 3, le mur », « Forget, Capitaine Fracasse », « La pire défaite de ma vie » – sur la défaite contre Roger Federer en finale de la Coupe Davis 2014 -, « Sarkozy – Noah, mes mentors de l’extrême », « Drôle de goût pour mon plus grand titre » – à propos de la Coupe Davis 2017 -, « Une vie de saltimbanque », « Jeune surdoué et senior avisé », « Ce qui m’a manqué n’est pas ce que vous croyez », « Moi, pas de mental ? » et « Aider le tennis français. »

« S’il y a un joueur qui peut presque légitimement se plaindre des médias, c’est Richard Gasquet »
« C’est plutôt moi qui a amené les sujets des chapitres au cours des entretiens, a détaillé Franck Ramella. L’éditeur (Stock) intervient dans certains choix, et il voulait, bien entendu, un chapitre sur le revers, ce qu’on aurait fait de toute façon. C’est à la fois un livre grand public, et un livre qui doit plaire et apprendre à ceux qui aiment Richard Gasquet. C’est aussi la difficulté de ce genre de chose, il faut être assez simple pour que ça intéresse les gens un peu nouveaux, tout en apprenant des trucs aux fans. Et j’ai pris le parti de ne pas raconter à nouveau des matchs, parce que je pense que ça ne sert à rien, sauf si le souvenir en est étincelant. L’idée était de se baser sur des périodes, puis les chapitres se déclinent. Par exemple, ça a été au fil de la discussion qu’on a vu qu’il avait des trucs à dire sur Forget. On a vraiment eu une liberté totale pour les chapitres. »
Journaliste à L’Équipe, où il est arrivé en 1989 en tant que secrétaire de rédaction stagiaire, Franck Ramella a toujours été un fondu de sport et d’écriture. Si, dès l’enfance, le petit Richard avait déjà du style grâce à ses figures de revers blanchissant les lignes, le jeune Franck noircissait celles de ses cahiers en travaillant des figures de style. « J’ai voulu travailler pour L’Équipe dès la 6e, a-t-il narré. Un pion me donnait le journal, je le lisais tous les jours alors que mes parents n’étaient pas du tout dans le sport. J’aimais ça, et j’aimais écrire. Je repérais des figures de style et j’essayais d’en faire – mais il ne faudrait pas les relire, c’était sûrement catastrophique (sourire). » Gasquet rêvait de jouer sur les plus grands courts du monde, Ramella de bosser pour le prestigieux quotidien. Les deux y sont parvenus.
Après avoir notamment traité de rugby et de foot, l’homme aux initiales inversées de Roger Federer est passé à la rubrique tennis – ce qui était son but – en 2005. « Le premier papier que j’ai fait, c’était un comparatif entre Tsonga qui venait de gagner un Challenger au Mexique, à León (le 3 avril), et Gasquet qui en avait remportés deux de suite en Italie, Barletta (le 27 mars) et Naples (le 3 avril), s’est-il remémoré. Puis, début avril, on m’envoie avec les envoyés spéciaux à Monte-Carlo pour me faire faire un tournoi test, que je voie comment ça se passe, pour apprendre. Et Richard Gasquet, c’est le premier que j’ai rencontré, chez son kiné, pendant qu’il se faisait masser. Il était redescendu au classement, après sa phase de crise en 2004, il avait un peu perdu sa cote de 2002 (de sa révélation, à 15 ans, en passant un tour à Monte-Carlo). Et pour mon premier tournoi, je vois des trucs insensés, et il bat Federer (alors numéro 1 mondial) ! »
« Donc il y a eu ce petit “feeling”, entre guillemets, a-t-il poursuivi. Mais après, ça n’a pas non plus été un long fleuve tranquille. Il y a eu des critiques, de la part d’autres et de moi, sur les matchs qu’on imaginait qu’il devait gagner. Parce qu’il éblouissait vraiment les gens, et pas que les Français, donc il y a eu une attraction. Forcément, qui dit attraction dit “doit” gagner à peu près tout, et il ne gagnait pas tout. Alors il nous envoyait quelques petites piques en conf’, à moi comme à d’autres, mais ça restait sympathique. Il n’est pas rancunier du tout. On avait un rapport journaliste-joueur, pas plus. S’il y a un joueur qui peut se plaindre presque légitimement d’un “dysfonctionnement” des médias, c’est Gasquet. Depuis tout jeune, il dû supporter ce poids d’un suivi constant. C’est celui qui a eu le plus de papiers à “mauvaises ondes”, on va dire. »

« Richard s’est ouvert, il voulait le faire, ce livre ! »
Avant de voir le jour, Richard Gasquet, à revers et contre tout, a d’abord germé dans la tête de Franck Ramella. Grâce à une graine plantée par son entourage. « On me disait : “Tiens, ce serait bien qu’il y ait un livre sur Gasquet”, a-t-il relaté. L’idée a maturé pendant longtemps. Je ne peux pas dire que nous avons des rapports privilégiés (avec Richard Gasquet), mais peut-être un chouia plus qu’avec certains dans le journal (L’Équipe). Je suis moi-même allé voir Richard : “Ce serait pas mal de faire un bouquin autour de toi, les gens m’en parlent, ça intéresse aussi des éditeurs.” C’était il y a un moment, à Madrid ,en 2016 ou 2017 je crois. Il m’avait répondu en temporisant, du style : “Pourquoi pas, mais là bof”. Je n’avais pas senti que c’était le rêve de sa vie à ce moment-là (rires) ! »
Avec le temps, le poids des ans pesant de plus en plus sur sa carrière de joueur, le « pourquoi pas » a muté en « allons-y ». Lors d’une vingtaine d’entretiens allant d’une à deux heures, Richard Gasquet a raconté son histoire. « 90 % du temps, on s’est vu dans son club, au Lagardère Paris Racing, dans le bois de Boulogne, a relaté Franck Ramella. Julien Cassaigne, son coach-agent, était là aussi et nous a bien aidés pour débloquer des souvenirs. Richard s’est ouvert, il voulait le faire, ce livre ! Il a vraiment été très, très, très disponible. Je n’ai eu aucun problème (pour les rendez-vous). Je ne citerai pas les sportifs, mais pour certains auteurs ça a été l’enfer absolu, au point d’abandonner en cours de route parce que ça devenait une galère insupportable. »
Au fil de son récit, s’il a soldé les comptes – avec les médias, Forget, Leconte -, le natif de Béziers n’a pas cherché à taper inutilement sur des têtes. Aucun nom de journaliste n’est cité, pas plus que celui la consommatrice de cocaïne embrassée lors de la « fameuse » soirée à Miami. Un instant de plaisir qui l’a plongé dans la période la plus dure de sa vie ; où il est devenu paranoïaque. « Il voulait vraiment que ce soit un livre qui résume sa carrière, propre, sans polémique, a révélé Franck Ramella. Ça, ça a tout de suite été clair. Même si tout le monde sait que pour vendre un livre il faut créer du buzz, dire du mal, et que mon mauvais esprit l’aurait peut-être souhaité (sourire). Mais en fait, non. On peut être fier que ce soit un livre qui ne tombe pas là-dedans, les critiques (de Gasquet) sont nobles, elles sont ce qu’il a ressenti. »
Loin d’être une star dans son attitude, discret en dehors du court, le natif de Béziers n’a pas cherché à se fabriquer des projecteurs pour se mettre faussement sous un meilleur jour. « Il n’aime pas du tout se mettre en scène, à révélé celui qui a transcrit ses paroles. Je crois qu’il est un peu “maso” (sourire). Souvent, on n’aime bien se mettre en valeur, lui, il faut qu’il se force pour ça. Il parlait plus facilement de ses tourments, de sa pire défaite, que de ses réussites. » Sans doute parce que c’est ancré en lui. Depuis l’époque du cartable et des bonbons qu’on payait en francs, il n’a jamais voulu être le centre de l’attention. Il a toujours été mal à l’aise avec ça.

« Je n’aimais pas ces yeux braqués sur moi. Je ne voulais pas qu’on sache que je jouais au tennis » – Richard Gasquet
« Je faisais le spectacle depuis mes sept ans, a rappelé Gasquet dans l’autobiographie. Chaque fois que je jouais dans un club pour un tournoi, on pouvait compter deux cents personnes autour du court. Je n’aimais pas ces yeux braqués sur moi. À l’extérieur, je n’avais pas envie qu’on sache que je jouais au tennis, et que j’y étais bon. En primaire, Okapi était venu faire un article sur moi dans la classe ! Un moment très gênant, surtout lors de la séance de photos : j’avais l’impression d’être un phénomène de foire. » Et les années ne sont pas parvenues à gommer ce trait de caractère, tracé au marqueur indélébile dans son ADN. Lorsqu’il s’est vu, à la grande surprise de sa famille et de lui-même, en couverture de Tennis Magazine à neuf ans, il a eu « honte ».
« Qu’est-ce que je faisais là, à la place que Boris Becker – sextuple vainqueur en Grand Chelem – avait occupée un mois plus tôt ? », a-t-il alors pensé. Quelques années plus tard, il s’est même mis à développer des stratagèmes pour tenter de rester dans l’ombre. « Au collège, j’avais été exempté d’EPS pour pouvoir me consacrer au tennis, a-t-il dévoilé. Quand ma classe partait faire cette heure de sport, elle passait par un chemin qui surplombait le court. Je les voyais tous arriver, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me dérangeait. Je n’avais pas envie de les voir, pas envie qu’ils me voient. Alors j’allais systématiquement aux toilettes à ce moment-là. Je me cachais ! Et j’attendais que la classe soit loin pour reprendre l’entraînement. Je faisais tout pour que l’on en sache le moins possible. »
Parmi les heures de discussions, cette anecdote a été celle qui a le plus marqué son confident littéraire. « Ce n’est pas surprenant par rapport à sa personnalité, mais par l’ampleur du détail, a décrypté Franck Ramella. Normalement, quand on est petit, on est super fier de montrer aux autres qu’on est très bon dans un domaine, pour plaire aux copains, voire aux filles. Lui, il allait se cacher. Quand on y réfléchit bien, c’est sidérant. C’est incroyable. Il ne voulait même pas qu’on sache qu’il jouait au tennis. Un autre truc incroyable, c’est ce qu’il dit sur son service. » Parmi les faiblesses reconnues au détour des 283 pages, ce qui lui a manqué pour s’offrir une carrière encore plus brillante, le joueur à l’accent du Sud a notamment pointé du doigt sa mise en jeu.
« Mon vrai problème, c’est le service, a-t-il confessé. (…) Je ne dois pas me cacher derrière une affaire de gabarit. (…) Beaucoup de joueurs au physique similaire au mien ont réussi à servir de manière plus agressive. Non, ce qui m’a manqué, c’est la volonté de progresser sur ce coup-là. (…) La vraie raison reste que cela m’a toujours royalement ennuyé, d’aligner des gammes de service à l’entraînement. (…) Je me suis toujours régalé à faire des points, à travailler l’adversaire, comme dans un jeu d’échecs. (…) Un bon service, c’est l’antithèse d’un long échange ; le travailler davantage, ç’aurait été, sans doute, me priver des occasions de lancer des rallyes. J’aime tellement le tennis que je me suis peut-être, en me limitant dans ce domaine, inconsciemment freiné dans mon ascension. » Malgré ça, il est allé très haut. Jusqu’au 7e rang mondial, et trois fois en demi-finale de Grand Chelem.
« Tout le monde dit qu’il a raté un truc, comme Monfils, Simon, Tsonga, mais au fond qui sommes-nous pour dire ça alors qu’ils ont été au sommet de leur sport ?, a analysé Franck Ramella. L’une de mes motivations pour l’aider à faire ce livre, c’était de raconter une autre manière d’être un champion. Parce qu’il en est un. »