The Art of Tennis
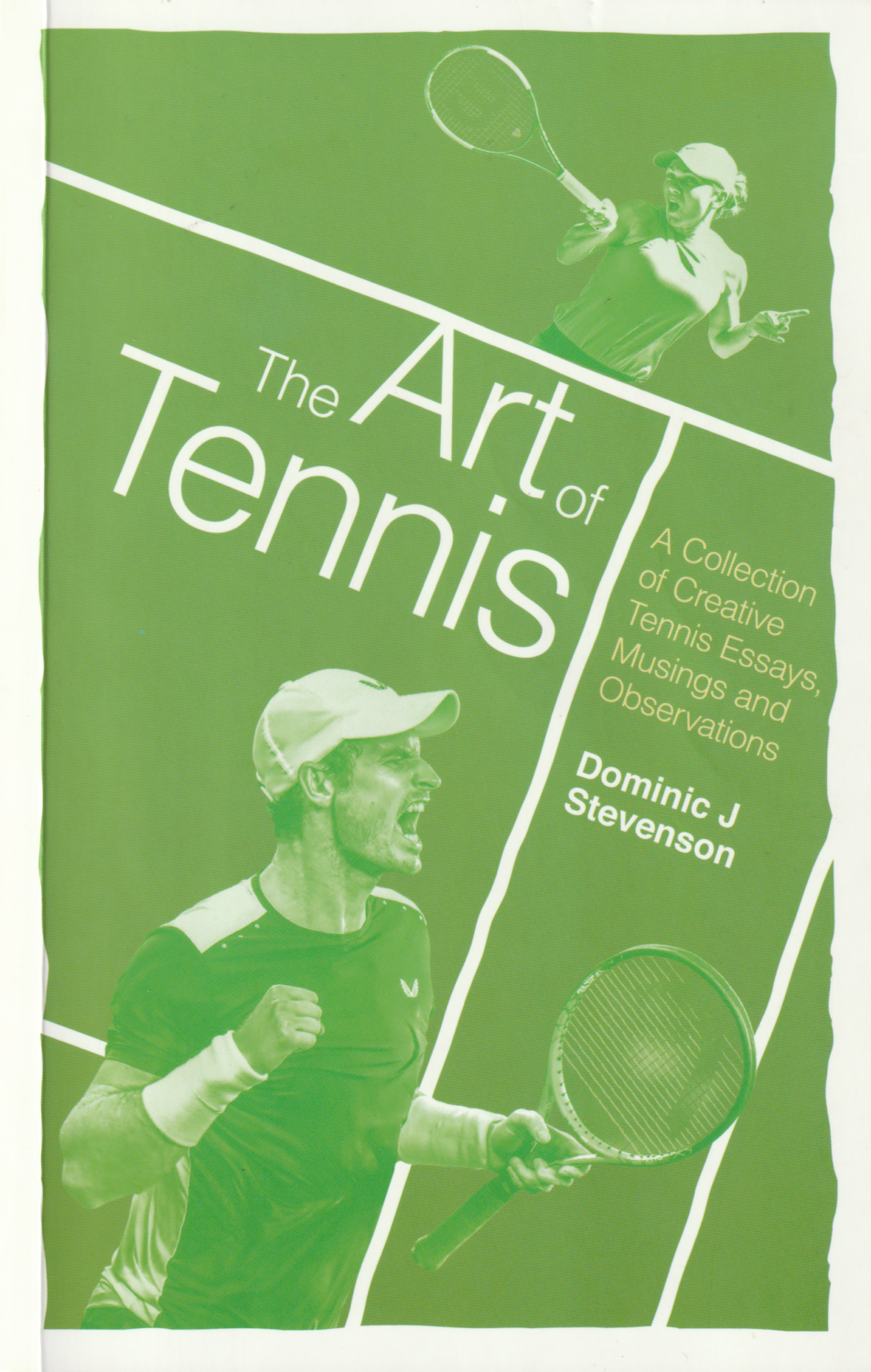
« Pour rendre justice au tennis il ne faut pas regarder ce sport à la télévision. C’est un jeu magnifique, absolument unique, il mérite d’être vu autrement que sur un écran. Dans une perspective plus nuancée. Il faut une meilleure dimension pour saisir toutes ses facettes. »
Le tennis a souvent été défini comme un art. L’écriture originale de Dominic J. Stevenson lui rend aujourd’hui un bel hommage. Nicolas de Staël « peignait dans l’urgence », comme s’il pressentait que le temps lui manquerait pour achever son œuvre. Stevenson, lui, joue avec l’art du temps, passé et présent. Il peint le tennis d’un seul coup de plume. Il surprend et brosse la balle qui reste sans cesse en mouvement. Les mots jaillissent, précis et poétiques. Ils s’animent et nous parlent. Les images surviennent, elles nous transportent dans un monde vivant et coloré. Le monde magique de Wimbledon, édition 2017, mais aussi celui de l’US Open en 2018.
On y contemple les grands, les très grands, les blessés et les aspirants, les disparus, les bannis, les revenants. Des chapitres serrés qui défilent vertigineusement, sur les chapeaux de roue. D’une étape à l’autre, les tournants du livre s’enchaînent sur un tracé balisé avec soin, pour nous permettre de rouler de plus en plus vite. On se croirait sur d’étroites routes de montagne. Des lacets, des montées et puis des descentes à pic. Le frisson des passagers est garanti. Le ciel se dégage et on baisse les vitres de cette vrombissante décapotable ; ça y est, il fait bon, nous sommes lancés dans la course. La belle anglaise nous propulse à toute vitesse dans les coulisses du circuit. Il ne s’agit pas de Formule 1, des 24 heures du Mans ou du Grand Prix d’Estoril. À l’arrivée, c’est Wimbledon et sa légende intemporelle. Un lieu incontournable, chargé d’histoire. Une institution nationale.
On s’y arrête volontiers pour goûter ses fraises à la crème, les caprices du printemps anglais. L’élégante blancheur de la tenue des joueurs, les mises excentriques des Britanniques. Mais aussi les queues inlassables et ordonnées d’un public flegmatique. Bref, la majesté théâtrale d’une parfaite représentation. Le charme opère et continue à nous séduire. Il propose chaque année à des milliers de spectateurs des émotions uniques, des souvenirs impérissables. Les tournois passent, Wimbledon reste, depuis presque 150 ans.
À peine le temps de respirer le gazon anglo-saxon d’un parterre royal qui aligne tous les espoirs et les faux bonds : « Incroyable, le nombre de grands joueurs blessés, hors service jusqu’en 2018. Comme si on disait maintenant à Nadal et Federer, allez-y, foncez, la voie est libre… »
Rufus le faucon prend de la hauteur et s’envole symboliquement au-dessus de nos têtes. Il déploie ses grandes ailes et plane. Lui aussi veut profiter du spectacle. Des gens, du bruit, des balles de match. Du haut du ciel, il repère une vieille dame très digne. À l’insu du public, ils échangent gracieusement des signes de politesse. Elle l’inspire et lui veut du bien. Il plane encore. Treize jours de tennis ininterrompu sans un seul tie-break final. Ça évoque le combat interminable de Nicolas Mahut contre John Isner en 2010. Une chevauchée fantastique conclue à 70-68. Trois jours de démence.
Ici, à Wimbledon, les temps modernes n’auront pas raison de toutes les traditions. Mais il aura bien fallu poser un toit sur le court central, et même des lumières, pour permettre au jeu de continuer à la tombée de la nuit. Un peu comme si on avait voulu éclairer l’obscurité par un gigantesque feu d’artifice. Une illusion de plus offerte aux spectateurs avec, en prime, l’installation de l’œil magique, le hawk-eye, pour revoir les points litigieux et ne pas sembler trop ringard. Mais pas question de rivaliser avec les fans de football et la cacophonie de leurs stades, bruyants et tumultueux. Il ne s’agit pas tout à fait du même sport. Question d’étiquette, noblesse oblige. Surtout à Wimbledon.
Notre voyage au bout du tennis et de son art reprend. Cette fois, au ralenti et en train, pour profiter des places restées libres dans les compartiments et prendre le temps d’admirer le paysage. Plus que la destination finale, c’est l’itinéraire et les gens qu’on croise en chemin qui retiennent notre attention. L’Argentin Juan Martin del Potro voyage avec nous en première classe. Un gentleman comme on n’en fait plus. Il revient d’une longue traversée du désert qui lui a valu bon nombre de coups et de blessures au classement ATP. Peu importe, il prouve à tous de quel bois il se chauffe. Il a l’âme d’un guerrier. Sa place est au paradis, parmi les meilleurs. Sloane Stephens, Petra Kvitova et Madison Keys le rejoignent. Maria Sharapova aussi. Elles reviennent en grande forme, toujours éblouissantes, même après des moments difficiles. Le train roule doucement. Les voyageurs ferment les yeux.
En rêve. Un joueur apparaît, s’apprête à servir. Il fait rebondir au sol plusieurs fois la balle, longtemps, un peu comme Novak Djokovic. Il la lance, décide de ne pas la jouer et la récupère. Une technique éprouvée pour déstabiliser un adversaire qui s’impatiente ou un simple mauvais lancer ? Faute de concentration ou mauvais geste ? Difficile à déchiffrer. Très difficile de distinguer le vrai du faux, l’essentiel du superflu, dans le rituel des tics et des manies rigoureusement observé par les astres du tennis. Stevenson en est conscient. Il apprend au lecteur à mieux observer. Il trace la marche à suivre pour ne pas s’égarer. Le train du livre s’arrête quelques instants, presque en bout de course. Encore quelques pages. Le temps de récupérer notre souffle et nos esprits. Toujours pas un seul nuage à l’horizon. Ça y est, nous sommes à la fin du voyage. Terminus. Personne ne siffle, tout le monde descend et attend la suite avec impatience.
Dominic J. Stevenson est un écrivain anglais originaire de Nottingham. Ce premier volume de The Art of Tennis illustre sa passion pour l’écriture et le sport. Sans raquette ni cordage, sa plume glisse au fil des pages, dans un style naturel et dégagé. Une prose musicale, à lire absolument dans sa version originale. La fiction et la réalité s’y accordent sur un ensemble de notes colorées. Un tableau très vivant, difficile à traduire en français. À suivre de près. Désormais, Stevenson vit et travaille en Allemagne. Il est l’auteur d’une trilogie : The Guerilla Punk Writer, et d’un ouvrage sur la Coupe du monde de football 2018.
Article publié dans COURTS n° 6, automne 2019.