Panatta regardait le ciel
Notes sur le tennis
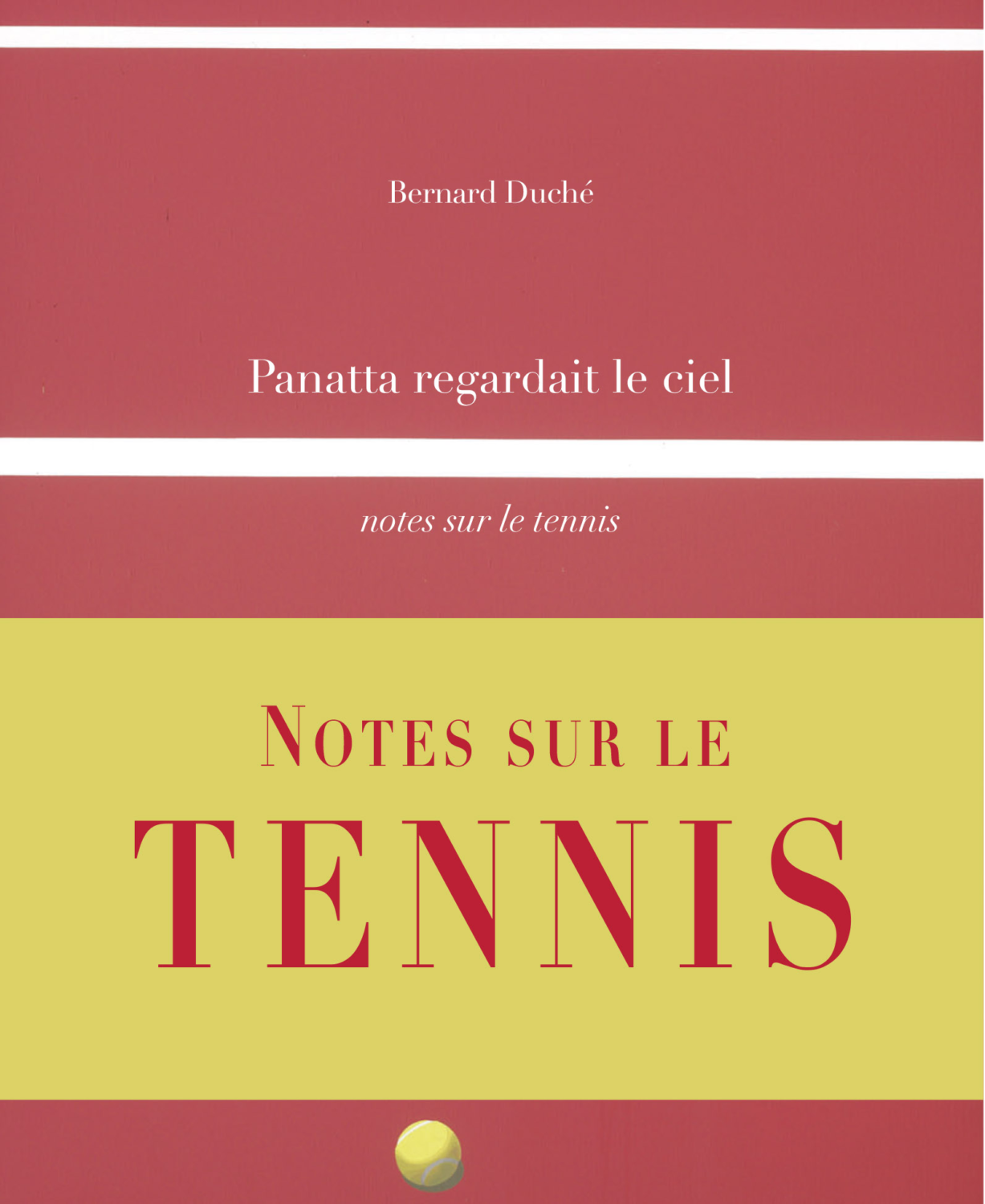
Le titre de ce billet a peut-être laissé les plus jeunes lecteurs un peu interloqués. Qui donc peut bien être ce Panatta levant les yeux au ciel ? La réponse est discrètement donnée en bas de couverture : il s’agit bien de tennis. Nous y voilà.
C’est un petit livre que nous a confié l’auteur, en guise d’amicale complicité. Dès les premières pages, le lecteur est sous le charme. Sur une toile de fond largement tennistique, on savoure un délicieux mélange, subtil et détonnant, de science, de philo et de poésie : cet écrivain éclectique à la plume alerte est tout à la fois médecin neurologue, jardinier passionné, mais aussi et surtout joueur et spectateur de tennis ardent d’un bon niveau.
Mais par où commencer ? Par le tennis, parbleu ! Premier service, c’est Panatta : inoubliable champion transalpin de la balle jaune. Il n’était ni philosophe ni poète, mais son tennis – seuls les aînés s’en souviennent encore – était souvent parsemé d’improbables coups de génie. C’était donc en cette fin d’après-midi du mercredi 9 juin 1976 que l’histoire tennistique de notre écrivain commence à s’écrire.
Avec un Last Minute, notre auteur s’est procuré un précieux billet, juste au-dessus des loges. Il croit rêver. C’était sa première participation en tant que spectateur aux Internationaux de France. On ne vous apprend rien, les petits détails ne sont jamais négligeables. Ainsi de Bernard Duché qui raconte sa méthodique installation au camp de base de Roland : « J’étais descendu à l’hôtel Poussin, un deux étoiles situé au bout de la rue du même nom à quelques pas de la porte d’Auteuil. Un emplacement stratégique ! »
Voici donc Panatta, tel qu’en lui-même en ses « fondamentaux » : il jouait à plat, pratiquant un somptueux jeu d’attaque « enrubanné d’amorties ciselées ». Notre écrivain est ébloui : « Quand il était entré dans le court, chemise vert foncé, short de l’époque qui conviendrait de nos jours à une péripatéticienne, je l’avais trouvé tragiquement beau. Luchino Visconti l’aurait connu, il aurait remplacé Alain Delon pour jouer Tancrède dans le Guépard ! Borg, qui suivait Panatta, n’aurait pas pu jouer dans le Guépard. Il manquait de romantisme, d’aristocratie. » Après une bataille dantesque avec le Borg de la belle époque, Adriano emportait la palme de haute lutte.
« Je me souviens »
C’est au joli livre intitulé Petite philosophie du tennis de Christophe Lamoure que Bernard Duché dit avoir emprunté la formule du « je me souviens » chère à Georges Perec. Histoire de réveiller de savoureuses anecdotes ponctuées de lieux, partenaires ou adversaires, jalonnant le parcours tennistique de notre écrivain.
Il se souvient ainsi de certains courts marqués d’une pierre blanche : Villa Primrose, Aviron Bayonnais et bien d’autres : « Je n’avais jamais vu jouer quelqu’un au tennis de cette façon, des pluies d’aces sur la première balle, et deuxième balle, des amorties surnaturelles mais sous un regard tellement ombrageux. »
Il se souvient aussi de Chantaco en 1975, « la terre battue onctueuse, douce, moelleuse » rappelant les courts de Roland-Garros. Ils étaient toujours aussi doux sous la semelle l’année suivante, lors du tournoi des familles. « Associé à mon père, raconte notre auteur, nous rencontrions Jacques Chaban-Delmas et son beau-fils Antoine. Arrive la balle de match pour nous, une balle flottante que mon père à la volée n’a plus qu’à pousser dans le terrain. Il met la balle dans le bas du filet, ce qui dans cette position est un exploit. J’entends encore son cri : Maman, qu’est-ce que tu as fait à ton fils ? Ça peut prendre une vie de répondre à cette question, Papa ! »
En manière de métaphore, l’auteur cite le beau titre de Stig Dagerman, écrivain suédois, mort à 31 ans : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et le même Bernard, l’écrivain, l’applique opportunément à son sujet : « Certains jours miraculeux, le geste simple, évidemment futile, de taper dans une balle jaune, nous rassasie. »
Au fil des pages, le lecteur pourra découvrir des « je me souviens » des plus cocasses qu’il faut déguster sans hâte, comme un vin de Loire frais et gouleyant. Difficile de résumer ces petites histoires, sous peine d’en perdre la saveur. Car ce Bernard Duché est un conteur plein de verve. Il faut donc choisir l’un ou l’autre, selon son humeur ou ses envies, dans le sommaire qui met déjà le lecteur en appétit ! J’en épingle quelques-uns, dont « La bonne décision » : « […] quand j’ai décidé, après avoir vu Stefan Edberg, de monter à la volée tous azimuts… Finis les accès de narcolepsie derrière la ligne de fond ! »
De cette époque où l’adversaire disait : « Bien joué, après un joli coup gagnant ou un ace. Désormais, dans le meilleur des cas, il lève les bras au ciel, souvent il fait un ajout verbal plutôt stéréotypé du genre “Putain, je suis nul à chier aujourd’hui !” » Toujours au Chantaco en 1975, un bon millésime pour le pittoresque mais « une défaite contre Jean-Jacques Chaban-Delmas (le fils de l’autre), peut-être à cause d’une très belle jeune fille, une Audrey Hepburn aux yeux verts qui m’avait déconcentré en fin de partie… »
Femmes
On aura vite compris que même en plein match sur la terre battue, notre auteur-joueur ne manquait guère de jeter un coup d’œil vers l’une ou l’autre jeune femme à la plaisante silhouette. Mais dans la tribune, comme spectateur assidu, il n’a pas oublié quelques grands noms des joueuses du firmament. Écoutez-le en parler : « Un souvenir télévisuel brûlant s’appelait Maria Bueno. J’aimais son physique de collégienne, cette façon de jouer si spontanée. » Est arrivée Evonne Goolagong qui « était l’incarnation même du poème de Keats : “La gloire tombe surtout folle d’un cœur insouciant” ». Elle a occupé ses pensées jusqu’au début des années 1980. Une seule infidélité, reconnaît notre auteur : « Virginia Wade. Elle avait une allure de princesse. Imposante tignasse noire, silhouette de Danaé, je l’imaginais déambulant dans Jermyn Street en tailleur Chanel… Elle gagna Wimbledon en 1977. »
Impossible de les évoquer toutes ! Les autres ne s’en désoleront pas trop. Au début de l’époque moderne, c’était Chris Evert, Martina Navratilova. « La première me terrifiait, dit notre chroniqueur, véritable incarnation d’une redoutable fille à tresses qui parlait en fermant les paupières. » Il y eut encore Steffi puis, au même moment, « tant pis je l’écris, dit-il, deux têtes à claques : la Seles et la Hingis ». Terminons en beauté avec ce florilège de cocardes tricolores : Amélie Mauresmo à Wimbledon en 2006. Il y était. Devant l’écran. « À pleurer tellement c’est beau. Une Française sur le green qui lève le Graal ! » Que dire d’un chroniqueur français à cet instant ? Pour Marion Bartoli, notre Bernard n’y était pas. Il lui demande pardon !
Épilogue
Je l’emprunte à l’auteur, il ne m’en voudra pas ! Il en a trouvé la trame dans un album solo, Conversations with Myself, d’un certain Bill Evans. Ai-je bien perçu cette nostalgie de l’auteur-joueur dont la lucidité semble lui avoir dicté de ranger ses raquettes sans se retourner. Il cite Roland Barthes qui disait qu’il n’est « pays que de l’enfance ». Le court de tennis et sa terre rouge était ce pays. « Je l’ai perdu irrémédiablement et depuis, un vent glacial fouette mon visage. »
Article publié dans COURTS n° 9, automne 2020.