Laurent binet
« Mac, c’est du Picasso »
Par Franck Ramella

Goncourt du premier roman en 2010 avec HHhH, prix Interallié en 2015 avec la Septième Fonction du langage et auteur du récent Civilizations, Laurent Binet, 47 ans, s’est approprié avec passion son identité de volleyeur. Il s’est mis en scène en champion imaginaire face aux plus grands avant d’essayer de dompter sa propre patte gauche dans les tournois amateurs en se posant mille questions. Du tennis, il aime tout. Le récit épique qu’il engendre, le plaisir bestial qu’il procure, Mecir parce qu’il a fait son service militaire en Slovaquie, le dossier des deuxièmes balles, évidemment Federer mais surtout John McEnroe.
Courts : D’où vient cette passion ?
Laurent Binet : J’ai commencé à me passionner pour le tennis à partir de Roland-Garros 1984 (McEnroe – Lendl), même si j’avais suivi Noah vite fait en 1983. Je jouais surtout à la plage avec une balle en mousse. Et très vite je me suis intéressé à l’histoire du jeu, à remonter le temps. Et encore aujourd’hui, les périodes dont je me souviens le mieux en termes de palmarès ou de résultat, c’est en gros de 1981 à 89. Je prenais ma raquette, ma balle en mousse et je jouais sur le mur de ma chambre (il se lève et mime) toute la journée. Et quand j’ai progressé, c’était avec une vraie balle de tennis. Je ne sais plus qui était de l’autre côté du mur dans l’immeuble (sourire)… C’est comme ça que j’ai développé tout mon style de jeu, qui est complètement déséquilibré, où je suis devenu beaucoup plus fort à la volée qu’au fond de court. Je me racontais des histoires, ce n’étaient pas que des matchs, mais des carrières qui se déroulaient. J’arrivais sur le circuit, au début je perdais au premier tour contre Brian Gottfried, par exemple. Je perdais en trois sets, après je prenais un set quand même à l’US Open, je passais un tour. Je ne faisais que les tournois du Grand Chelem, mais ça prenait du temps ! Je passais une après-midi à me faire je ne sais pas combien de matchs… À la fin, je tapais Lendl, je finissais par gagner un ou deux Grands Chelems. Je ne perdais plus beaucoup. Je sautais, je plongeais, j’étais partout.
C : Vous êtes entré d’une certaine manière dans le monde imaginaire du tennis.
L.B. : Comme pour mes bouquins, il y avait toujours le lien entre l’imaginaire et le monde réel. Je suivais de près l’actualité. Les joueurs que j’affrontais, c’était Mel Purcell, des mecs sur le circuit, en fonction du résultat et du niveau. J’allais plus taper Edberg ou Wilander en finale, selon les surfaces. La base, quoi.
C : Avec un héros ?
L.B. : J’avais des modèles. J’ai adoré Connors quand il a commencé à décliner de 85 à 90, il perdait tout le temps en demi-finale. C’était mon Dieu. Nick Hornby l’explique très bien dans Fever Pitch, chez le supporter fan d’Arsenal : c’était beaucoup plus frustrant mais plus intéressant d’être fan d’Arsenal quand ils étaient en galère que quand ils se sont mis à tout gagner. Connors, c’est ça. Pendant quatre ans il n’a plus gagné un tournoi. Et je me souviens que lorsqu’il en a remporté un à nouveau, à Washington en 1988, ça avait été un kif pour moi !
C : Pourtant, ce n’était pas le plus sympa.
L.B. : C’est ce que tout le monde dit de l’intérieur. Noah a raconté qu’une fois, il s’était blessé lors d’un de leurs matchs, Connors était venu le relever, lui avait tapé sur l’épaule genre « ça va ? ». Toute la foule avait applaudi, mais pendant ce temps, il était allé dire à l’arbitre : « Y’a time, faudrait peut-être le disqualifier ! » Mais ça, le public ne l’entendait pas… De l’extérieur, il avait l’air trop sympa, il faisait des matchs mythiques. J’adorais. J’adorais Pat Cash aussi, parce qu’il avait un jeu de malade avec sa volée. Durant ces années 84-89, je me suis identifié aux serveurs-volleyeurs. Et McEnroe est devenu mon grand héros. Ce qui est intéressant dans notre rapport de fan, et de fan français, c’est le rapport à la défaite. Et McEnroe, pour moi, c’est Roland 84, pas les sept autres titres en Grand Chelem.

C : Dans le genre uchronie, un genre que vous appliquez dans votre dernier roman Civilizations, qu’est-ce qui aurait changé si McEnroe avait gagné en 1984 ?
L.B. : Il a dit quelque chose que j’ai eu du mal à comprendre : « Si j’avais gagné ce match en 1984, tout aurait changé dans ma vie. » Il veut dire que sa place dans l’histoire du jeu aurait été plus haute. C’était émouvant de l’entendre dire ça. Pour moi, il a tort, ça ne se joue pas à ça. Il a un titre de Grand Chelem de moins que Lendl, mais tout le monde s’en fout aujourd’hui. Mais ça le travaille. Ça dit quelque chose de la psyché de ces mecs. Pour en revenir à l’uchronie, son principe, c’est le point de bascule. Tu changes un détail, et toute l’histoire en est changé. Là, possiblement, c’est ce p… de Wimbledon 2019. En termes de différentiel en nombre de titres en Grand Chelem, c’est important ! Moi, je pense que Federer et Nadal vont finir ex-aequo à 20 ou 21. Enfin, c’est la part de moi fan de Federer qui l’espère (sourire).
C : On ne comprend plus. Pour vous, c’est Fed ou Mac ?
L.B. : Mon dieu absolu c’est McEnroe. Pour la gestuelle. Chez Federer, ses coups sont parfaits, tu ne peux pas optimiser, il n’y a rien à changer. Le plus gros ordinateur dans la biomécanique ne pourrait pas faire mieux que Federer. Au service, les mecs ont tous des petits tics, des parasites. Lui, non. Son geste de service est parfait parce qu’il est très simple, en fait. La beauté de la chose chez Federer, c’est le relâchement.
Mais McEnroe, son service dos au filet… Deleuze disait « un service d’Égyptien ». Mac, c’est de l’art, c’est comme un beau tableau, l’originalité que tu auras dans un très beau tableau, c’est du Picasso. Le fait qu’il volleye debout, aussi. Esthétiquement, il n’y rien qui me parle plus que McEnroe. Avec la mythologie en fond de celui qui n’a jamais fait un footing avant 30 ans… Et puis j’ai découvert le tennis avec lui, un truc d’enfance, le « McEnroe Tacchini ».
C : C’est toujours marrant de comparer les époques.
L.B. : Lucas Pouille disait un truc intéressant : « Je regarde les vieilles vidéos d’Edberg ou de Rafter parce qu’à la volée, on n’a pas tellement progressé. » Certains « anciens » restent les meilleurs. Regardez le deuxième service. J’en discute souvent avec mes amis joueurs, et en deuxième balle, personne n’a fait mieux que Sampras. Là-dessus, Federer est moins fort que lui. La deuxième balle, c’est un vaste dossier ! Même au plus haut niveau, il y a des mecs qui sont sûrs, d’autres non. Federer ou Nadal font rarement des doubles dans les moments importants. Djokovic, il en fait. Dimitrov ou Kyrgios sont capables d’en faire quatre de suite. Moi, je lutte depuis toujours, je n’ai jamais réussi à assurer ma deuxième balle. Au niveau des sensations, ce n’est pas comme un revers chopé ou une volée où je ne me pose aucune question. Le service, c’est justement le moment où tu te poses des questions. Tu es seul avec toi-même. La volée, l’avantage, c’est que tu n’as pas le temps de penser. C’est du réflexe.
C : Vous avez l’air de tout analyser.
L.B. : J’analyse à mort, probablement trop. Ce qui m’impressionne le plus, outre la qualité du jeu qui est phénoménale, c’est le mental des joueurs. Le mental de Nadal, c’est unique. Les mecs forts, qui dominent leur peur dans les moments importants, qui se supassent, il y en a plein. Mais Nadal, c’est autre chose. J’ai l’impression qu’il ne connaît pas la peur. Il est dans un autre débat.
C : Il peut donner l’impression d’avoir peur de ne jamais être sûr de gagner quel que soit l’adversaire en face, et qu’il se réfugie dans les cadences infernales ou les tics pour surmonter certaines craintes.
L.B. : Je n’analyse pas ça comme ça. En fait, il ne se pose pas la question. Que ce soit le 1er tour contre un Ouzbek ou en finale contre Federer, il a le même état d’esprit. Il arrive à se concentrer sur chaque point en faisant abstraction de tout le reste, du match, du set, du jeu, du tournoi, de l’adversaire. Il joue chaque point comme si sa vie en dépendait, c’est un truc de dingue ! C’est un cliché de parler de « machine » pour ces mecs. Mais Djoko, ce n’est pas une machine. Federer, ce n’est pas machine. Nadal… Lendl, on disait que c’était une machine. Mais pas du tout. Il avait des problèmes contre les petits joueurs, par orgueil. Et moi, c’est ce que je me dis quand je rencontre quelqu’un qui a deux classements de moins que moi. Je me dis : « Mais qu’est-ce que je fous à galérer contre un nul. » Lendl était là-dedans. Nadal n’a jamais été là-dedans. C’est comme aux échecs si tu joues Deep Blue (un ordinateur), il ne sera jamais déstabilisé, il n’accusera jamais le coup. Nadal, il joue son point, il gagne ou perd, hop ! il passe au suivant. Ça, c’est fort. Federer, c’est encore autre chose. Oui, sa résilience après sa dernière finale à Wimbledon pour revenir alors que tout le monde ne lui parle que de ça, c’est génial. On voit bien qu’il est passé à autre chose. Mais ça reste humain. Nadal a quelque chose d’inhumain. Il y a juste son revers slicé… On sent que le coup, il ne l’a pas compris. Il lutte, il se casse le buste à chaque fois, tu sens qu’il galère, mais ça passe quand même.
C : Pour nous les très humains, jouer au tennis en compétition relève souvent du calvaire à cause du manque d’assurance technique.
L.B. : Il faut faire gaffe à ça. Un jour, j’avais comme adversaire un mec marrant, un peu âgé. Je lui avais dit : « Il ne faut pas oublier de prendre du plaisir, on est tout le temps dans la frustration. » Et il m’avait répondu cette phrase géniale : « Oh tu sais moi, ça fait très longtemps que je ne prends plus de plaisir sur un court ! » Le tennis, c’est comme une drogue, tu continues à jouer, mais…
C : Mais quoi ?
L.B. : Ça sert pour le corps et l’esprit. Réaliser un beau coup bien exécuté, c’est une vraie jouissance corporelle. Tu sens tout ton corps, l’équilibre. C’est ce plaisir-là que tu recherches. Cette gratification, tu l’as toujours, même un jour où tu fais un match de merde, il y a quand même deux ou trois coups où tu vas te sentir bien. Ce moment-là, c’est un truc qui inonde tout ton corps. Il y a quelque chose d’un peu sexuel. Le plaisir, tu l’as avant la frappe, pendant, et après. Tu sens que le processus s’est mis en place, tu sais que la balle va aller où tu veux. Et après l’impact, tu vois le résultat et tu te dis : « C’est moi qui ai fait ça ?! » On fait des coups de pro, c’est intéressant. Quelqu’un avait croisé un jour Agassi et lui avait dit : « Vous savez, Monsieur Agassi, une fois sur cent je fais un coup droit comme vous. » Et Agassi avait répondu : « Ouais, moi c’est cent fois sur cent ! » C’est ce qui génère aussi la frustration. Tu te dis : « Si je l’ai fait une fois, pourquoi je ne peux pas le refaire ? » Mais la sensation que tu ressens relève de la magie, tu as un moment de grâce, tout se met en place et Bam ! Ace ! Mais il y trop de micro-détails pour le rééditer. Ce qui fascine, c’est cette capacité chez les pros à reproduire cet « exceptionnel ». Il y avait une stat géniale pour Federer. À 0-40 contre lui, l’adversaire n’en est que juste au début. Il a plus de 30 % de chances de gagner le jeu… Tu mènes 0-40 contre Federer, en fait, tu as peur (rires).
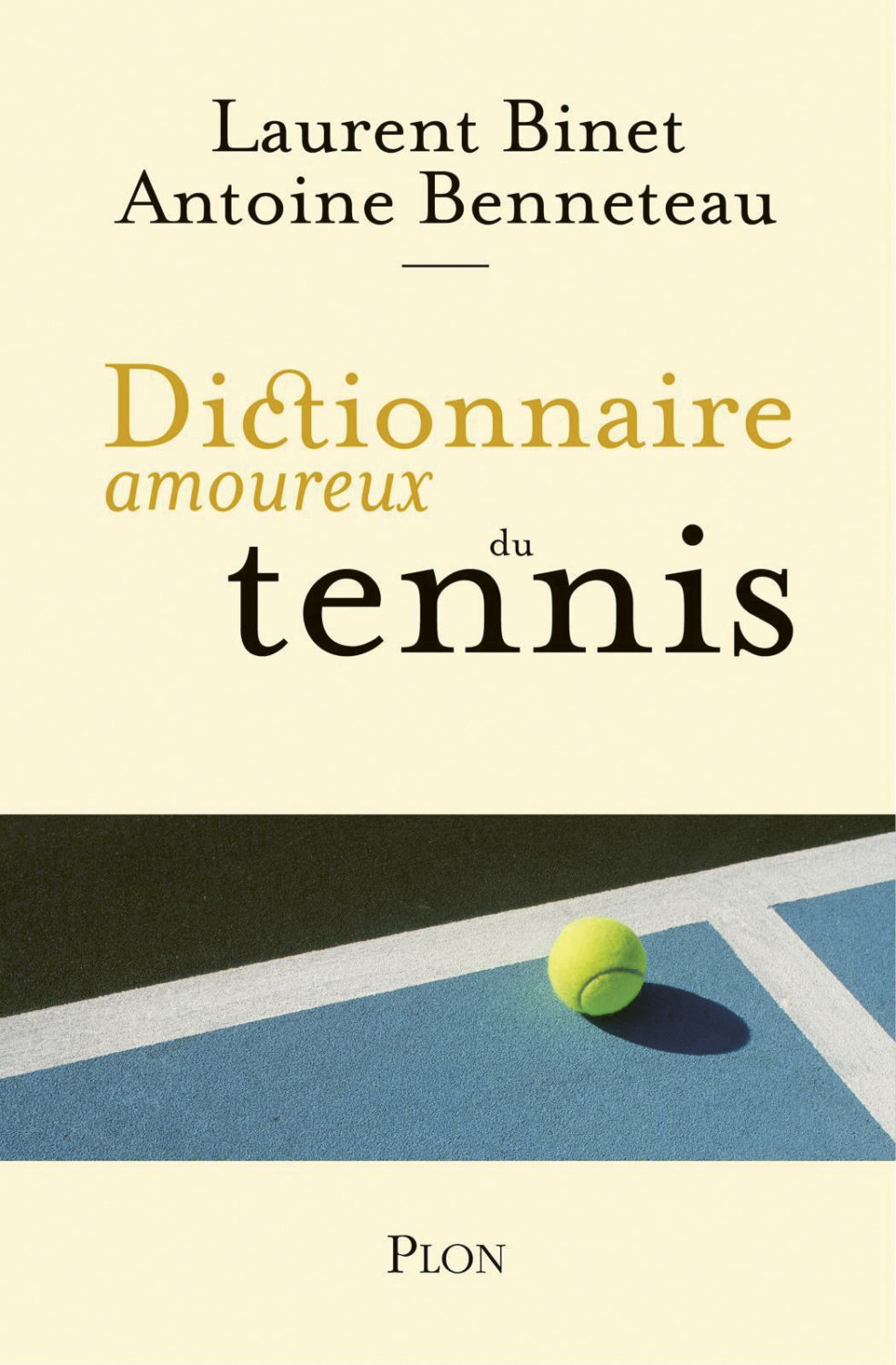
C : On ne vous entend pas beaucoup parler de Djokovic.
L.B. : Je l’ai déjà dit, c’est comme dans le Bon, la Brute et le Truand. En fait il n’y en a que deux qui comptent : le bon contre la brute. Le truand (Djoko), tout le monde s’en fout, en fait. Bon, s’il passe devant les deux autres au niveau des titres en Grand Chelem… Je ne ressens pas d’antipathie contre Djoko. Oui, il fait tout très bien, c’est le roi de la géométrie, mais il n’y pas de choses incroyables. Ok, il ramène la balle 120 fois, il est très élastique, il met la balle où il veut, mais il fait moins extraterrestre que les deux autres.
C : Avec son destin de bombardé et de héros issu d’un petit pays de sport, il campe pourtant un vrai personnage de roman.
L.B. : Ça, ce sont les à-côtés. Ce qui me plaît, c’est le jeu. Ils sont sur un ring. Les frasques de Tyson hors du ring, je m’en fous un peu. L’histoire, elle se joue sur le court. Cet espace géométrique où tu dois régler des problèmes avec toi-même, tandis que deux volontés s’affrontent. Un match de tennis est autosuffisant en termes de dramaturgie. Il s’y passe tellement de choses pour surmonter tes peurs ou tes frustrations. Dimitrov disait un jour : « Qu’est-ce que ferait Nadal s’il était sur le court à ma place ? » et j’y pense souvent sur un court pour me recadrer. Federer a dit aussi un truc génial pour nous tous : « C’est normal de rater. » Putain, Federer qui te dit ça ! À moi qui, trois jeux après un horrible jeu de service, pense toujours à ces trois doubles… Les mecs passent à autre chose, donc ce n’est pas impossible. On peut y arriver. Ce type de phrases peut m’aider. Ouais, on peut rater.
C : Vous ne cachez pas que Dimitrov, c’est un peu votre chouchou. C’est un caprice personnel ?
L.B. : Pour supporter un mec, tu as besoin qu’il galère. Federer, il n’a pas besoin de toi. Grigor, il a besoin de toi pour gagner. Il peut passer des mois entiers à faire 80 % de revers slicés. Mais quand ça se débloque mentalement : Bam Bam Bam ! Souvenons-nous sa demie contre Nadal à Melbourne en 2017. Les meilleurs matchs de Dimitrov ne sont pas loin de ceux de Federer. Dimitrov, c’était aussi une manière de prévoir le deuil de Federer. Mais il ne sera pas le nouveau Fed. C’était une mauvaise approche, on voulait le double de Federer. Celui qui postulait, c’était lui… Mais il n’y pas à craindre l’après Federer. Le revers à une main revient fort avec Tsitsipas, Thiem ou Shapovalov. Tout va bien se passer. Medvedev aussi, c’est alléchant. J’aime bien le voir jouer. Tout le monde a été dur avec Simon mais c’était créatif. Tout le monde a adoré Mecir, et Medvedev, comme Simon, c’est le créneau Mecir…
C : Vous co-écrivez avec Antoine Benneteau le Dictionnaire amoureux du tennis (Plon), dont la sortie est prévue avant Roland-Garros.
L.B. : Oui, c’est Antoine Benneteau (ancien pro, entraîneur de son frère Julien) qui a eu cette idée d’appliquer au tennis ce concept du Dictionnaire amoureux. Il avait aimé mon livre la Septième Fonction du langage et il m’a contacté pour former un binôme, en gros je n’ose pas dire la tête et les jambes (il rigole), mais disons le sportif et l’écrivain. L’éditeur s’est dit que ça devait être un bon attelage.
C : Ça consiste en quoi ?
L.B. : Avec son vécu, Antoine raconte par exemple les vestiaires de Wimbledon de l’intérieur. Il parle aussi de la première fois où il rencontre Wawrinka, avec Monfils à la cantine. Ils ont vu ce gars se pointer avec son entraîneur et ils se foutaient un peu de sa gueule, avant de se rendre compte au moment de partir que le gars parlait français et qu’il avait tout compris. Au-delà des petites histoires, il s’occupe aussi des stades, il dit ce qui lui plaît à l’Open d’Australie, même si cette année, l’image est un peu brouillée (sourire).
C : Et vous ?
L.B. : J’essaie de trouver des angles un peu marrants. Je fais le sujet « étirements », par exemple. Dans Open d’Agassi, Andre raconte le moment où il drague Steffi Graf. Il l’invite à taper la balle, ils font leur séance et à la fin, elle fait ses étirements. Lui, il est comme un collégien intimidé, il ne sait pas quoi faire, et il se met à en faire aussi alors qu’il n’en a jamais fait de sa vie. Je pars de là pour dire que je suis halluciné ! Tout le monde me dit depuis que je suis tout petit qu’il faut s’étirer, et Agassi avait déjà gagné quatre Grands Chelems sans en avoir jamais fait… On nous ment, les étirements ne servent à rien ! Ce qui est marrant, c’est que c’est moi qui ai pris dans le livre la majorité des coups techniques, Antoine n’a fait que le service. Je fais appel à ma modeste carrière de troisième série. Je mets aussi l’accent sur une chose chez ceux qui m’inspirent. Il y a cinq lignes sur Kevin Curren aussi. Un peu de Vijay Amritraj, avec son titre de gloire, qui est d’être un des trois joueurs à avoir battu McEnroe en 1984, et le seul sur surface rapide, au 1er tour de Cincinnati. Un truc fou !
Article publié dans COURTS n° 8, été 2020.