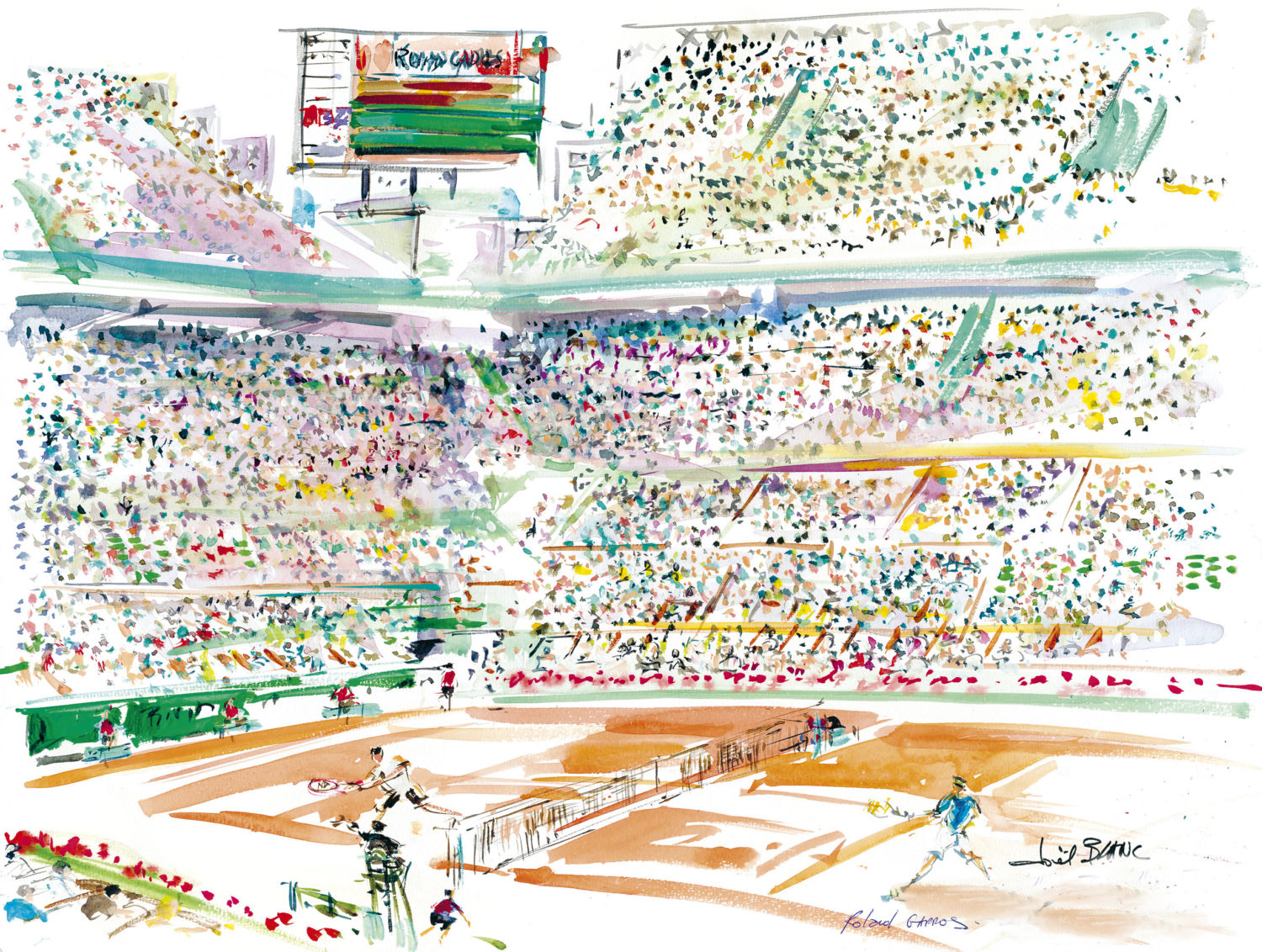Coquillages et jokari
Par Vincent Schmitz

Du haut de ses 80 ans, le jokari est un vétéran sans titre de noblesse. Facile à transporter mais gourmand en espace de jeu (comptez environ 9 mètres sur 5), il est physique sans être considéré comme un sport. Adoré enfant, moqué adulte, il symbolise une occupation solitaire un peu vaine et risible, pour tuer le temps (et l’élastique).
Au-delà du sourire qu’il provoque, il souffle un air de poésie à l’évocation du jokari. Ou au moins de nostalgie. Un retour instantané vers les « grandes vacances » d’été ; short en éponge, coup de soleil d’une époque moins anxieuse et doigts collants autour du cornet ; petites boutiques sur la digue ou fière équipée à vélo avec les cousin(e)s ; journées trop courtes ou trop lentes, à la mer ou à la campagne.
Il en ressort quelque chose d’universel aussi. Combien d’enfants, au moins jusqu’aux années ‘90, ont trompé la langueur d’un été en se shootant au jokari, en pestant contre ce jeu absurde ? Car la bataille est effrénée, mais surtout perdue d’avance : la balle revient toujours, pas de victoire possible. Reste que la pratique est bénéfique à la coordination œil-main, nous diront les plus pédagogues, et peut façonner des vocations. Les anciens pros belges Dominique Monami et Filip Dewulf l’évoquent quand ils se souviennent de leur enfance, ce dernier précisant qu’on lui disait que « ça lui allait bien »1. Et si on cherche l’adrénaline de la compétition, on peut y jouer à deux (à ses risques et périls, un coup est vite arrivé).
Les règles sont précises car l’héritage est sérieux. Le jokari est un enfant de la pelote basque, ce sport aux ramifications ancestrales où des adversaires se renvoient à tour de rôle la balle contre un mur. C’est d’ailleurs sur ses plages bayonnaises que Louis Joseph Miremont fera naître en 1938 le « Euskal Jokari », soit littéralement « joueur basque » dans la langue régionale. Le brevet d’invention délivré un an plus tard en France (et en 1942 aux États-Unis), réduira au seul mot « Jokari » une marque déposée.
L’idée de base : une balle en caoutchouc liée par un élastique à une petite boîte en bois. Et pour la frapper, deux raquettes du même matériau, non brevetées. Ce qui expliquera de multiples déclinaisons créatives, parfois jusqu’au support publicitaire, des Schtroumpfs à Gatorade ou Hollywood chewing-gum. Dès le début, elles s’adaptent aussi en taille, de junior à adulte. Mais, duo de raquettes ou pas, le jokari reste associé à une pratique solitaire, certes décente, mais qui vous force rapidement à constater que, malgré votre incroyable force de frappe, la balle reviendra toujours, et plus fort.
Dans les années ‘80, la version « Racquetball » était d’ailleurs vendue avec une seule raquette (de tennis), et une balle adaptée.
Si aujourd’hui on ne les compte plus, apparaissent dès les premières années des clones, souvent en « -ri » pour ajouter à la tartuferie : Basque Ball, Euskal Jokoa, Alkari, Pelotari ou Nogari en France, Slam ! en Grande-Bretagne, ou Jet-Ball aux états-Unis. De son côté, Jokari tentera rapidement de décliner son concept d’élastique à d’autres sports : le « Kickari » pour le football et le « Hot Tennis » pour le badminton, en plus du »Soccer Croquet ».
Outre les copies, on compte au moins six autres jeux de raquettes avec un élastique ou un fil, tous plus ou moins dérivés, dont les plus connus sont le speed-ball ou turnball (la balle tourne autour d’un mât de 1m70) et le qianball (avec un filet de tennis). Mais c’est le jokari qui donnera à des sociologues de tous horizons l’occasion de développer des théories analogues, pour symboliser le lien avec la famille ou la condition sociale d’origine, entre autres. Un lien fort qui vous revient toujours à la figure mais condamné d’avance : un jour ou l’autre, l’élastique pète et la balle, enfin libre, s’envole sans retenue.
Ce serait donc cela, la seule victoire possible contre le jokari ? Pas vraiment : il faut alors remplacer l’élastique ou tenter de le réparer par un nœud assez solide. Si ce n’est pas à la fin de l’été, c’est souvent à ce moment précis que le jeu finit abandonné au fond d’un coffre, en attendant de retrouver un élastique de remplacement ; la balle pourrissant gentiment quand la raquette se recyclera en guitare d’appoint, avec un peu de chance.
D’ailleurs, si dans la vraie vie, on associe le mot jokari à cuistax, cerf-volant ou château de sable, dans Google les algorithmes vous proposeront d’y ajouter le mot « élastique ». Ou « T30155 », car le Jokari est aussi un outil prisé par les électriciens pour dégainer les câbles. Les résultats du moteur de recherche ne valent guère mieux, ça tourne autour de la plaisanterie.
Jokari est un mot qui fait rire. Comme « scrogneugneu », « bigoudi » ou « rouflaquette ». Une saillie sarcastique pour les querelleurs : « Moi, si j’étais lui, j’arrêterais et j’irais jouer au jokari ! », lançait récemment Cyril Hanouna à son collègue animateur Arthur. Une farce poétique pour Jacques Tati en malhabile Monsieur Hulot à la plage ou un symbole du chic suranné et grotesque dans OSS 117, Le Caire, nid d’espions.
Mais sa vraie place dans la culture populaire se situe dans les cases de la BD franco-belge, époque « âge d’or », comme dans Modeste et Pompon ou Boule et Bill.
Comme Gaston Lagaffe surtout, qui upgrade son jokari au fil des albums, avec une « super balle » rebondissante ou en inventant le « jokari sans visibilité » (« muni d’un long fil très élastique, lorsque l’on y joue dans les couloirs, on ne voit pas la balle jusqu’à ce qu’elle revienne »). Sans oublier Spirou qui s’en sert de défouloir… (« Tu vas voir Fantasio : cinq minutes de jokari et tu te sentiras un autre homme », peut-on lire dans La Mauvaise Tête) Et comme il n’y a pas de hasard, le petit personnage de groom est lui aussi né en 38.
Deux ans plus tôt, la France et la Belgique découvraient les congés payés et le temps libre qui va avec. Les classes populaires ont enfin droit aux charmes du loisir et à la délicieuse sensation de ne rien faire d’autre que passer le temps… avec un jokari, notamment. Mais la guerre couve et il faudra attendre les années ‘50 et ‘60 pour que le jeu de Bayonne prenne vraiment son envol, et se voie récupéré par la culture populaire mondiale. Outre nos latitudes européennes, il croisera entre autres le Japon ou l’Australie, et séduira les États-Unis. Un quotidien texan tranche dès 1950 et titre : « C’est presque comme jouer au tennis avec soi-même ! »
L’Américaine Pauline Betz, qui a remporté cinq Grand Chelem entre 42 et 46, prêtera son image à un set « de luxe » dès le début des années ‘50, tout comme le footballeur Kyle Rote Jr. deux décennies plus tard. Même Tom et Jerry s’y mettent, avec la souris en guise de balle, évidemment. Resté dans le giron de la famille Miremont, la fabrication passera en 1958 sous la houlette de Chikitoys. Aujourd’hui, le « vrai » Jokari est la propriété du groupe Smoby en France, et de Jokari US aux États-Unis, recyclé depuis dans la vente de gadgets en tout genre après un dernier effort en 2002 avec un ultime set.
Actuellement, on compte des dizaines de jeu de plein air plus modernes, sans même parler des jeux connectés, chargeur inclus. Mais tous ceux qui ont croisé sa route gardent une affection particulière pour le jokari. Et si l’on s’en moque gentiment, c’est qu’on a atteint l’âge adulte, plus pragmatique. Quelques téméraires tentent d’organiser des tournois, comme l’Amicale Jokari Club en France. Mais vous croiserez peu de trentenaires qui le pratiquent de temps en temps, comme on se donne rendez-vous pour une partie de squash.
À l’exception du Pays basque espagnol, à Bilbao, où est organisé un grand tournoi, devenu de fait le plus officiel et, du coup, une sorte de classement mondial par défaut.
À retenir pour les longues soirées d’hiver : jokari est considéré comme un mot valable au Scrabble, en tant que « nom déposé lexicalisé avec le temps ». Il vaut 22 points, un de plus que pour gagner une partie de jokari en marée basse, entre la pêche aux crabes et la collecte de coquillages.
Et maintenant ?
Ils sont rares à s’organiser sérieusement mais ils existent : certains amateurs de jokari créent des « clubs », certes avec un succès confidentiel mais non sans ambition, quelque part entre le fun et le sérieux. L’Amicale Jokari Club, basée à Rennes, est l’un d’eux. Martin Théret, son président, nous raconte en quelques mots sa récente passion.
Courts : Pourquoi cette passion pour le jokari ?
Amicale Jokari Club : L’Amicale Jokari Club a vu le jour en octobre 2016, c’est donc tout nouveau. À titre personnel, j’y joue chaque été à la plage depuis son apparition dans le film OSS 117 : Le Caire, nid d’espions. Jusqu’au jour où en discutant avec mes collègues de bureau, nous nous sommes rendu compte que nous partagions la même passion. Il n’en fallait pas plus, l’Amicale Jokari Club était née.
C : Le jokari n’a-t-il pas une image désuète ?
AJC : Pas du tout ! Il suffit d’y jouer pour s’en rendre compte. Instantanément il suscite la curiosité des plus jeunes, qui demandent à l’essayer à leur tour. C’est d’ailleurs une caractéristique du jokari : voir quelqu’un y jouer provoque une envie irrésistible de prendre la raquette. Et on comprend vite pourquoi : ce sport est un véritable défouloir, la prise en main est rapide et il peut se jouer n’importe où ! Bien sûr, il y a un côté rétro dans le jokari, et c’est d’ailleurs ce qui fait son succès. Il provoque la nostalgie des anciens et attire la curiosité des plus jeunes. Il est de fait très rassembleur.
C : Quelle est la part de second degré là-dedans ?
AJC : Ce serait une erreur de résumer le jokari au « comique ». Lorsque l’on joue une partie de jokari, on est physiquement à 100 % du début à la fin, c’est une activité physique très énergivore à l’image du squash. S’il a jusqu’à maintenant gardé son étiquette comique de sport loisir, c’est avant tout car il n’existe pas de véritables règles pouvant permettre la compétition. Et pour cause, elles ne sont pas évidentes à définir. L’Amicale Jokari Club y travaille activement.
C : En ce qui concerne le matériel, y a-t-il une certaine exigence ou les « clones » sont-ils acceptés ?
AJC : Les vulgaires jeux de jokari en plastique avec élastique trop court sont à proscrire ! Les puristes du jokari le pratiquent avec une raquette en bois, et sans grip sur le manche, les ampoules font partie du jeu ! Je tiens d’ailleurs à rappeler que le jokari est un sport à risque. Qui ne s’est jamais fait entourer le cou par l’élastique ? On appelle cela le coup de la corde à linge ! Pour en revenir au matériel, l’entreprise Vilac fournit un très bon jokari, que nous utilisons. Cependant l’AJC va bientôt produire son propre jeu, avec un menuisier partenaire.
C : Y a-t-il une tenue exigée ?
AJC : La tenue de l’association est simple : T-shirt rouge, short bleu marine, chaussettes hautes blanches, bandeau blanc au front et tricolore bleu-blanc-rouge au poignet. C’est plus exigeant que Wimbledon ! Mais les joueurs sont évidemment autorisés, et même encouragés à se vêtir de leur plus belle tenue freestyle.
C : Avez-vous déjà réussi à rallier du monde à votre cause ?
AJC : L’AJC compte aujourd’hui 41 membres actifs. Ce nombre devrait sensiblement s’accroître au printemps avec le retour des beaux jours. D’autant plus que l’association rennaise va s’attaquer à Paris cette année. En dehors des rencontres fréquentes, l’AJC a organisé deux événements majeurs l’été dernier avec le Jokari Season Opening, puis les premiers internationaux de France de Jokari. Si le succès reste modeste avec une cinquantaine de participants, ces deux journées ont été de vraies réussites sur les critères phares du jokari : du sport et du fun ! Concernant l’avenir proche, l’idée est de reconduire les événements rennais de l’an passé et d’inaugurer des événements à Paris le long du canal de l’Ourcq. Guettez donc la page Facebook de l’AJC !
C : Des ambitions futures sur le terrain du jokari ?
AJC : En deux mots : Paris 2024.
Article publié dans COURTS n° 1, printemps 2018.