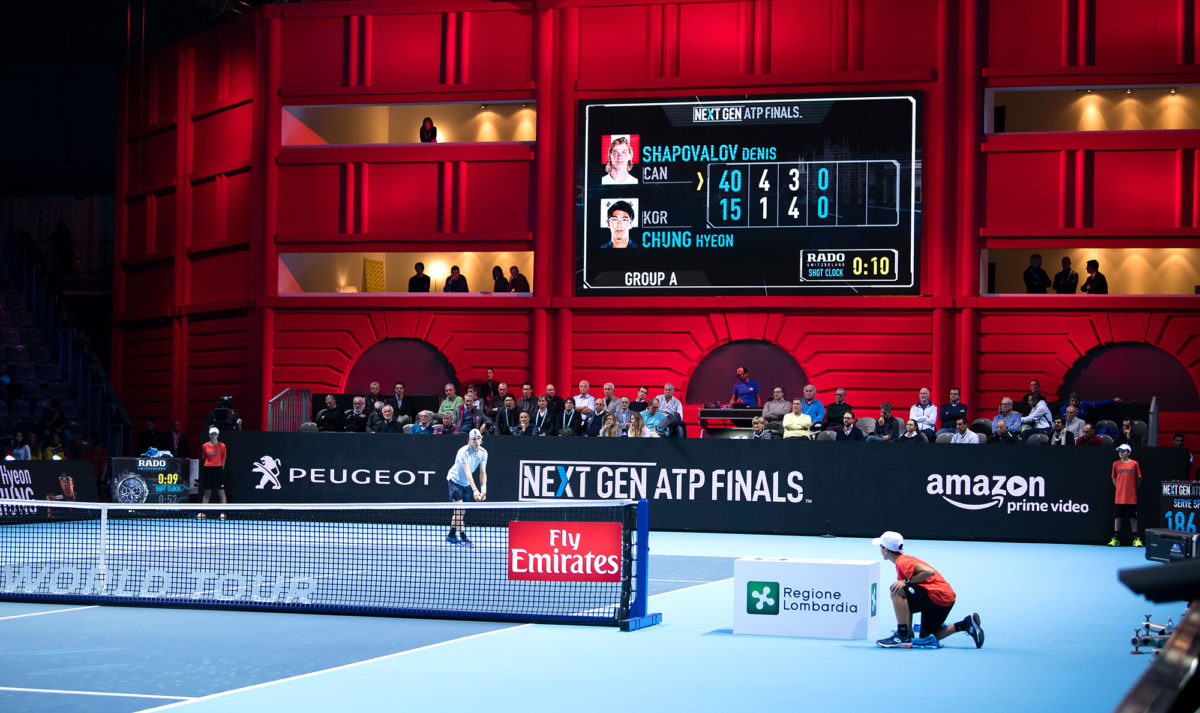Même les licornes jouent au ping-pong
Par Vincent Schmitz
S’il fallait décrire l’image d’une startup en un mot, ce serait un son : ping-pong.
Synonyme d’innovation (et de levée de fonds), ce type de société a révolutionné de nombreux secteurs, à commencer par la culture d’entreprise en elle-même. Exit la machine à café pour papoter avec le service comptabilité, place au très populaire tennis de table pour décompresser. Même quand on est devenu une multinationale surpuissante. Ou une licorne, terme qui invite au « rêve » façon heroic fantasy tendance geek, adopté pour désigner une startup valorisée à plus d’un milliard de dollars – sans pour autant générer de profits comparables.

Depuis la fin du précédent millénaire, la startup s’est imposée à la faveur du développement de l’informatique et surtout d’Internet. Forme raccourcie de « startup company », pour « société qui démarre », elle existe au moins depuis les années ‘20 à Wall Street, alors frappée de « radiomania ». Comprenez une vague d’investissements massifs dans les sociétés liées à la toute nouvelle technologie de transmission sans fil. Mais ces vingt dernières années, la « philosophie startup » a explosé, quittant la Silicon Valley pour rejoindre les faubourgs parisiens, les rues barcelonaises ou les bords de Meuse.
Les GAFAM1, Natu2 et autres licornes sont passées de startup à multinationales mais ont gardé leurs nouveaux codes, érigés en paroxysme du travail à la cool. Quitte à masquer des réalités plus douteuses derrière les slogans en lettrages stylisés, les poufs king size et la décontraction vestimentaire, elles ont enfanté des milliers de petites structures innovantes partout dans le monde ; et même des sociétés traditionnelles copient leur intérieur.
Le ping-pong est un peu plus vieux. L’histoire raconte que c’est dans l’Angleterre victorienne que des notables ont l’idée de schématiser un court de tennis sur une table, avec un bouchon de champagne en guise de balle. Le terme ping-pong, que les professionnels (pourtant appelés « pongistes ») réfutent au profit de l’appellation « tennis de table », est une marque déposée depuis le début du XIXe siècle.
Sans surprise, il est sans doute un dérivé des bruits de la balle contre la raquette (ping) et du rebond sur la table (pong). Il rencontrera rapidement un grand succès. Un premier jeu est commercialisé dès 1890 et à peine dix ans plus tard, le celluloïd plus léger remplace le caoutchouc de la balle tandis que les raquettes prennent déjà leur aspect actuel.
Difficile d’imaginer en effet jeu plus fédérateur et intuitif à moindres frais. Même au 19e siècle, les gens voulaient juste du fun. Ça tombe bien : au-delà d’un nouveau modèle entrepreneurial, la startup ramène du rêve au milieu des bureaux gris, de l’entertainment entre deux team buildings, du LOL dans les fichiers Excel ; bref, du ping-pong dans l’open space.
Une nouvelle culture d’entreprise, avec un management repensé, et la créativité « disruptive » portée en étendard. Car la startup est étroitement liée à l’innovation, ce qui demande un esprit jeune et ouvert, un encadrement moins rigide dans des lieux qui permettent d’y rester au-delà des heures de bureaux.
Des espaces détente, de la nourriture à gogo (voire un bar), des soirées bières et pizzas… et, plus que tout autre élément du décor, des tables de ping-pong, avec les raquettes labellisées #WorkhardPlayhard en bonus quand on s’appelle Twitter.
Addictif
Les raisons de ce succès peuvent sembler évidentes. Le ping-pong cause a priori peu de blessures, une table reste bon marché et demande peu d’espace. Il est facile de lui dédier une salle, comme tant de garages ou de caves où elle traîne encore, repliée en deux depuis que les enfants ont grandi. Rares sont ceux qui ne s’y sont jamais essayé au moins une fois, quitte à passer le plus clair du temps à se baisser pour ramasser la balle, en vacances dans un club, en visite chez le petit voisin plus chanceux ou pendant un stage un peu absurde, type « équitation - tennis de table ».
La Fédération internationale de tennis de table estime d’ailleurs le nombre de pratiquants occasionnels dans le monde à plus de 260 millions (et 33 millions de licenciés), en faisant l’un des sports les plus populaires. Qu’importe sa condition physique, on peut aussi s’y (re)mettre et rapidement améliorer ses performances, ce qui rend le jeu très addictif. D’autant que les parties sont généralement courtes et que l’on peut y assister en tant que spectateur sans s’ennuyer, attendant son tour ou encourageant les collègues.
Mais le tennis de table, olympique depuis 1988, prend plus de place qu’un coin jeux vidéo ou qu’un babyfoot, et autant qu’une table de billard. Ce n’est donc pas la seule explication. Outre son côté fun, l’obsession pour cette pratique dans un milieu vivant au rythme du code informatique serait à chercher du côté cérébral. Un petit break autour d’une balle rebondissant sur une table de 2,74 mètres sur 1,52 solliciterait de manière insoupçonnée le cerveau et serait donc bénéfique autant à l’employé qu’à l’entreprise. « Il se passe beaucoup de choses autour de cette table », expliquait en 2015 le docteur Wendy Suzuki, professeur en neurosciences à la New York University. « L’attention et la mémoire augmentent et vous construisez des circuits dans votre cerveau.»3
Échecs sous stéroïdes
Le livre du docteur Suzuki, Healthy Brain, Happy Life, explore la manière dont l’exercice physique affecte le cerveau humain. Elle y dresse notamment les bénéfices de la pratique du ping-pong sur le cerveau, les zones de jeu réduites accélérant l’action et encourageant les joueurs à penser et bouger à un rythme effréné. Selon elle, trois zones majeures sont directement affectées. Les capacités motrices aiguisées et la précision de la coordination œil-main sollicitent le cortex moteur primaire et le cervelet, qui planifient et contrôlent les mouvements, mais coordonnent aussi les gestes. En anticipant le coup de l’adversaire, le joueur utilise aussi le cortex préfrontal, essentiel pour le planning stratégique.
Enfin, l’exercice physique du jeu stimule l’hippocampe, partie du cerveau essentielle pour la mémoire et la navigation spatiale. Sans parler des dopamine, endorphine et autre adrénaline, hormones bienfaitrices libérées par la pratique de tout exercice physique.
Will Shortz, verbicruciste américain responsable des mots croisés pour le très sérieux New York Times et pointure dans les jeux de réflexion, puzzles et casse-têtes en tout genre, n’y voit rien de moins qu’une partie d’échecs « sous stéroïdes ». Accro au ping-pong, il y trouve autant de stratégie que dans l’exercice de son métier.
« Je joue au tennis de table pour les mêmes raisons que je fais des mots croisés. Ça me revigore et me détend. Je suis absorbé par le jeu et ensuite, je me sens bien et prêt à retourner dans le quotidien. Tout exercice physique est bénéfique mais celui-là particulièrement, parce que c’est un sport cérébral, qui entraîne votre corps à être performant instantanément dans différentes situations. En nous forçant à anticiper les déplacements de l’adversaire et y réagir avec vitesse et précision, le ping-pong est une manière de préparer son corps et son cerveau à tout ce que vous faites d’autre dans la vie. »4
Networking et diplomatie
Berceau de la startup, les États-Unis et leurs campus universitaires le sont aussi du beer pong, ce jeu à boire très populaire où il faut lancer une balle de ping-pong dans un gobelet. Une coutume qui illustre toute la culture du campus universitaire américain et tranche avec les codes habituels de l’entreprise, idéal pour symboliser la disruption. Et renforcer les liens entre employés, voire réinventer le networking, comme l’a imaginé la firme SPiN, sorte de bar branché social club de ping-pong. Réinventer, ou presque.
Ceux qui se souviennent du film Forrest Gump auront noté la référence à ce que l’on appelait déjà « la diplomatie du ping-pong », quand, en 1971, l’équipe de tennis de table chinoise avait invité son équivalent américain quelques mois avant la visite du président américain Richard Nixon en Chine. Un réchauffement des relations entre les deux pays s’en était suivi, même si tout cela était surtout un symbole photogénique.
Les startups sont elles aussi friandes de symboles. Le tennis de table en est un, au point que la récente chute des ventes de tables dans la Silicon Valley a été utilisée comme une indication à la baisse de la « bulle technologique » par le Wall Street Journal.
Pour d’autres, il s’agit surtout d’un signe de temps qui changent. Plusieurs voix commencent à s’élever contre cet esprit startup, pansement trop petit pour couvrir des problèmes fondamentaux. Même dans une startup trop cool, les employés préfèrent une bonne couverture hospitalisation et des horaires moins étendus à un tournoi de ping-pong.
L’ancien journaliste et employé de startup Dan Lyons parle ainsi dans son livre Disrupted de « culture intermédiaire entre celle d’une secte comme la scientologie et celle d’une maison d’étudiants. »5 Certains designers souhaitent aussi un changement de décor radical, pour renvoyer les soirées pizzas-bières et les tables de ping-pong sur les campus.
Dani Arps en est la porte-voix. À 33 ans, cette architecte d’intérieur a disrupté la disruption : elle veut forcer les jeunes entrepreneurs à « se comporter comme des adultes », la créativité pouvant s’exprimer ailleurs que dans des locaux qui « ressemblent à des dortoirs ». « Un bureau peut être fun sans être infantile », résume-t-elle6. Exit les bean bags et les tables de ping-pong, place à des lieux fonctionnels et adaptés aux besoins spécifiques d’employés créatifs et débordés. Et ça marche, son agenda ne désemplit pas, pour des sociétés toujours plus importantes.
Reste que le tennis de table demeurera toujours associé à la startup. Au moins lié par la langue informatique et plus spécifiquement le « ping », cette commande qui envoie un message à un « serveur pour savoir si ce serveur est opérationnel. » Dans le meilleur des cas, il y a une réponse. Un « pong ».
Article publié dans COURTS n° 1, printemps 2018.
1 GAFAM est l’acronyme des géants du Web, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique.
2 Natu est l’acronyme de Netflix, Airbnb, Tesla, et Uber, les quatre grandes entreprises emblématiques de la disruption numérique.
3 mnn.com, 18 avril 2016
4 mnn.com, 18 avril 2016
5 L’Écho, « Dan Lyons Pourfendeur de la culture high tech », 14 mai 2016
6 Entrepreneur.com, 28 août 2017