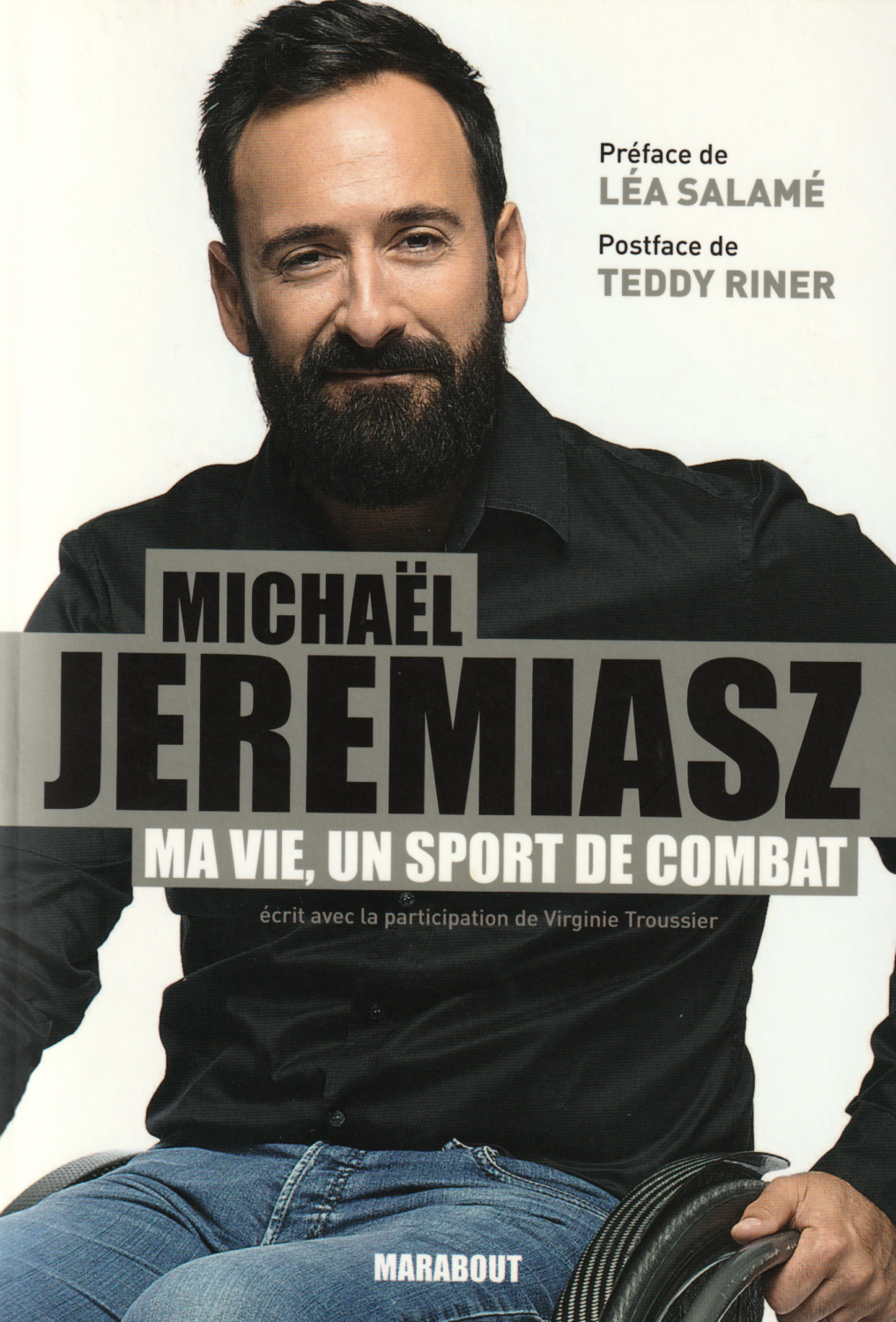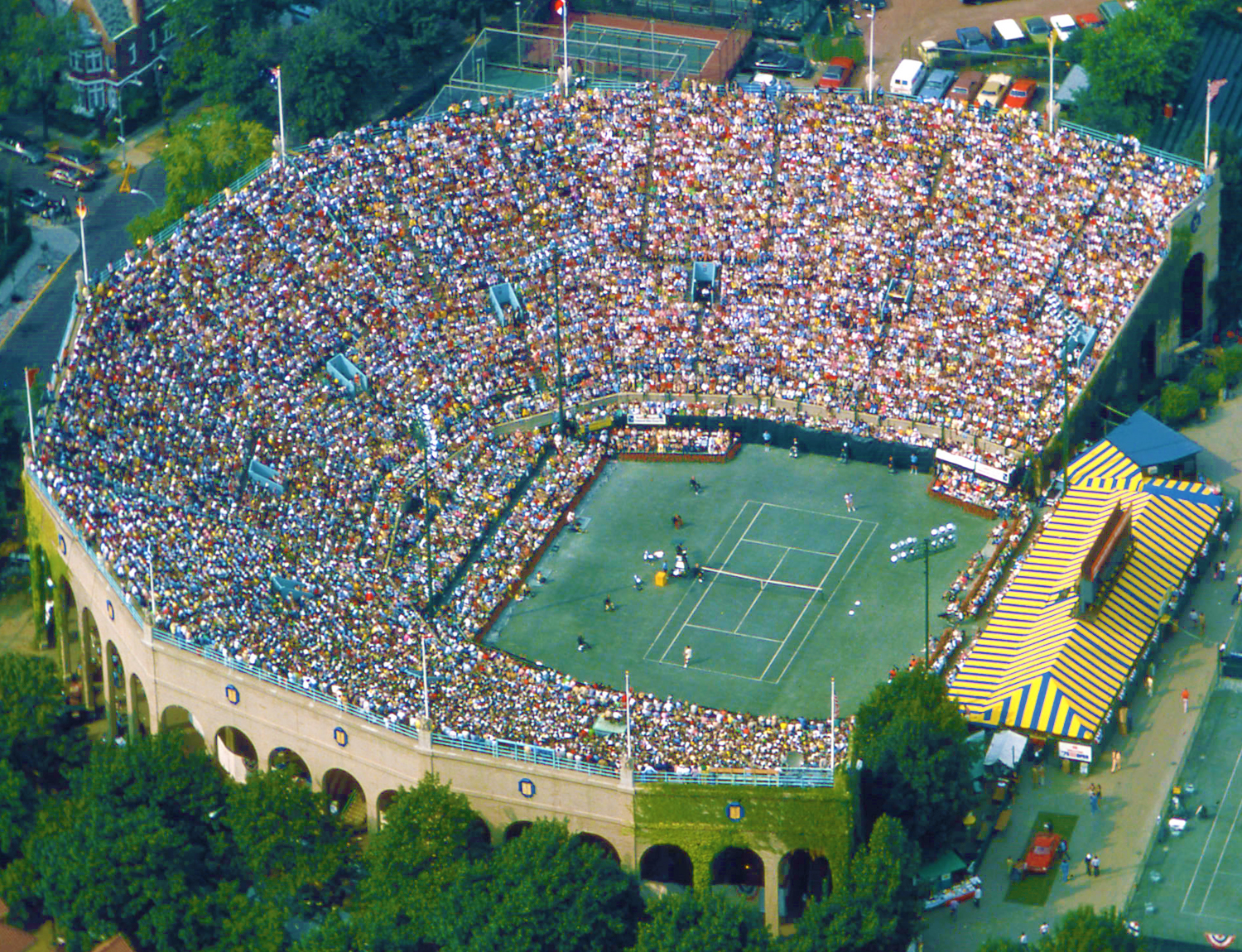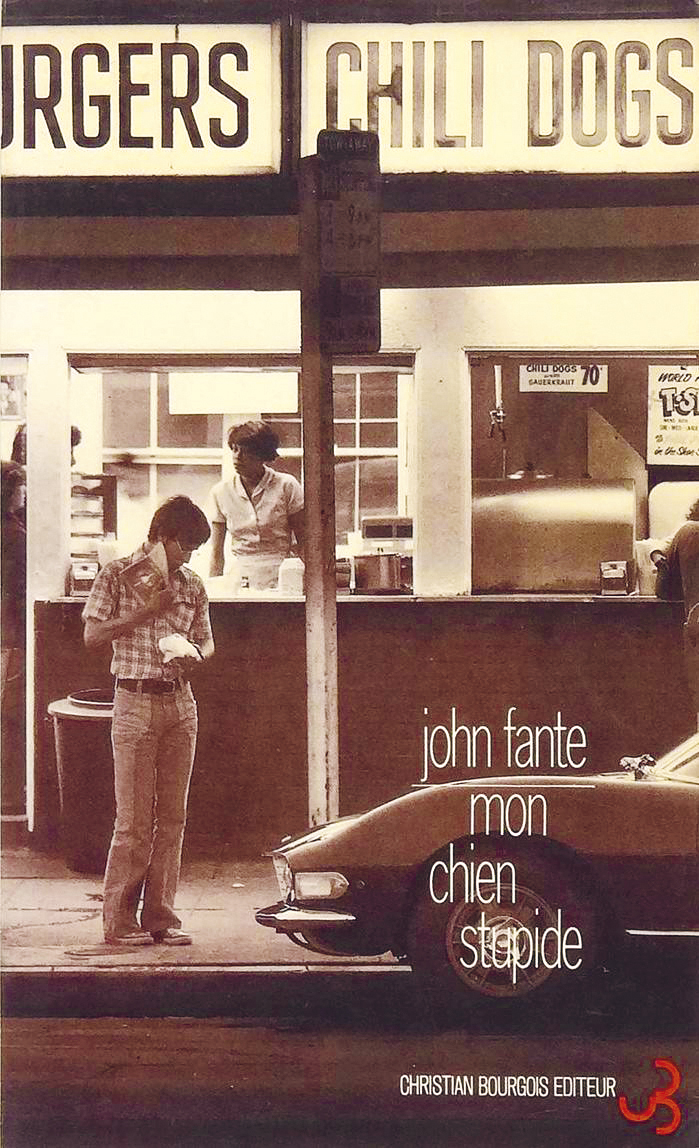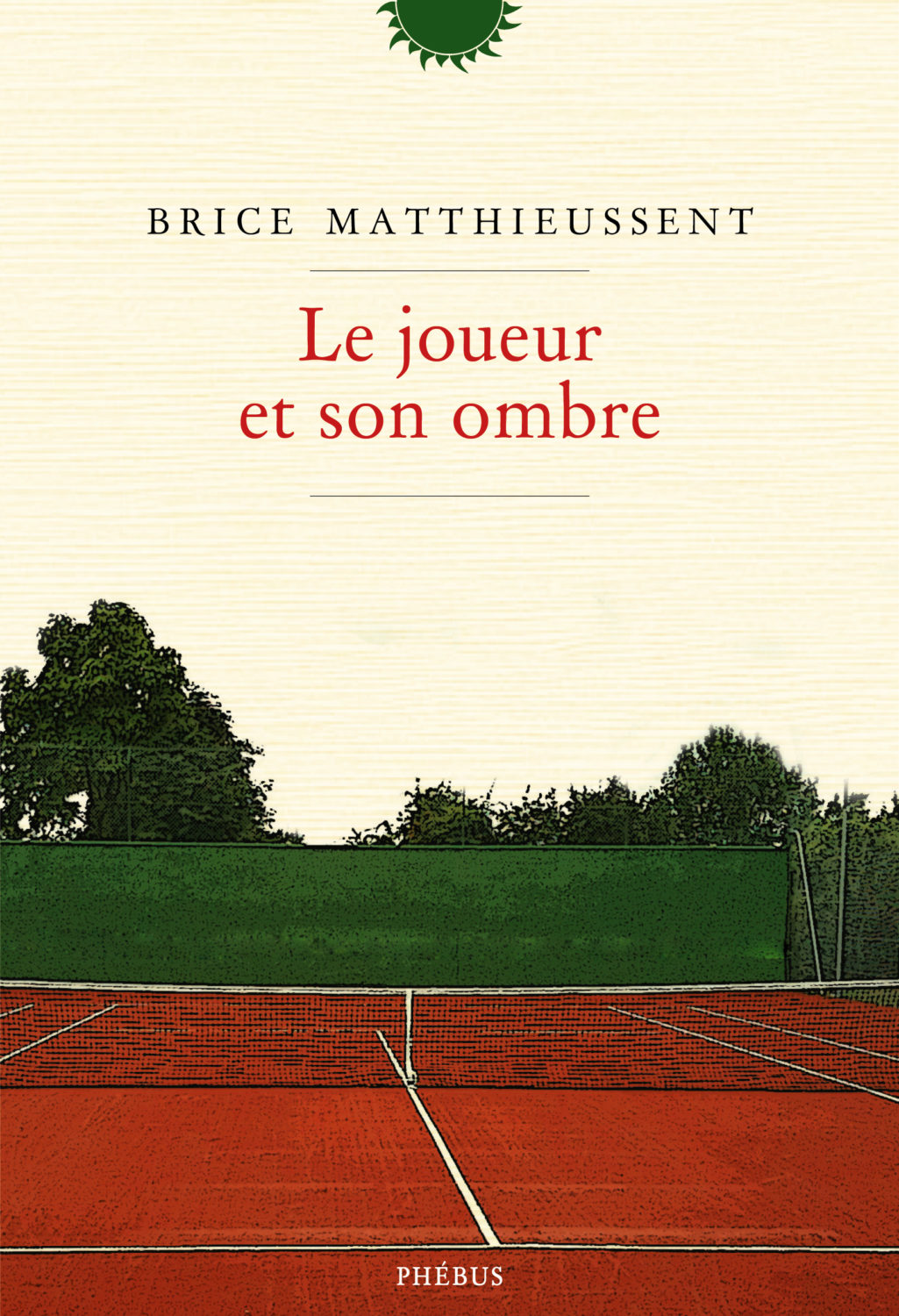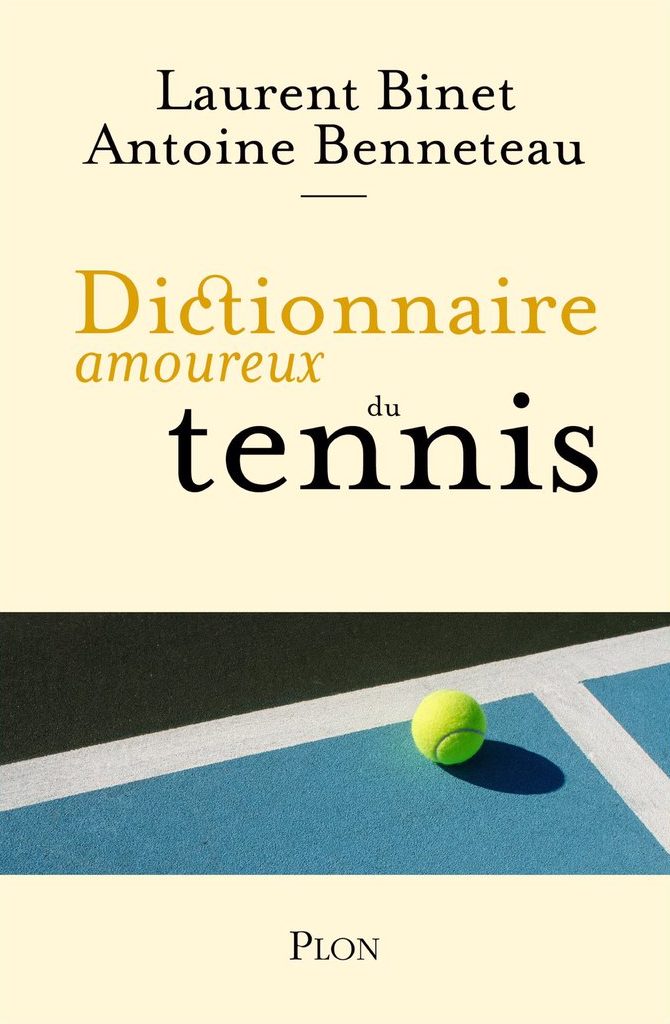Marion Bartoli
« Ce qui fait la différence,
c’est ce que le joueur a mis pendant
des années sur le terrain »
Par Rémi Bourrières

Hommes et femmes confondus, Marion Bartoli reste la dernière Française à avoir remporté un titre du Grand Chelem. C’était à Wimbledon, en 2013. Avec un état d’esprit et des méthodes d’entraînement à la marge de ce qui se fait traditionnellement dans le système français. Celle qui a récemment signé son autobiographie Renaître porte un avis forcément éclairé, et connaisseur, sur la question.
Courts : La culture française ne serait-elle pas compatible avec la performance sportive de haut niveau ?
Marion Bartoli : On ne peut pas dire que les Français n’ont pas de mental, non. Il est vrai que le fait d’avoir un certain confort n’aide pas forcément pour le sport de haut niveau. Mais ça, ce n’est pas uniquement en France. Le fait de connaître des difficultés, que ce soit dans ses conditions d’entraînement, sur le plan financier ou autres, peut vraiment aider un enfant à se forger par lui-même un mental différent et de grandes qualités de combativité. J’en suis l’exemple incarné. Donc avant toute chose, je crois que tout dépend de son parcours personnel, de son éducation, de son histoire familiale.
C : Depuis le sacre de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983, seules les joueuses françaises sont parvenues à gagner des Grands Chelems : Mary Pierce, Amélie Mauresmo et vous. Entre vous trois, quelles étaient les qualités communes qui vous ont mené au Graal ?
M.B. : La volonté, avant tout. Mary, Amélie et moi avons eu des parcours très différents mais avec pour point commun d’avoir vécu des choses pas faciles à gérer. C’est cette difficulté dans notre parcours qui nous a unies, et qui a probablement forgé chez nous une volonté absolue de gagner. Nous étions toutes les trois de grandes combattantes avec une détestation de la défaite qui nous poussait en permanence à vouloir nous améliorer, à nous remettre en question pour monter toujours plus haut. Enfin, nous avons toutes les trois une très grande sensibilité sur le plan affectif. Cette affectivité nous a permis de nous entourer des bonnes personnes au bon moment.
C : Est-ce un pur hasard si ce sont uniquement des filles qui ont réussi à passer ce cap en France, ou est-ce plus difficile pour des garçons de s’affranchir d’un éventuel climat négatif ?
M.B. : Ce n’est quand même pas passé si loin chez les garçons. Il y a eu plusieurs finales de Grand Chelem entretemps, et il faut dire aussi une concurrence très importante. Pour la génération actuelle, ce n’est pas évident de gagner un Grand Chelem dans cette époque-ci ! Il y a eu aussi quelques petites blessures, qui ont handicapé Tsonga et Monfils notamment. Après, il a peut-être manqué les 2-3 % supplémentaires que les filles ont accepté de faire, le fait de dédier absolument tout à notre sport. C’est peut-être ce qui fait la différence dans les derniers matches. On peut avoir une super structure d’entraînement autour de soi, au bout du bout, ce qui fait la différence au sommet, c’est vraiment ce que le joueur a mis pendant des années et des années sur le terrain. Mais ça, je ne pense pas que soit une histoire de garçon ou de fille. C’est plus un état d’esprit personnel, lié à sa propre histoire.
C : Si vous étiez aux manettes de la DTN, qu’essayeriez-vous de changer dans les mentalités ?
M.B. : Je crois que les réformes entreprises aujourd’hui par le DTN Pierre Cherret sont bonnes. Après, il ne faut pas attendre des résultats trop rapidement. Cela prend du temps pour changer une machine pareille. Il y a eu de mauvaises habitudes prises depuis trop d’années. Mais si on me demandait mon avis, j’irais dans ce sens et je veillerais à ce qu’il y ait, au quotidien, beaucoup plus d’heures d’entraînement, avec beaucoup plus d’intensité. Et puis, il faut une culture de la gagne, du résultat. Faute de quoi les jeunes ne peuvent pas continuer à être pris en charge. Sinon, on leur envoie le message que le résultat n’a pas énormément d’importance. En réalité, le résultat a énormément d’importance dans le sport de haut niveau.
C : Hommes et femmes confondus, vous êtes donc la dernière Française à avoir gagné un Grand Chelem (en simple). Quelle importance revêt encore pour vous ce titre aujourd’hui ?
M.B. : C’est bien évidemment une fierté immense. Mais je sais que cela ne restera pas comme ça éternellement et je souhaite vraiment qu’un joueur ou une joueuse en gagne un rapidement après moi. C’est très important pour le rayonnement du sport français à l’international. Et puis cela ne m’enlèvera pas mon titre ! Pour moi, cela a bien évidemment été un moment fantastique. J’ai encore souvent des images dans ma tête. Parfois même, je me remets la vidéo de la finale pour me replonger dans les souvenirs de ce 6 juillet qui aura été une journée extrêmement spéciale. Il y a toujours ce petit goût amer de ne pas avoir pu continuer derrière. Ce titre m’avait donné l’envie de soulever des montagnes et de ne pas avoir été capable de le faire à cause d’une blessure à l’épaule, ça n’a pas été facile à gérer. Mais dans les moments difficiles, en particulier lorsque j’ai eu mon anorexie, ce trophée m’a aussi donné la force de me battre, de me relever. Cela restera un moment magique que je n’oublierai jamais.
Entretien publié dans COURTS n° 5, été 2019.