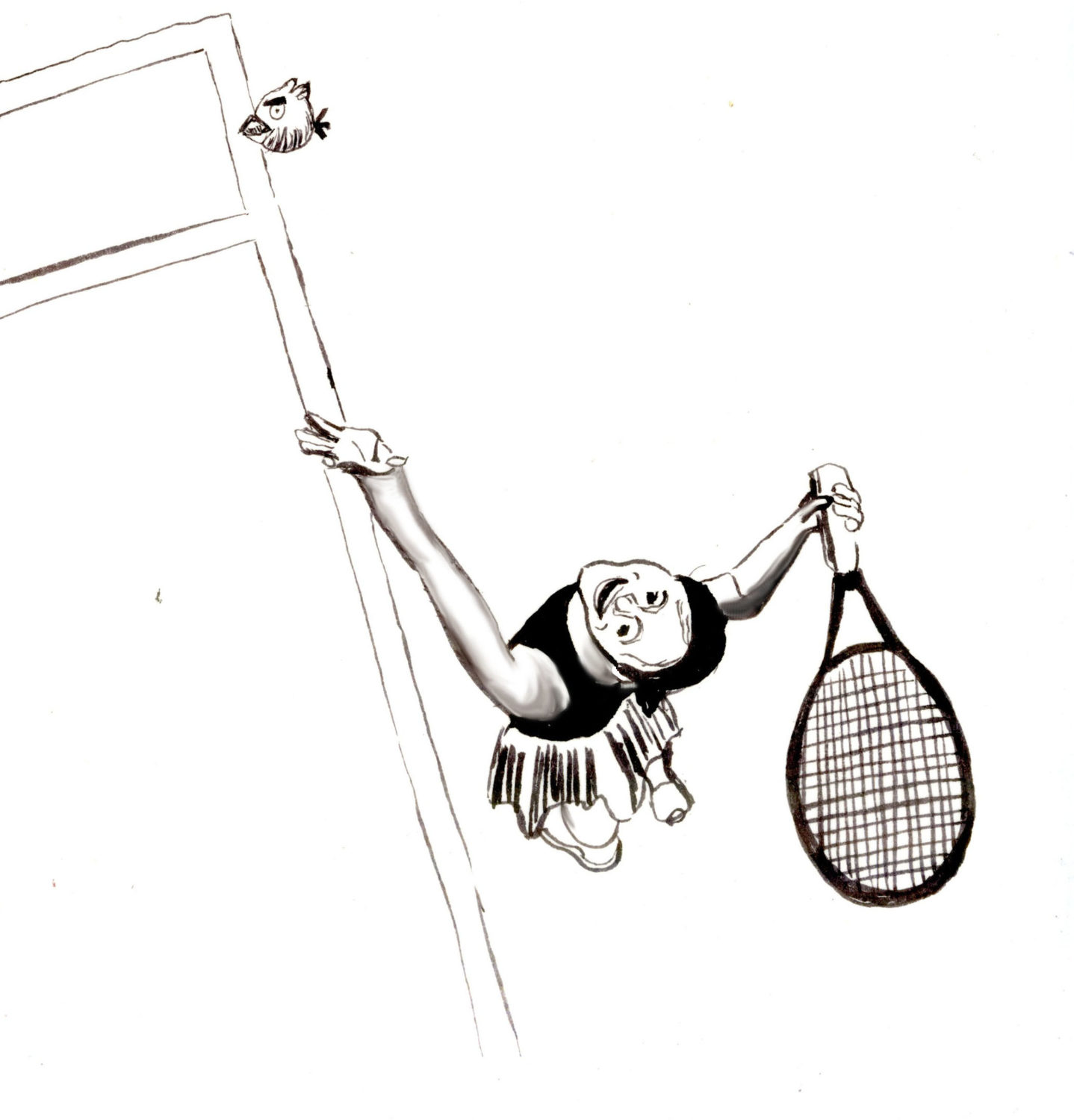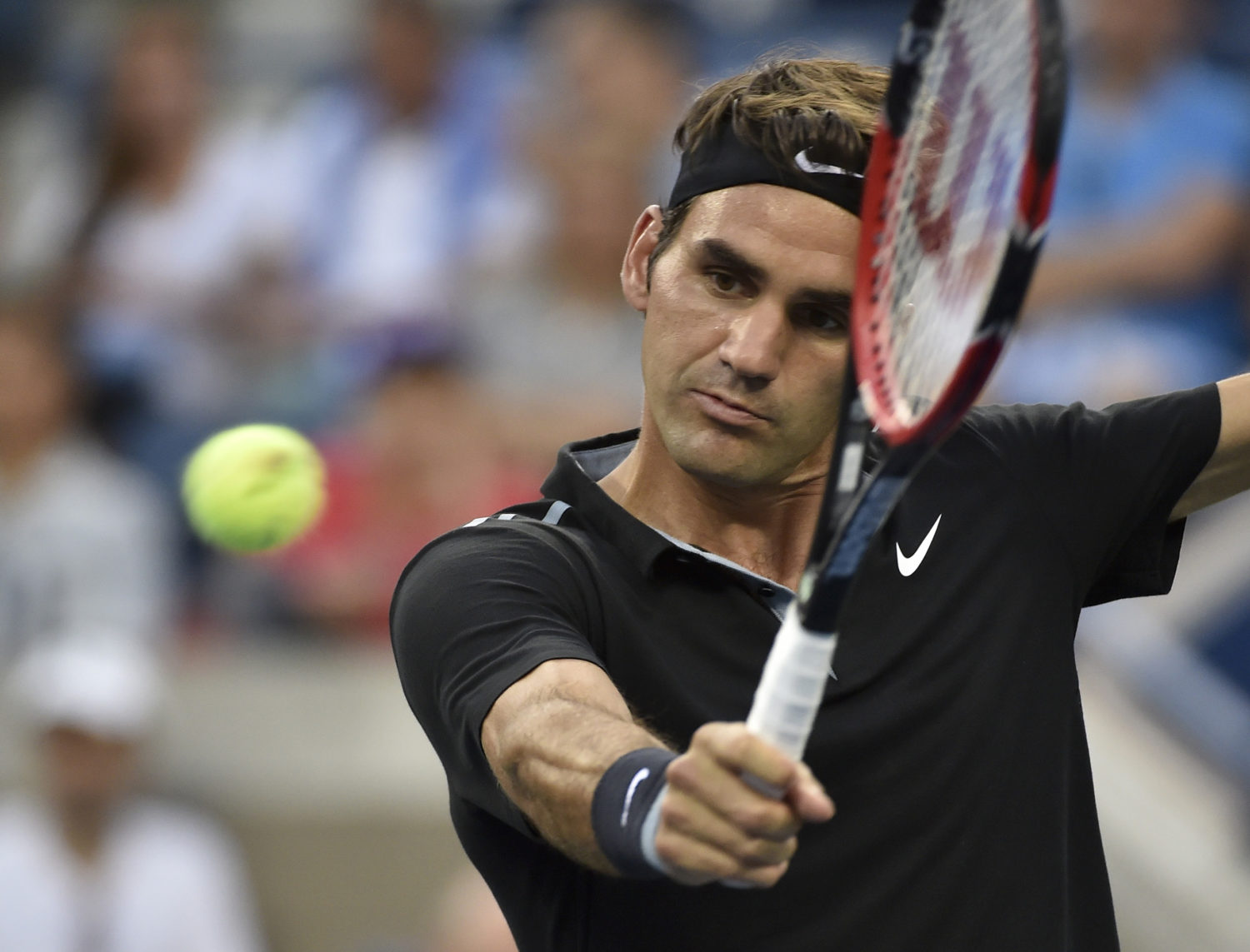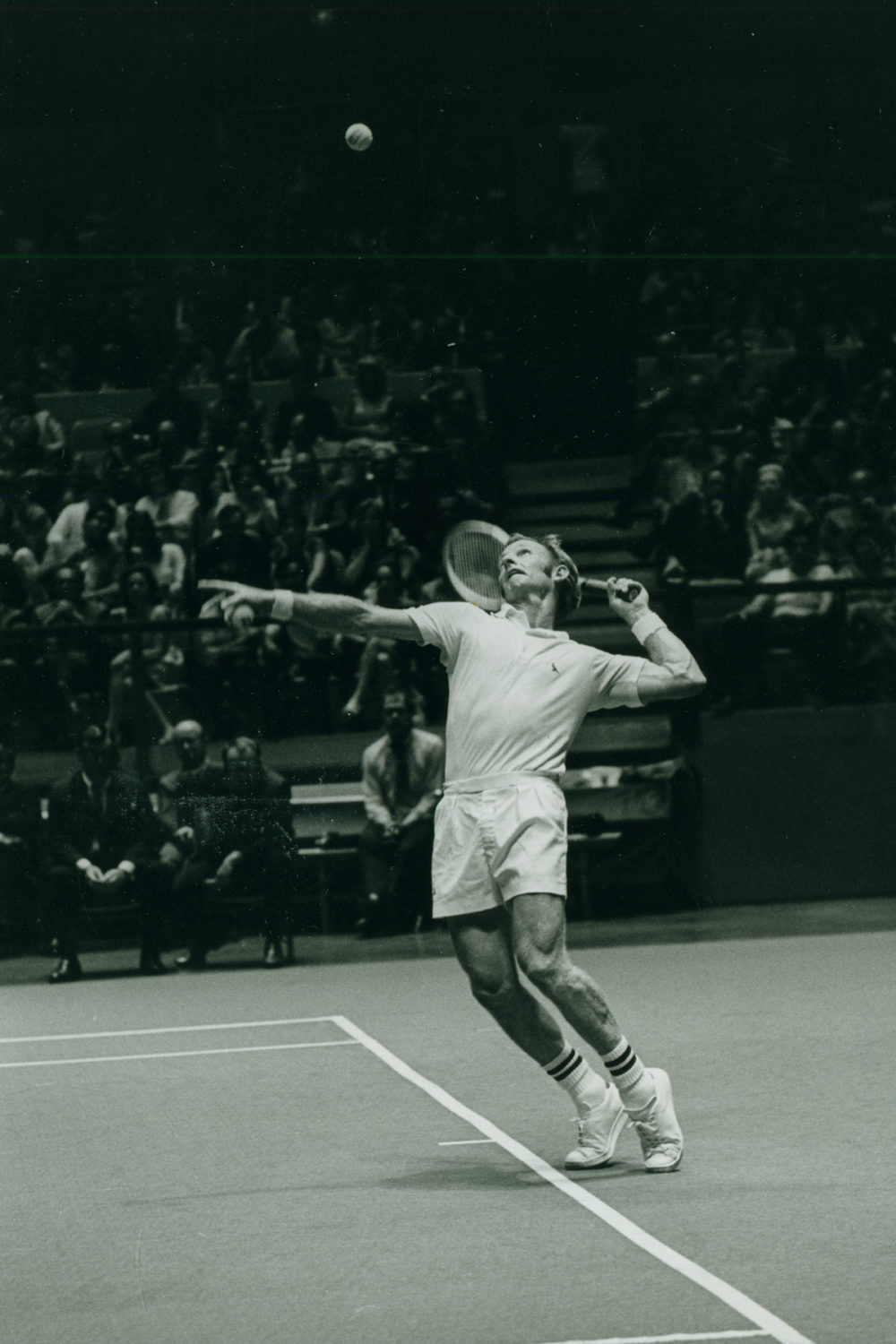Ils ont passé l’arme à gauche… (et ils témoignent)
Par Rémi Bourrières

Depuis longtemps proclamé, peut-être un peu fantasmé, l’avantage supposé des gauchers au tennis est toujours resté assez nébuleux. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans une analyse du phénomène par le prisme des chiffres, mais aussi des témoignages de joueurs, rarissimes, qui ont dû changer de main au cours de leur vie. Les seuls, finalement, qui peuvent comparer en toute objectivité.
Alexander Volkov, vous vous rappelez ? Cet ancien joueur russe a notamment été demi-finaliste à l’US Open en 1993, année où il atteint la 14e place mondiale et devient le dernier homme à battre Björn Borg en compétition. Mais il était connu tout à la fois pour sa patte gauche chatoyante, le tennis instinctif et le caractère fantasque qui, disait-on, l’accompagnait – ainsi que pour sa ressemblance avec Henri Leconte, un autre gaucher fameux. Sa vie aura été un roman qui finit mal, puisque le malheureux Volkov est décédé en octobre 2019 dans des circonstances obscures qui seraient liées aux problèmes d’alcool qu’il a connu. Seul hic, si vous nous passez l’expression dans ces circonstances : Volkov était en réalité droitier. Un pur droitier.
En tout cas, c’est de la main droite qu’il frappe ses premières balles au tennis, et brillamment puisqu’il intègre l’équipe nationale soviétique au début des années 80 dans les catégories jeunes. Mais à l’âge de 15 ans, une vilaine chute lui met l’épaule en capilotade. Après six mois d’absence, un autre accident la lui brise pour de bon. Pour Volkov, le tennis main droite est terminé. Il envisage alors un changement de sport, avant finalement de s’essayer, pour s’amuser, à jouer de la main gauche dans son club de Kaliningrad, à la frontière polonaise. Et là, c’est la révélation. Non seulement il rattrape très vite son niveau de droitier, mais il le dépasse allègrement. Cinq ans après, en 1987, il lance sa carrière professionnelle.
Celle-ci aurait-elle connu le même succès si le Russe était resté droitier ? On ne le saura jamais. L’intéressé, qui a passé l’arme à gauche au sens propre comme au sens figuré, n’est malheureusement plus là pour en débattre. Pas plus qu’on ne saura un jour si, comme l’a déclaré John McEnroe, Roger Federer aurait vraiment battu Rafael Nadal quasiment à chaque fois si ce dernier avait joué au tennis de la main droite, sa main naturelle. Ou si, comme le prétend son père, Maria Sharapova aurait gagné au moins dix Grands Chelems si elle avait joué de la main gauche, comme elle l’a fait pendant quasiment un an dans sa jeunesse avant de débarquer chez Bollettieri. Ou si le jeu offensif de Martina Navratilova aurait été aussi efficace si on l’avait forcée à jouer comme on l’a forcée à écrire, c’est-à-dire de sa mauvaise main (la droite). Tout cela restera à jamais de l’ordre du mystère, sinon du fantasme.

Antoine Hoang : « Les gauchers peuvent se permettre un coup moyen dans la diagonale. »
Cela dit, il s’avère que le cas d’Alexander Volkov n’est pas (totalement) unique. Dans un autre style, il y a l’exemple du Français Antoine Hoang, qui s’était révélé à Roland-Garros en 2019 en atteignant le 3e tour avec des succès sur Dzumhur et Verdasco. L’arme majeure du Tricolore ? Un revers à deux mains extraordinaire, un véritable « coup gauche » qui lui permet de figurer statistiquement en tête des joueurs de l’élite dont la prépondérance du revers sur le coup droit est la plus forte (plus forte encore qu’un Benoît Paire). Son secret ? Une prédisposition naturelle, certes. Mais aussi des années passées à jouer… de la main gauche.
À l’âge des benjamins (11-12 ans), alors qu’il figure déjà parmi les meilleurs du pays, Antoine – qui en a 25 aujourd’hui – connaît des problèmes de croissance, sources de tendinites récurrentes au niveau de l’épaule. Ses kinés lui conseillent de mettre la pédale douce sur le tennis en attendant de renforcer son articulation. Pour le jeune Varois, c’est hors de question. Il décide de continuer à s’entraîner en jouant régulièrement de la main gauche, au gré de ses douleurs.
Au départ, c’est juste un palliatif. Mais, privilège du jeune âge (et du talent), il progresse vite. Très vite. Tellement vite qu’au bout de trois ou quatre ans, alors que son épaule droite va pourtant mieux, son père, qui l’entraîne à l’époque, lui propose de continuer à développer un projet de jeu basé sur l’ambidextrie. « Mon père est très branché arts martiaux et bilatéralité, il a imaginé que le joueur du futur serait un joueur totalement ambidextre, capable de maîtriser tous les coups avec les deux mains, raconte celui qui a atteint le top 100 fin 2019. Son idée, c’était de jouer main droite dans la diagonale des égalités, et main gauche dans la diagonale des avantages, en privilégiant ainsi les diagonales de coup droit. »
Pendant quelque temps, Antoine poursuit donc ce dessein révolutionnaire. Il travaille tout à l’entraînement, brouille les pistes en compétition, change parfois de main en cours d’échange et s’amuse même à faire quelques matches entièrement main gauche, histoire de se fixer un défi supplémentaire quand la différence de niveau est trop flagrante. À 17 ans, il n’est pas loin de la plus totale symétrie. « Je jouais -4/6, -15 de la main droite et environ 2/6, 1/6 main gauche, estime-t-il. Du fond de court, j’avais la même qualité de balle des deux côtés, peut-être même un peu plus solide à gauche. Mais la principale différence, c’était au service. Je n’avais pas la même puissance main gauche et, arrivé à ce niveau, ça commençait à être un peu léger. »
Autre problème ressenti par Antoine : la difficulté à maîtriser autant de coups différents, donc la crainte de s’emmêler les pinceaux dans ses choix. Surtout que, dans son cas, le revers à deux mains apparaît déjà comme son gros point fort. Plus fort que son coup droit de gaucher. Quelle diagonale choisir, dès lors ? Pour ne plus se prendre la tête, l’ancien champion d’Europe par équipes des 13/14 ans (en 2009) prend la délicate décision de stopper le projet.
Mais il en a conservé des bienfaits, et le privilège aujourd’hui d’être l’un des mieux placés pour parler de la différence entre le jeu d’un gaucher et celui d’un droitier. « Le principal avantage des gauchers, c’est que, contrairement aux droitiers, ils peuvent se permettre de faire un coup “moyen” dans la diagonale de coup droit : s’ils trouvent la bonne zone, croisée, ça suffit à les protéger car derrière, c’est très dur pour les droitiers de réaccélérer en revers, développe le protégé d’Olivier Boudeau. Du coup, ça leur enlève pas mal de pression à l’échange. D’ailleurs, ils insistent en général assez longtemps dans cette diagonale : quatre ou cinq frappes, parfois plus. Les droitiers ne frappent jamais autant de coups droits d’affilée. Ils doivent prendre un risque avant. »
L’étude chiffrée sur la stratégie des gauchers réalisée par le statisticien suisse Fabrice Sbarro (voir p. 25), corrobore tout à fait l’analyse d’Antoine. Les gauchers sont plus efficaces en fond de court, particulièrement côté coup droit, ce qui n’étonnera personne. Plus étonnant peut-être, parce que ce n’est pas forcément l’idée que l’on se fait de leur tennis, ils sont moins performants à la volée et moins décisifs au service. Mais au fond, c’est lié : si les gauchers recherchent moins l’ace, c’est justement parce qu’ils se sentent plus forts à l’échange. Ils ont donc tendance à rechercher d’abord le pourcentage ainsi que, bien sûr, leurs zones préférentielles, pour ensuite s’instaurer comme les maîtres de l’échange.

Guillaume Pichot : « Je n’aurais jamais atteint ce niveau en restant droitier. »
Et leurs zones préférentielles, on les connaît. Bien sûr, il y a ce fameux service slicé sortant côté avantage qui fait cauchemarder plus d’un droitier au revers incertain. Mais contrairement à ce que dit la légende, ce n’est pas forcément le service avec lequel les gauchers font le plus la différence. « Le service de gaucher le plus efficace, c’est probablement le service extérieur côté égalité. Celui-là, pour des raisons que j’ignore, on a du mal à reproduire le même quand on est droitier », nous précise Guillaume Pichot, autre ovni tennistique qui a dû changer son fusil d’épaule en cours de route.
L’histoire de Guillaume est assez édifiante. Joueur « très moyen », selon ses dires, de la Ligue de l’Essonne, il s’apprête à monter 15/3 à l’âge de 16 ans – ce qui est tout de même respectable – quand il connaît un curieux problème à la main durant l’été 1996. Douleurs, blancheurs à l’extrémité des phalanges, alternance froid/chaud sur son membre engourdi… Le jeune homme ne comprend rien, sinon qu’il ne peut plus jouer au tennis. Il multiplie les examens qui ne donnent rien. Jusqu’à ce qu’un jour, Bernard Montalvan en personne, le médecin de l’équipe de France de Coupe Davis, trouve enfin la solution. Guillaume souffre en fait d’une malformation congénitale de l’épaule droite qui provoque une compression artérielle, avec pour conséquence une mauvaise irrigation sanguine de sa main directrice. Autrement dit : le tennis, c’est fini, sinon pour s’amuser.
Alors, quitte à s’amuser, le Francilien, aujourd’hui âgé de 38 ans, décide de le faire de la main gauche. Il repart complètement de zéro, avec en prime un changement de club puisque le sien ne souhaite plus dispenser le même nombre d’entraînements à cet ancien espoir devenu débutant. Au TC Bièvres, il goûte aux méthodes peu conventionnelles d’un jeune entraîneur désormais réputé, Ronan Lafaix, qui lui enseigne un nouveau tennis à base de sensations corporelles et de relâchement. Cela colle aux aspirations du joueur qui souhaite profiter de son changement de main pour ne pas répéter les mêmes défauts qu’il avait dans sa « vie d’avant », à savoir un tennis « forcé, crispé, avec des séquences de jeu ultra-classiques ».
L’ancien droitier au revers à deux mains devient donc, au départ, gaucher au revers à une main. Six mois plus tard, voyant que sa main droite va un peu mieux, il opte pour un revers à deux mains de gaucher. Puis il recommence à volleyer, à smasher et enfin à servir de la main droite, le tout en continuant à jouer main gauche du fond de court. Enfin, ultime évolution, il passe au coup droit à deux mains. Vous avez suivi ? Bravo. Parce que ses adversaires, eux, n’y comprennent rien. « Surtout que j’avais un jeu d’attaquant, basé sur les changements de rythme et les coups surprenants, comme les retours amortis. J’en ai fait devenir fou plus d’un ! »
N’empêche que le changement dépasse ses espérances les plus folles. Reparti non classé, il lui faut une saison pour dépasser l’échelon de 15/3 qu’il avait mis plusieurs années à atteindre – certes à un jeune âge – de la main droite. Et surtout, il ne s’arrête pas là. Sa progression exponentielle lui permet d’atteindre en cinq ans le classement de -4/6 et lui ouvre les portes de la Bob Brett Academy (l’ancêtre de l’académie Mouratoglou), à Montreuil, où il côtoie des joueurs comme Marcos Baghdatis.
Un temps, il se prend même à rêver d’un avenir dans le tennis. Avant de réaliser que sa vie n’est pas là. Mais qu’importe. « Ce qui est sûr et certain, c’est que je n’aurais jamais atteint ce niveau si j’avais joué de la main droite, jure le joueur. En tant que gaucher, j’ai développé une manière de jouer différente, basée sur davantage de créativité, de variété, et la recherche de zones particulières. D’accord, c’est lié aussi à mon changement de méthode d’entraînement. Mais je sentais que ma balle gênait davantage, parce que j’arrivais à trouver des angles que je ne trouvais pas en tant que droitier. »

Vincent Thomann : « Tous les points importants tombent dans la diagonale des gauchers. »
Vous nous direz, toutes les théories qui viennent d’être développées pour les gauchers, il n’y a pas de raison de ne pas les appliquer aux droitiers, dans l’autre diagonale. Sauf que les droitiers, qui représentent la grande majorité de la population (près de 90 %), jouent principalement contre d’autres droitiers. Donc ils ont moins l’habitude d’exploiter cette fameuse diagonale coup droit croisé sur revers.
Alors que pour les gauchers, c’est quelque chose de parfaitement naturel. « J’ai l’impression que tous les gauchers maîtrisent super bien le service slicé, qui leur permet de s’ouvrir le terrain opposé. Derrière, on constate que le coup droit long de ligne et le revers croisé sont aussi souvent des coups forts chez eux, confirme Antoine Hoang, dont la théorie est là encore validée par les stats. Ils s’appuient depuis tout petit sur ces séquences qui sont très fortes chez eux. D’ailleurs, on trouve beaucoup de joueurs gauchers de petit gabarit avec un style similaire, comme Gaston, Moutet, Nishioka ou Rios à son époque. Preuve qu’avec leurs schémas bien ancrés, les gauchers n’ont pas besoin d’une puissance incroyable pour gêner leurs adversaires. »
Et puis, il y a autre chose que nous fait remarquer Vincent Thomann, dont le parcours mérite lui aussi d’être conté – on va le faire. Certes, il y a bien deux diagonales en tennis mais il y en a une qui vaut un peu plus que l’autre : celle des avantages, où se jouent deux balles de jeu sur trois. « Ainsi, on a l’impression que tous les points importants tombent dans la diagonale préférentielle des gauchers », souligne Vincent, qui n’est autre que le grand frère de Nicolas Thomann, cet ancien joueur alsacien classé 106e mondial en 2003 et qui avait battu Agassi à Atlanta en 2001. Pas mal pour un joueur seulement classé 15/1 à 18 ans !
Vincent, qui enseigne aujourd’hui le tennis en Suisse, a été lui-même l’entraîneur de son frangin après avoir découvert le tennis tardivement, à treize ans, alors qu’il jouait au handball auparavant. Six ans plus tard, à 19 ans, il monte -2/6, avec un style classique de contreur droitier au revers à deux mains. Et puis, vers 26 ans, les premières douleurs apparaissent, sournoisement. Les fautes s’enchaînent curieusement côté coup droit. Et les défaites s’accumulent, inexplicablement. Il faudra un an avant que le diagnostic ne soit posé : maladie de Kienbock, une ostéonécrose du semi-lunaire, l’os qui fait la jonction entre la main et le poignet. Plus de vingt ans après, Vincent ne peut toujours pas faire des exercices simples comme des pompes, du développé-couché ou tout simplement faire jouer correctement son articulation. Alors jouer au tennis…
Courageusement, le Mulhousien fait donc lui aussi le grand saut. Il change son bras armé. C’est vital pour lui, non seulement afin de poursuivre sa passion, mais surtout son métier d’enseignant. À l’approche de la trentaine, le défi est immense. Mais son simple sens du jeu et sa condition physique au-dessus de la moyenne lui permettent de gagner en quelques mois en 3e série. Un peu comme un Arnaud Clément, qui, rappelons-nous, s’était essayé à un tournoi de la main gauche pour tromper l’ennui, en 2003, alors qu’il souffrait d’une tendinite au poignet droit. Il avait gagné jusqu’à 30 rien qu’avec ses jambes.
Mais Arnaud n’avait pas, et pour cause, poussé l’expérience plus loin. Au contraire de Vincent qui, finalement, mettra un an à monter 15/3 et cinq à monter à 5/6, son meilleur classement de gaucher, avec quelques perfs à 4/6. Not too bad… Comme les autres, il témoigne que les coups au-dessus de la tête sont particulièrement difficiles à acquérir. « Mais même avec mon service de gaucher assez minable, je voyais bien que je gênais mes adversaires grâce aux angles que j’arrivais à trouver. » Les angles, encore et toujours. En quelque sorte, la pierre angulaire du jeu du gaucher. Dans un sens comme dans l’autre. « Un gaucher a besoin d’angles pour gêner ses adversaires, mais du coup, il a horreur qu’on le lui en prive. En tant que gaucher, je détestais qu’on me fixe au centre alors qu’en tant que droitier, cela ne me gênait pas du tout », synthétise le Zurichois d’adoption.

Mais où sont les gauchères ?
Pour générer un angle, il faut certes avoir une diagonale qui s’ouvre. Mais il faut aussi avoir de la puissance, une capacité à générer un gros spin, pour l’accentuer. Serait-ce l’explication ? Toujours est-il qu’en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’au plus haut niveau, les gauchers sont beaucoup plus représentés que les gauchères. Tant en quantité qu’en qualité.
Dans l’histoire du jeu, alors que 500 Grands Chelems pile ont été disputés (avant l’Open d’Australie 2021), 77 ont été enlevés par des gauchers, soit 15,4 %. Ce qui est légèrement supérieur à leur représentation actuelle dans le top 100 (14 % fin 2020). Et ce grâce à un total de 23 joueurs différents : du tout premier, Beals Wright aux Internationaux des États-Unis 1905, au dernier, Rafael Nadal à Roland-Garros 2020, en passant par de grandes figures du jeu comme Laver, Connors ou McEnroe. Chez les femmes, c’est à peine la moitié (8 %). Hormis Navratilova et Seles, les plus emblématiques représentantes de la gent des « gauches pattes », c’est un peu le vide : seulement sept gauchères au total ont remporté des titres majeurs, Angelique Kerber étant la dernière d’entre elles.
On peut même parler de vide sidéral en ce qui concerne les gauchères françaises. Hormis Émilie Loit, on est bien en peine d’en citer une autre qui aurait atteint le top 30. Fin 2020 toujours, alors que onze gauchères pointaient dans le top 100, la première Française, Margaux Orange, figurait pour sa part au-delà de la 700e place mondiale. Une explication, Émilie ? « Aucune, non, répond la Cherbourgeoise qui travaille désormais pour le service vidéo de la FFT. C’est assez étrange car pour ma part, j’avais le sentiment de tirer largement profit du fait d’être gauchère. D’autant plus que mon jeu était beaucoup articulé autour de mon coup droit. Cela forçait mes adversaires à changer leur plan de jeu habituel. »
Cette différence hommes/femmes, si elle s’avérait, n’irait pas dans le sens d’un autre avantage présupposé des gauchers : celui d’un fonctionnement neuromoteur plus rapide. Plusieurs études ont en tout cas été menées dans ce sens et diverses théories avancées. La plus récurrente d’entre elles est qu’en raison du fonctionnement croisé du circuit neurotransmetteur, les gauchers sollicitent davantage l’hémisphère droit de leur cerveau, celui qui commande les déplacements dans l’espace notamment. Pour schématiser, c’est le cerveau de la créativité et de l’intuition, par opposition au cerveau gauche qui est un cerveau plus scientifique.
D’où l’idée forte selon laquelle les gauchers seraient aussi ces joueurs un peu artistes, créatifs et souvent offensifs. Sauf que les gauchers, ce sont aussi des joueurs comme Ramos-Vinolas ou Delbonis, dont le tennis paraît plus porté sur le rationnel que sur l’intuitif. Difficile, donc, d’émettre des certitudes absolues à propos d’un organe aussi mystérieux que le cerveau, dont on ne comprend qu’un infime pourcentage des capacités.
En conclusion, l’avantage des gauchers n’est probablement pas une légende aux dires des nombreux témoignages allant dans ce sens. Mais il n’est pas non plus si prégnant que ça d’après les chiffres. En réalité, il est sans doute très variable selon le niveau et, bien sûr, selon le profil de l’adversaire. Il y a peut-être aussi un aspect psychologique, comme l’écrivait Michaël Llodra dans un billet pour le Huffington Post en 2016, citant l’exemple d’un match contre Wawrinka à Wimbledon qu’il avait joué (et gagné) blessé parce qu’il savait que le Suisse abhorrait à l’époque affronter des gauchers. Au bout du compte, comme le rappelle Rafael Nadal avec le bon sens qu’on lui connaît, « le principal avantage des gauchers, c’est avant tout leur rareté ». Une analyse pas plus maladroite qu’une autre, somme toute.

Le jeu des gauchers par les chiffres
Afin d’analyser de la manière la plus objective possible l’avantage supposé des gauchers, Fabrice Sbarro, un entraîneur-statisticien suisse qui travaille notamment avec le clan de Daniil Medvedev, a pris le temps pour Courts de réaliser une étude approfondie sur leur façon de jouer.
Pour ce faire, il a sélectionné un échantillon de treize gauchers ayant été classés dans le top 100 en 2019 : Delbonis, Humbert, Kopfer, Lopez, Mannarino, Monteiro, Nadal, Norrie, Ramos-Vinolas, Pella, Shapovalov, Verdasco et Vesely. Puis il a sorti un échantillon de points joués par ces derniers contre des adversaires droitiers, en faisant en sorte que ces adversaires aient la même taille moyenne (environ 1,87 m) et que tout le monde ait le même ratio de points gagnés/perdus. Voici les (principaux) enseignements :
Les gauchers prennent moins de risques en première balle, avec un taux de pourcentage supérieur (62,7 % contre 61,2 %) et un ratio d’aces/services gagnants inférieur (31,8 % contre 33,1 %).
Les gauchers ont un plus fort pourcentage de points gagnés sur première balle quand ils servent la zone extérieure côté égalité (73,7 % contre 71,8 %).
En revanche, contrairement à la légende, les gauchers font moins de points que les droitiers quand ils servent leur première balle « extérieur » côté avantage (70,1 % contre 71,4 %). Mais ce chiffre est contrebalancé par leur pourcentage plus important dans cette zone. Quand ils y vont, ce n’est pas tant pour rechercher le K.-O. que pour entamer l’échange de manière favorable. Alors que pour les droitiers, c’est l’inverse.
Les gauchers encaissent en moyenne 10,6 % de retours gagnants (ou fautes provoquées sur retours) en moins que les droitiers. C’est beaucoup. Et cela montre bien que leur service gêne davantage.
Chose étonnante, les gauchers sont meilleurs en retour de revers que de coup droit : 30,5 % de points gagnés lorsqu’on leur sert une première balle sur le revers, contre 27,2 % sur le coup droit. Et pourtant, on leur sert davantage sur le revers. Probablement l’habitude de jouer contre des droitiers qui, eux, sont légèrement meilleurs en retour de coup droit (28,6 % contre 28 %).
Les gauchers font en moyenne 4 % de plus de points gagnants (ou points provoqués) en coup droit que les droitiers. Et la différence est particulièrement forte en coup droit long de ligne, où ils ont 20,8 % de chances de plus de marquer le point quand ils vont chercher cette zone (moins fréquemment certes, mais de manière plus décisive).
Les gauchers font en moyenne 3,2 % de plus de points gagnants (ou points provoqués) en revers que les droitiers. Surtout, ils font 8,8 % de fautes en moins.
À la volée, les gauchers font en moyenne 14,8 % en moins de points gagnants (ou points provoqués) que les droitiers.
Article publié dans COURTS n° 10, hiver 2021.