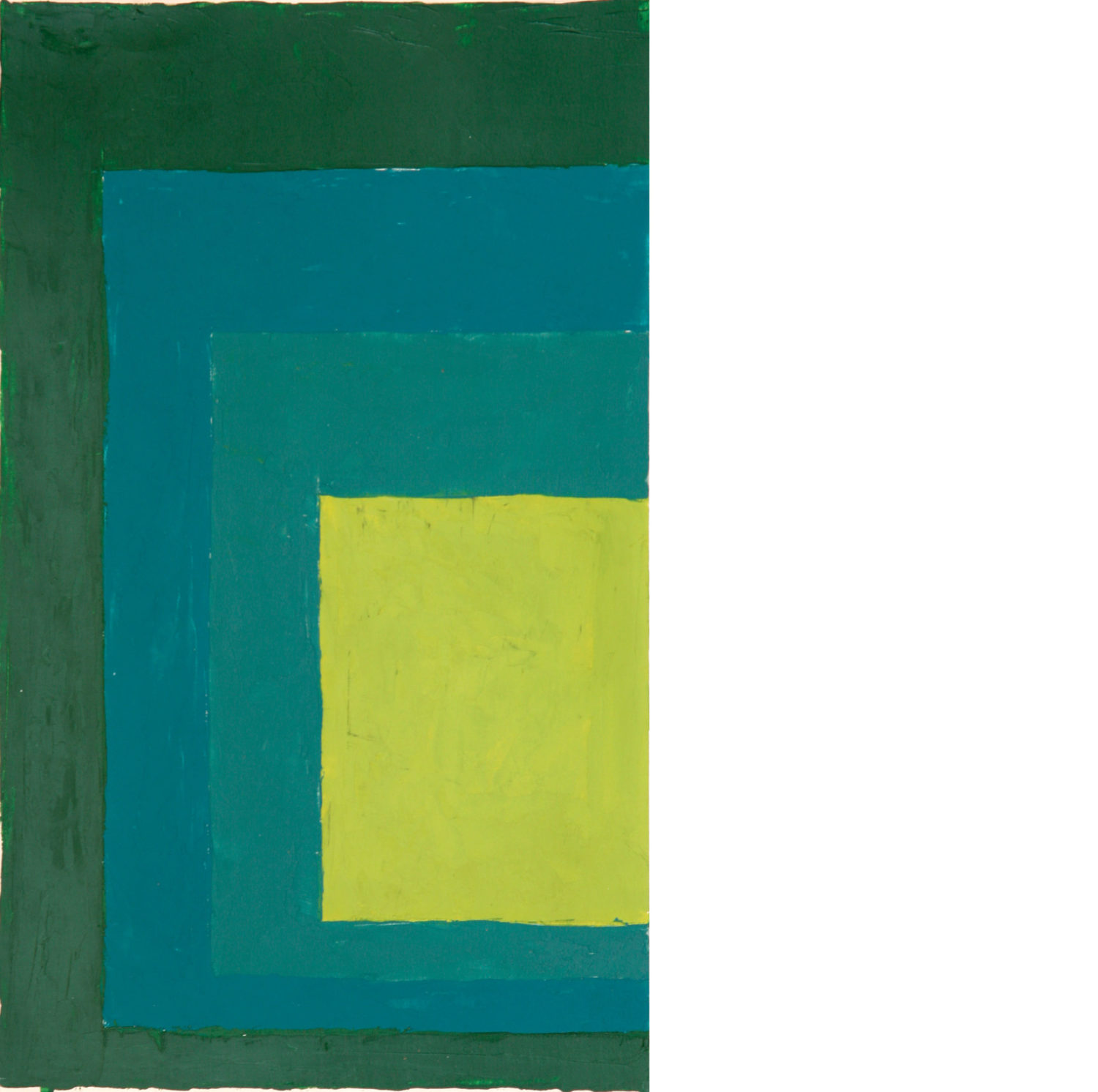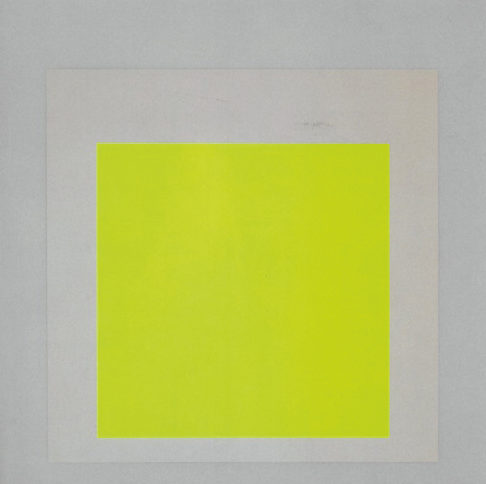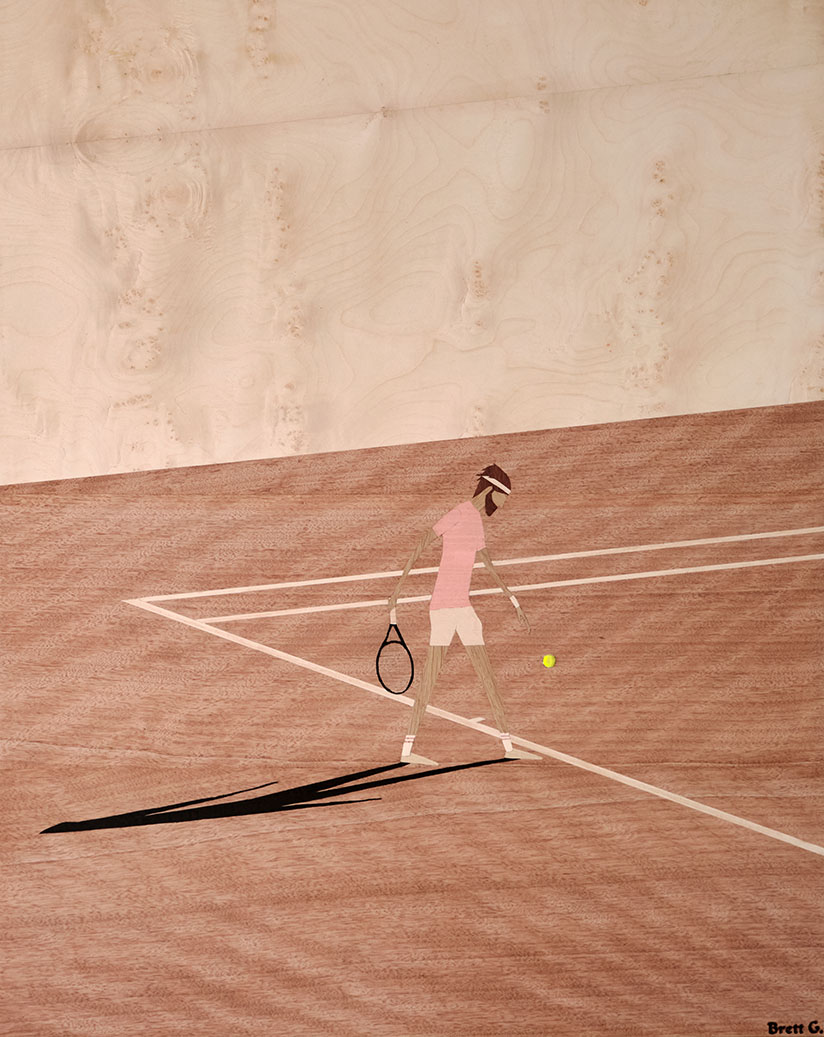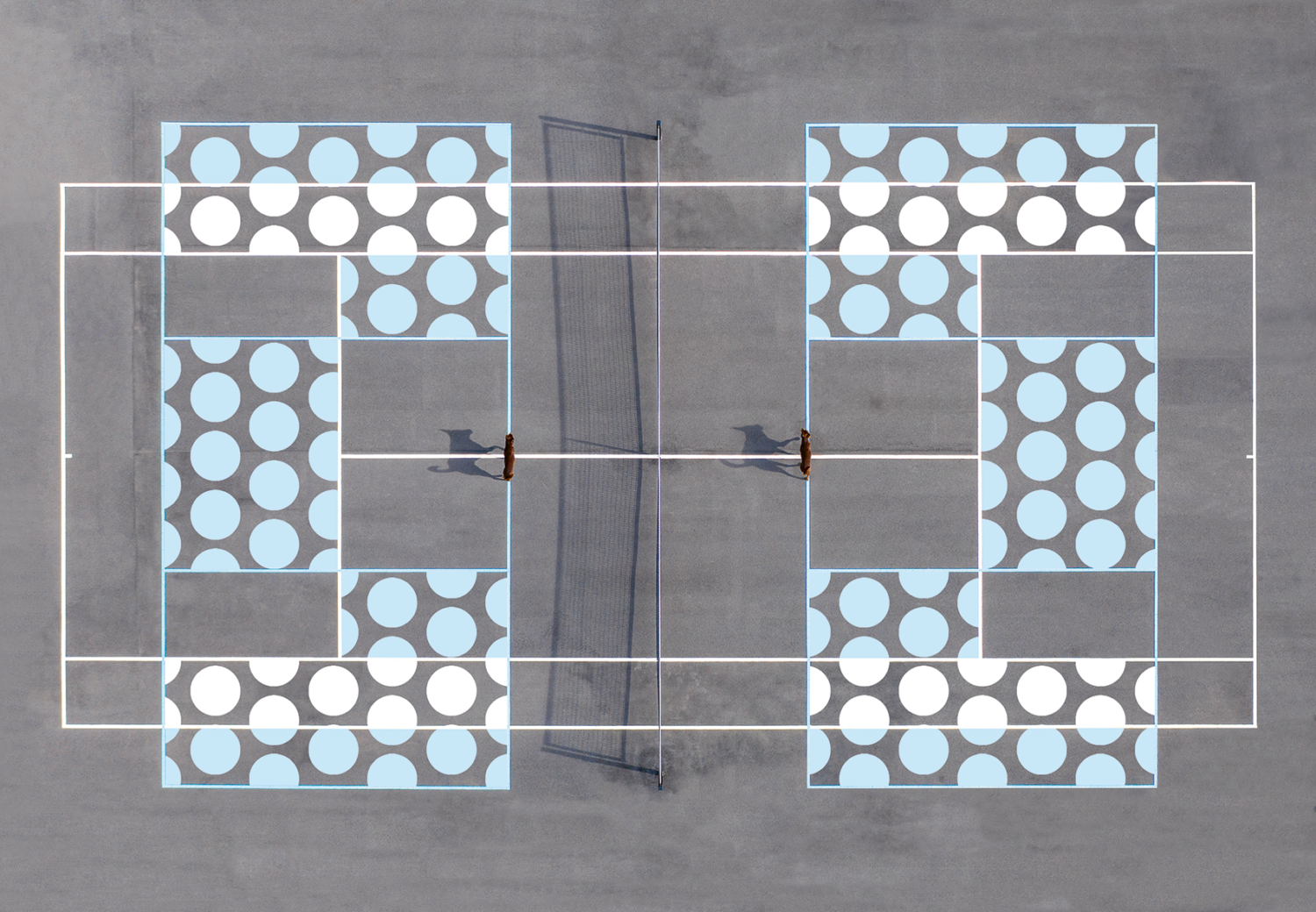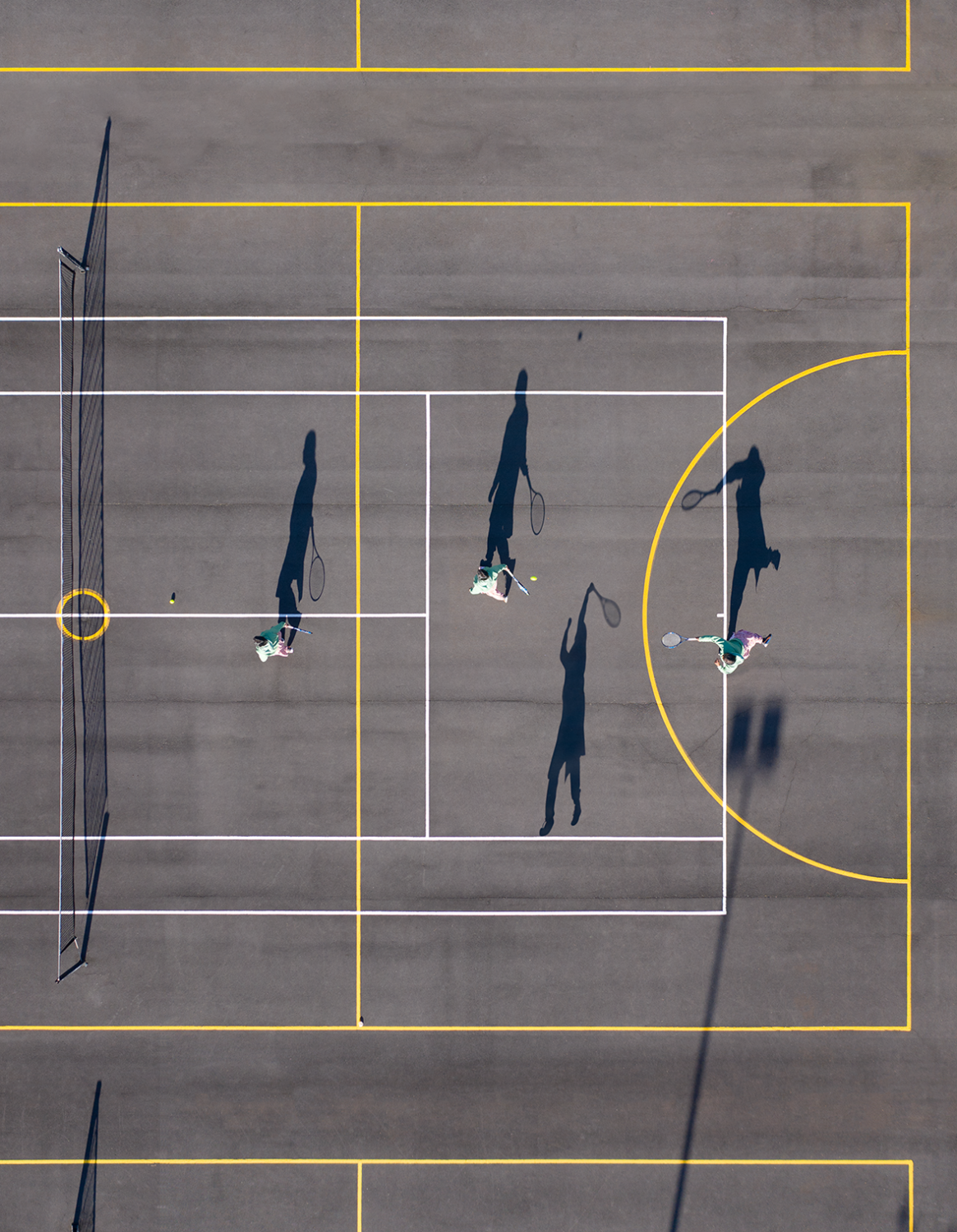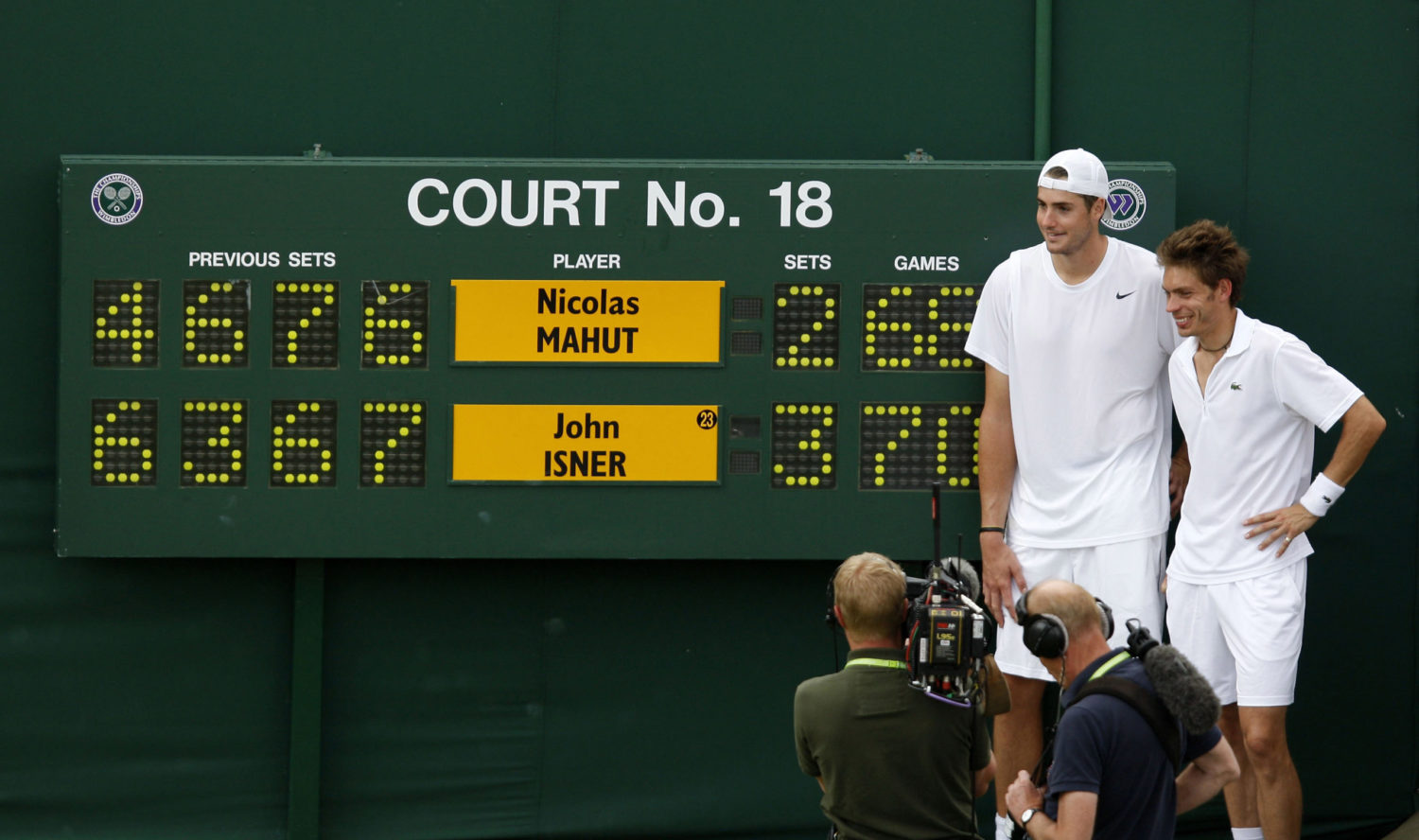Sans Filet
Une émission qui a la cote
Par Bastien Guy

Aux antipodes du format conventionnel des médias traditionnels, dits mainstreams, l’émission Sans Filet, diffusée sur Winamax TV, apporte un véritable vent de fraîcheur dans l’horizon tennistique. Orchestré par Marie Dib Beljean accompagnée de ses fidèles acolytes, le trublion Benoît Maylin, le journaliste tout terrain Julien Pichené et l’ancien joueur professionnel Julien Varlet, le programme mêle divertissement, humour déjanté mais aussi pédagogie et information. Focus sur une émission qui est bien plus qu’un simple programme de paris sportifs.
Imaginez une bande de potes autour d’une table. Des discussions passionnées et passionnantes autour du tennis. Une actualité du circuit passée au crible et des conseils avisés en matière de paris sportifs. Le tout dans une ambiance chaleureuse. Ajoutez une mini table de ping-pong et des parties endiablées. Saupoudrez le tout d’un grain de folie et vous obtenez l’émission Sans Filet. « C’est du champagne tout simplement. » Une expression parmi tant d’autres, signée Benoît Maylin, pour décrire cette pièce de théâtre dont il est l’acteur principal.

Casser les codes du tennis
Amuseur public et pilier incontournable du programme, celui qui déteste se dire journaliste s’est fait un nom dans le petit milieu du tennis grâce à ses interventions complètement décalées. Tombé dans la marmite grâce à son idole Borg et ses souvenirs d’enfant à Roland-Garros où il « passait par les cuisines discrètement parce qu’il ne pouvait pas se payer de place », Benoît possède un parcours aussi atypique que sa personnalité décoiffante. « Je n’ai jamais suivi d’école de journalisme. Ce mot ne veut rien dire pour moi. C’est simplement être curieux et s’intéresser au fonctionnement des joueurs. Je ne suis pas un journaliste, je suis un fan », insiste-t-il.
Passé, entre autres, par ESPN Classic Sport, Eurosport ou encore Tennis Magazine, ce pur autodidacte a écumé bon nombre de médias prestigieux. Mais c’est surtout grâce à ses chroniques déjantées sur la chaîne L’Équipe TV qu’il a acquis sa renommée de troubadour du tennis. Le Monfisien, le Cannibale de Bâle (salué par Sa Majesté Federer en personne !), Tsongix, Drakulic… Avec ses nombreuses caricatures farfelues de joueurs et ses déguisements clownesques, Benoît Maylin a pris pour habitude de décortiquer le monde du tennis avec humour. Un milieu qu’il a eu la chance de découvrir de l’intérieur à une époque où les réseaux sociaux sommeillaient encore et le circuit était moins aseptisé que maintenant. « De 1997 à 2002, j’étais plus souvent sur le Tour que chez moi. Comme je faisais de la télévision, j’étais identifié et j’avais cette image de clown caricaturiste. À l’époque, on avait une relation privilégiée avec les joueurs. On pouvait discuter et sortir avec eux. Il y avait beaucoup de partage. Mes deux plus grands copains sont Marat Safin et Marc Rosset. » Deux joueurs réputés pour leur capacité à fissurer, leurs frasques sur et en dehors du court mais surtout pour une allergie commune à la langue de bois. Une caractéristique partagée et défendue bec et ongles par Benoît : « Le journalisme actuel est trop rigide. C’est trop cadré. Je n’aime absolument pas. Les gens ne veulent pas ça, ils veulent du spectacle. Je veux que ce soit festif, informatif, drôle et passionné. Pour l’instant, Sans Filet, c’est ça. Si je ne ressens plus cela, je partirai comme j’ai pu le faire lors de mes expériences professionnelles précédentes. »
2018 : le début de l’aventure
Depuis 2018, la vie de l’électron libre a donc pris un nouveau tournant. Grâce à un autre personnage public bien connu de la télévision, Daniel Riolo, avec qui il a noué une forte amitié en commentant des matches à la radio, Benoît a embarqué dans le navire Winamax. « Initialement, on avait appelé Daniel pour faire une émission de tennis dans la peau du consultant vedette. Mais il avait reçu l’interdiction de se lancer dans le projet parce qu’il travaillait pour RMC. Après avoir refusé l’offre, il a pensé tout de suite à moi. C’est lui qui m’a permis de rentrer dans cette famille de dingues qu’est Winamax. C’est la première boîte que je connais avec cette liberté de ton depuis l’époque de Pathé Sport », explique-t-il.
Peu de temps avant, en novembre 2017, la journaliste Marie Dib Beljean, passée notamment par Eurosport, est contactée par le site de paris en ligne qui souhaite « monter une WEB TV ». Le tennis a toujours eu une place importante dans sa famille et c’est donc tout naturellement que cette ex-15/2 chez les amatrices s’est lancée dans la présentation de cette nouvelle émission. Avec comme seule directive : « carte blanche ». C’est ainsi que le tout premier « Sans Filet » est né en janvier 2018. Un baptême du feu que redoutait Marie, découvrant pour la toute première fois le rôle d’animatrice et le déroutant Benoît par la même occasion : « Comme tous les amoureux de tennis, je connaissais Benoît via ses chroniques à l’Équipe. C’est un fort caractère et je n’avais jamais présenté d’émission avant Sans Filet, donc j’étais très angoissée à l’idée de « driver » une personnalité comme lui. » Heureusement, le binôme trouve rapidement ses automatismes, formant une complicité naturelle dès sa première apparition. « Il m’a directement mise à l’aise. Benoît c’est un peu mon mentor. J’ai commencé avec lui, j’ai tout appris avec lui. C’est un monstre de travail. Un passionné passionnant. » Un bel hommage que le principal intéressé appréciera.

« Une équipe de Coupe Davis »
Après cette grande première plus que concluante, la petite équipe décide de s’agrandir, animée toujours par le même refrain : « plus on est de fous, plus on rit ». Expert en la matière, il ne faut que quelques minutes au théâtral Benoît pour trouver ses futurs camarades de jeu. « J’avais déjà mon équipe de Coupe Davis en tête. J’ai toujours bossé avec eux puisqu’il n’y a pas mieux au monde. Julien Varlet est le number one. On s’est connus à l’époque d’ESPN Classic à Londres où nous commentions ensemble. Si tu veux être ami avec quelqu’un sur cette planète, il faut choisir ce gars. » Derrière cette montagne de compliments se cache un ancien joueur professionnel, classé 120e mondial à son top. Apprécié de tous pour la bonhommie qui le caractérise, Julien Varlet a toujours fait l’unanimité. D’abord sur le court avec une carrière plus qu’honorable. Originaire de Cambrai, le Nordiste a disputé « une quinzaine de Grands Chelems dont le tableau final de Roland-Garros et de l’Open d’Australie ainsi qu’un quart de finale à Milan (ndlr : l’équivalent d’un ATP 500 aujourd’hui). »
Au cours de ses neuf années arpentées sur le circuit, le Frenchy a eu le privilège de croiser deux fois sur sa route le futur ogre de l’ocre, Rafael Nadal, en se payant même le luxe de lui chiper une manche sur sa surface de prédilection. « Je lui avais pris un set sur terre battue en 2003 à Aix-en-Provence alors que j’étais 165e au classement (ndlr : 5-7 6-1 6-4). » Varlet a été pendant huit ans le seul joueur hors du Top 100 à ravir un set à Rafa sur terre avant que Paolo Lorenzi n’accomplisse la même prouesse en 2011 (un exploit imité depuis par une poignée d’autres tennismen). Détenteur un temps de ce record assez unique, il était écrit d’avance que le souriant gaillard allait apporter son œil expert dans une émission tout aussi originale. « Ce qui est top à Winamax c’est qu’on a entièrement carte blanche. On se fend bien la poire tout en essayant d’apporter du sérieux et des analyses techniques. J’ai un peu le rôle du consultant tennis. J’essaye de guider au mieux les parieurs dans leurs choix avec mon expérience d’ancien joueur. »
Retraité des courts depuis 2006, Julien jongle désormais avec sa double casquette : celle de consultant pour le groupe Canal+ et une plus récente, celle de coach de jeunes talents à la French Touch Academy, basée au Cap d’Agde. Malgré son quotidien bien rempli, il parvient à agencer son emploi du temps du mieux qu’il peut pour intervenir dans Sans Filet. « Je me suis calé par rapport à mon planning avec Canal+. J’ai un certain nombre de jours et de tournois à faire avec eux. Quand je monte à Paris, j’en profite pour réintégrer l’équipe de Winamax. Ils aimeraient que je sois là plus souvent mais ce n’est pas simple », concède-t-il.
Un mal pour un bien puisque cette fréquence d’apparition ponctuelle a permis au « number two » de Benoît, un autre Julien, de tirer son épingle du jeu, d’abord dans un rôle de joker de luxe, puis désormais de chroniqueur emblématique de l’émission. « Pichené, c’est simple, il est fou. C’est le Jean-Pierre Léaud du tennis. Il est extraordinaire dans sa folie. On se complète bien mais peut-être un peu trop. » Venant de la part du diablotin Maylin, ces quelques mots en disent long sur ce joyeux drille à la culture tennis aussi riche que son vocabulaire. S’il brille par son éloquence et ses envolées lyriques, Julien Pichené ou « la Piche », de son surnom, est aussi capable de craquages légendaires. En témoigne cet énorme cri poussé en ouverture de l’émission spécial Roland-Garros du 10 juin 2021, référence à celui lâché par Djokovic, déchirant la nuit, après sa victoire contre Berrettini en quart de finale. Avec sa douce folie communicative, le show Pichené débute dès sa première intervention avec son fameux « Bonjour ! », promesse de bonne humeur. Humour et passion riment donc avec ce journaliste de formation, pris par le virus du tennis dans les années 90 devant le tournoi de Bercy. « Je ne m’intéresse pas à grand-chose mais quand je m’y intéresse, je ne fais pas semblant, j’y vais à fond », s’amuse-t-il.
Durant toute son adolescence, il sortira les vieux grimoires poussiéreux du grenier pour étudier la grande histoire de ce sport qu’il aime tant. « J’ai commencé à faire tous les tableaux, à fouiller dans les archives, à trouver de vieux magazines et à reconstituer l’histoire du tennis avec les pièces de puzzle que je parvenais à rassembler. J’ai toujours eu cette fascination pour le passé et le vintage, je voulais rattraper tout le retard que j’avais pris. » Cette passion ne le quittera plus. Parmi la dizaine d’ouvrages qu’il a écrits et co-écrits, tous (ou presque) sont empreints de cette nostalgie. Si l’écriture occupe une place importante dans sa vie, Julien Pichené maîtrise également tous les autres supports du métier de journaliste. « J’ai travaillé dans différentes radios comme Europe 1, RMC, France Info, Nostalgie… J’ai fait pas mal de télévision également puis j’ai rencontré Benoît à L’Équipe 21. Il m’a rappelé plusieurs fois autour de différents projets en rapport avec le tennis dont celui de l’émission Sans Filet il y a un an. » Le franc-parler et le grain de folie de Julien ont fait mouche dès le début. « J’ai fait ce petit test à Winamax en 2020 à la fin de Roland-Garros puis tout s’est fait naturellement. J’ai mordu à l’hameçon et ça fait un an que j’y suis et que je m’y sens bien. »
Et cela se ressent en tant que spectateur. On prend plaisir à suivre cet équipage qui ne se prend pas au sérieux. Toujours en métaphores et en images amusantes dont il a le secret, Benoît, le donneur de surnoms, est probablement celui qui décrit le mieux l’osmose naturelle qui émane du plateau. « Julien Varlet, je l’appelais Obésix au début, il détestait ça (rires). Il est cet irréductible Gaulois qui porte des menhirs. Il est indestructible et moi à côté, je suis une espèce de farfadet, une sorte d’Idéfix. Pour Pichené, j’ai eu un peu plus de mal puis je suis parti dans Tintin et Milou. C’est mon Capitaine Haddock. Le mec qui te lâche des moules à gaufre et des bachi-bouzouks à chaque fin de phrase. »
Des personnages échappés de bandes des-
sinées que parvient à canaliser la chef d’orchestre Marie Dib Beljean, éblouissante de naturel. « Heureusement qu’elle est là pour nous calmer par moment », s’amuse Julien Varlet. En effet, sans cadre, le plateau pourrait rapidement basculer dans la cacophonie générale avec ce trio inarrêtable. Mais que nenni. Avec autant de prestance que de candeur, l’animatrice mène la danse avec brio. « C’est notre capitaine de Coupe Davis. Marie est extraordinaire là-dedans. Être cool, bon enfant, à l’écoute, redistribuer les cartes, donner la petite information qui va bien, créer une atmosphère sur un plateau… Il y a deux personnes parfaites dans ce rôle-là. Olivier Ménard et Marie Dib Beljean. C’est une personne simple qui aime son boulot. Elle n’a qu’un objectif, c’est que tout le monde ait passé un bon moment. C’est très rare », souligne Maylin, son mentor. Un magnifique hommage pour la journaliste qui se réjouit d’avoir « trouvé sa place dans cette bande bienveillante ».

Pari gagnant
Si cette bonne humeur ambiante la résume très bien et que ses protagonistes utilisent les termes « spec-tacle » ou « divertissement » pour la décrire, Sans Filet n’en reste pas moins une émission structurée et informative. Découpé en plusieurs séquences avec notamment le traditionnel « Daily Mayl » en guise d’ouverture, narré par Benoît Maylin, qui revient sur l’actualité brûlante du circuit, le programme s’attarde sur l’examen minutieux et l’analyse pointilleuse des cotes des matches du moment. « On essaye de transmettre et d’apporter des choses intéressantes mais surtout pertinentes. L’objectif étant de faire gagner les parieurs qui nous écoutent et de les fidéliser », explique Julien Varlet. Si les messages fleuris des joueurs perdants en colère font malheureusement partie du jeu, l’ancien tennisman professionnel préfère se concentrer sur le positif : « Il y a fort heureusement des messages très chaleureux comme celui que j’ai reçu dernièrement d’une personne qui est partie en vacances en suivant mes conseils. J’essaye d’apporter modestement une certaine pertinence avec mon expérience du jeu mais je ne détiens pas la vérité. Si je l’avais, je serais déjà aux Bahamas (rires). » De son côté, l’autre Julien collectionne les messages bienveillants depuis son arrivée dans l’équipe. « Les joueurs aiment bien me partager leurs gains ou me demandent des conseils. Ils ont souvent des bonnes idées et ils font des super combos. J’essaye de leur répondre à tous dans la mesure du possible. C’est quelques dizaines de messages par semaine et plusieurs centaines sur l’année. »
Au-delà de l’aspect « paris sportifs », le programme Sans Filet, diffusé sur les plateformes Youtube, Twitch et Molotov, se présente comme le rendez-vous quotidien à ne pas manquer pour les fans de tennis. « Le rythme de fréquence de l’émission est du 5/7j sur les ATP 250 et ATP 500, 6/7j pendant les Masters 1000 et tous les jours quand c’est un Grand Chelem. C’est donc très intense ! », explique Marie Dib Beljean, fière de cette « proximité avec les viewers » qui intéragissent durant l’émission.
À des centaines de kilomètres des locaux parisiens de Winamax, Julien Varlet est également témoin de cet engouement positif dans le Sud : « On est la seule émission tennis. Il faut le souligner. Au Cap d’Agde, les gens m’ont parlé de Sans Filet lors d’une récente grosse compétition. Dans le lot, il n’y avait pas que des parieurs. Cela prouve que les gens regardent encore du tennis et que ça les fait vibrer. »
2022 : une nouvelle étape
Bien que néophyte dans le paysage audiovisuel tennistique, l’émission Sans Filet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec son nouveau plateau XXL créé sur mesure pour cette nouvelle saison, le programme a franchi un palier supplémentaire. « Winamax nous donne la possibilité de le faire. C’est une boîte qui met des moyens énormes pour développer des projets », souligne Benoît Maylin avant de présenter d’autres concepts prévus dans un avenir proche : « Winamax va me donner la possibilité de réaliser des interviews longs formats. À l’image du film ‘ Dans la peau de John Malkovitch’, je veux rentrer dans la tête des pros. L’aspect mental, psychologique et psychique c’est ce qui m’intéresse. Je veux savoir comment ils pensent, comment ils ont grandi, comment ils abordent un match, leur carrière… Il va y avoir d’énormes surprises prochainement. » Un programme alléchant pour les aficionados de l’émission qui pourront même bientôt affronter le dieu auto-proclamé du ping-pong : Benoît Maylin. « On compte organiser une rencontre avec les fans de l’émission autour d’un tournoi de mini ping », explique Marie.
Du grand saut dans l’inconnu en janvier 2018 jusqu’à ce début de saison 2022, quatre années de rires et de débats enflammés ont jalonné le programme Sans Filet. Ce dernier a d’ailleurs franchi récemment la barre des 500 diffusions. « Est-ce que les autres émissions ont autant d’espace de liberté que nous ? Je ne suis pas sûr que tu puisses te permettre sur une chaîne un peu plus traditionnelle de dire que tu viens de voir un match de merde ou que tu ne peux pas blairer tel joueur… À la télévision, ils sont un peu en pilotage automatique, c’est formel. Ce n’est pas du tout leur faute, c’est juste que c’est le format des médias mainstreams qui veut cela. C’est très bien, qu’ils continuent à être conventionnels, on paraît originaux comme ça à côté (rires) ! », conclut Julien Pichené.
À la manière du journaliste sportif, il convient de ne pas comparer et confronter ces deux formats que tout oppose. Au contraire, ils se complètent à merveille et permettent d’avoir une vision d’ensemble sur la planète tennis. En résumé, Sans Filet offre une voie alternative en sortant des sentiers battus. Pas d’innovation sans prise de risque. Pas d’originalité sans chroniqueur déjanté et puis surtout, pas de tennis Sans Filet !
Article publié dans COURTS n° 12, printemps 2022.