Week-end à New York
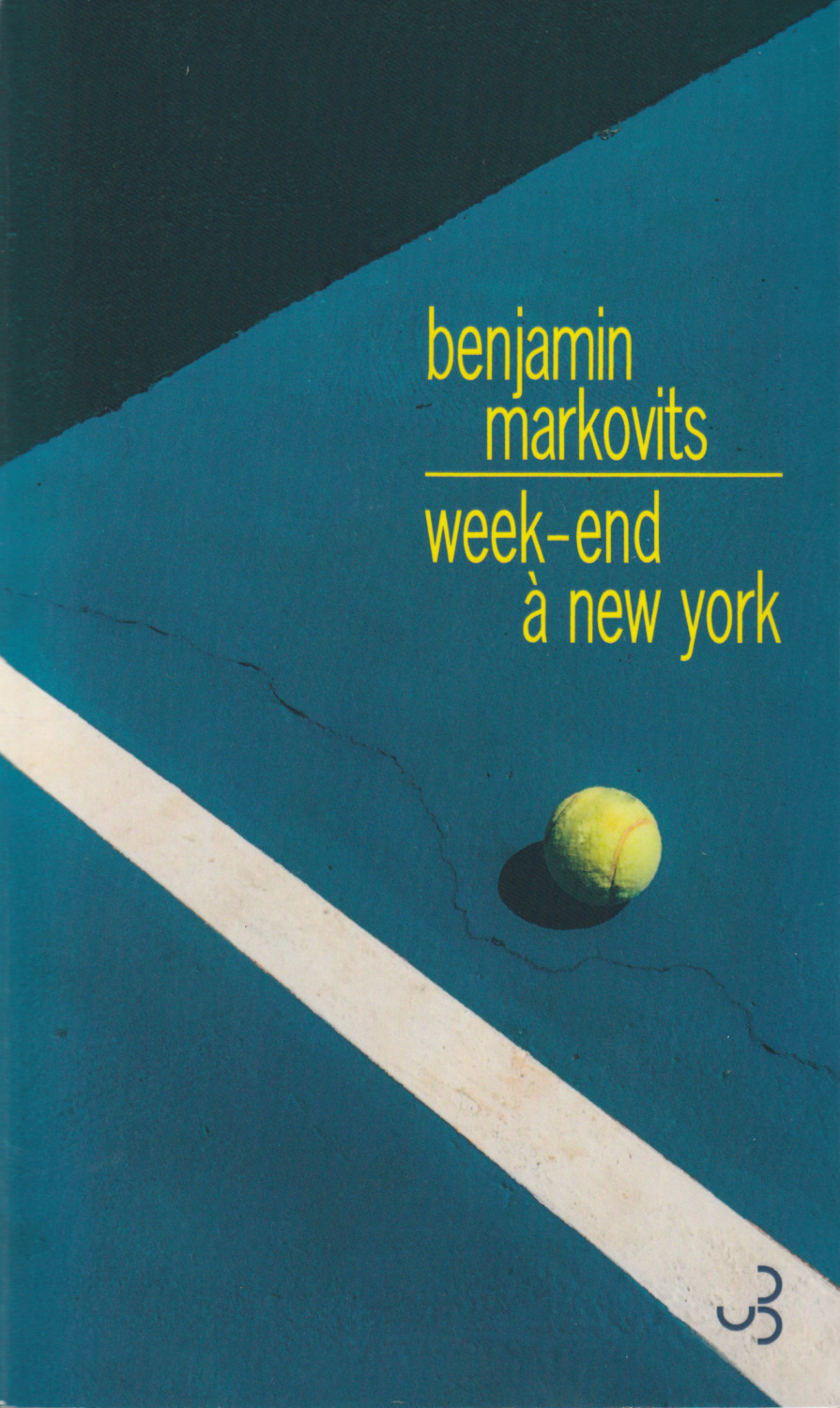
« Les familles ne se ressemblent pas toutes entre elles, mais leurs personnages sont souvent les mêmes que ceux des livres. » C’est un peu ce que nous explique Benjamin Markovits dans son huitième roman. L’auteur s’attache à y décrypter la communication d’une cellule familiale transculturelle. En clair et entre les lignes, la psychologie d’un langage mimétique et codé.
Le clan Essinger se réunit à New York pour voir jouer Paul, tennisman professionnel, qualifié une nouvelle et peut-être dernière fois à l’US Open. Ses parents viennent de loin, d’Europe et des quatre coins des États-Unis, pour l’encourager. Bill, fier et surpris par la carrière de joueur de son fils, n’aurait jamais osé imaginer qu’un de ses enfants connaisse un tel succès. Liesel, sa mère, ne comprend pas vraiment. Il s’agit de sport, ça la dépasse un peu. Elle vit aux États-Unis depuis longtemps mais elle est d’origine germanique, et associe les valeurs du sport et de la compétition à l’éducation américaine et étrangère reçue par ses enfants.
« D’emblée, elle avait aimé les Juifs américains. Qui sait pourquoi – une attirance culturelle. Son mari était Juif, ses enfants vaguement Juifs et elle était assise dans Washington Square, pour aller prendre un petit déjeuner avec une journaliste. Pour parler de son enfance allemande. Au cours d’une longue vie, on fait feu de tout bois.»
La plupart des Essinger travaillent dans l’enseignement, ils sont fidèles au rendez-vous new-yorkais et ne le rateraient pour rien au monde. Pas si simple de les réunir chaque année. Il faut leur procurer des billets d’entrée, les installer en ville. Cette tâche un peu ingrate revient à Dana, la compagne de Paul. L’appartement qu’elle leur trouve appartient à son ex-mari. Cela n’arrange pas forcément les choses. Paul et Dana ont un petit garçon de deux ans, Cal. Il est au centre de leur vie plutôt aisée à Manhattan. Dana a été mannequin, elle reste éblouissante. Elle suit des cours de photographie, ça la passionne et ça inquiète Bill, le père de Paul. Les amis jeunes, beaux et branchés fréquentés par le couple l’inquiètent eux aussi.
« Enfin, se dit-il, chacun vit à sa façon. […] Mais quand on se lie à des vies instables, il y a un prix à payer. L’instabilité est contagieuse pensait Bill, et de fait, Paul et Dana n’étaient pas mariés. »
Côté jardin, le tableau familial semble enchanteur. Côté cour, la vue est moins réjouissante. La douceur du gazon cède progressivement la place au béton armé. On y distingue un mélange de divergences et de rancœurs inavouées, des alliances, des incompréhensions et des secrets jalousement gardés. De profonds désaccords. Tout finira inévitablement par basculer, au cours d’un week-end révélateur. Markovits nous y prouve son talent d’écrivain.
Week-end à New York, ce pourrait être le titre d’une comédie romantique ou d’un film de Woody Allen. Le livre peut aussi être lu comme une métaphore de la vie de famille en général, dans le sillage du film culte et engagé du cinéaste Ken Loach, en 1971, Family Life. Markovits traite ici d’un cas assez particulier, en évoquant à son tour deux cercles coercitifs, la famille et la société. Ce n’est pas tant de Paul, le personnage clé du livre, qu’il s’agit, mais de tous ses parents, victimes indirectes de leur classe sociale et de leurs ambitions : « Que son fils ait réussi à ce point à New York, la ville que son grand-père et ses grands-oncles avaient quittée deux générations plus tôt… »
Week-end à New York n’est pas une simple fiction. C’est la mémoire d’une jeunesse. Celle de Benjamin Markovits. L’auteur est bien le fils d’une allemande catholique et d’un père juif, élevé dans les faubourgs de New York. Les similitudes entre sa famille d’origine et la famille Essinger ne sont pas le fruit du hasard.
Au bout du compte, Markovits s’attaque aux valeurs conventionnelles, aux ambitions professionnelles un peu trop classiques des membres d’une cellule familiale bourgeoise. À l’exception de Paul, le joueur de tennis, le clan Essinger est formé de professeurs et d’enseignants. Une grande famille unie et assez uniforme à première vue. Pas évident dans ces conditions de se démarquer. Pour faire valoir l’originalité d’un choix de vie différent, Paul devra-t-il remporter un match de plus à l’US Open ? Rien n’est moins sûr. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui compte le plus.
« Derrière lui, la grille, peut-être poussée par un courant d’air, se referma avec un claquement profond. Le vent passait entre les barreaux », écrivait poétiquement Boris Vian dans l’Arrache-cœur, son dernier roman publié en 1953. « Cette cage symbolique avait été construite avec soin par une mère pour ses enfants. Elle laissait filtrer une impression de liberté. Jamais elle n’y donnerait réellement accès. » Paul, dans Week-end à New York, empruntera la clé du tennis pour s’évader de la cage intellectuelle, sociale et culturelle où sa famille tout entière souhaite le retenir prisonnier.
Les dialogues sont au centre du roman de Markovits et offrent un aperçu très réaliste de la vie de famille. Les Essinger aiment se retrouver à table autour d’un repas pour débattre longuement de tout et de rien, avec un naturel surprenant. C’est dans ces moments simples de partage quotidien qu’on devine le mieux les personnages. Nous sommes à table avec eux et leur conversation nous enchante. Tout au long du livre, l’auteur laisse librement parler sa plume et s’exprimer les autres. Il a le don de savoir les écouter attentivement, sans jamais les interrompre.
Benjamin Markovits est un auteur anglo-américain. Il a étudié à Yale et à Oxford. Ex-joueur de basket professionnel, ses connaissances du sport et de la préparation mentale et physique des athlètes lui permettent de nous livrer des secrets d’alcôve. Polyvalent et éclectique, Markovits collabore à de nombreuses publications dont The New York Times, Esquire, Granta et The Guardian. Il signe ici son huitième roman, après une brillante trilogie sur la vie de Lord Byron. Sélectionné parmi les meilleurs jeunes écrivains britanniques, il a reçu en 2016 le prix du roman pour son récit You Don’t Have to Live Like This.
Article publié dans COURTS n° 6, automne 2019.